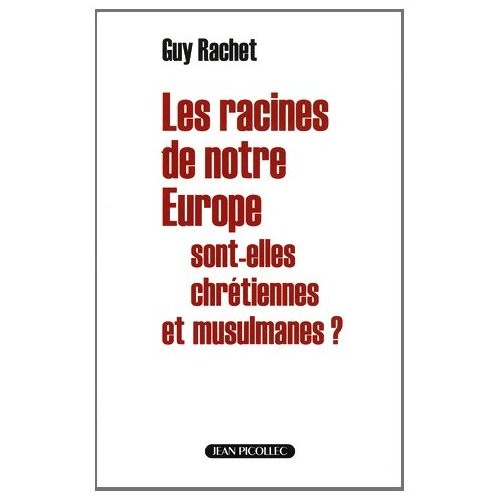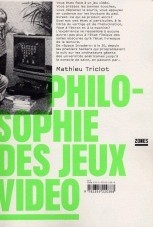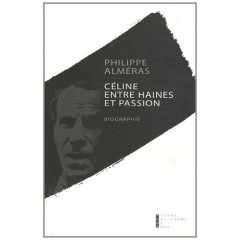La « Spanish Revolution » ou le Mai-2011 espagnol
Certains éléments de ce qui est en train de se passer lors de ce Mai-2011 espagnol sont certainement pleins d’ombre. D’autres, par contre, sont rayonnants de lumière. C’est là un double sentiment qui ressemble très fort à ce que l’on peut éprouver à propos du Mai-68 français, dont la double lecture nous a amené à publier, lors de son 40e anniversaire, un article louant ses vertus et un autre combattant ses égarements.
Commençons par les zones d’ombre : le mépris du passé
Certaines questions, quelque peu « folkloriques », si l’on veut, ne sont pas moins significatives de l’esprit qui marque ceux qui, par milliers, sont en train de se rassembler ces jours-ci jusque dans soixante villes de toute l’Espagne. C’est ainsi que, lorsque des drapeaux espagnols ont fait leur apparition sur la Puerta del Sol de Madrid, ils ont été conspués et il a fallu les enlever face au cri majoritaire de « Dehors tous les drapeaux ! » Voilà un bien étrange pays que l’Espagne ! Probablement le seul au monde dont le drapeau ne peut pas ondoyer lors d’un acte public de protestation. (Tout se passe comme s’il s’agissait d’une bannière partisane. Car c’est bien ainsi, voilà la déchirure, qu’elle est ressentie par la partie des Espagnols qui ne se reconnaissent que dans le seul drapeau de la République ; tout comme les Français antiroyalistes du XIXe siècle ne se reconnaissaient, par exemple, que dans le drapeau tricolore et rejetaient la bannière ornée de la fleur de lys.)
Poursuivons avec d’autres faits pleins de signification. Lors du rassemblement à Palme de Majorque, les manifestants ont changé le nom d’une place, en enlevant celui de Jaime Ier, le grand roi du Moyen Age qui, après avoir conquis la province de Valence et l’île de Majorque aux Arabes, unifia le royaume d’Aragon. Mais ce que les jeunes manifestants reprochaient à Jaime Ier, ce n’était pas d’avoir combattu le pouvoir musulman. S’ils l’avaient su, loin de se borner à enlever la plaque, ils l’auraient probablement cassée et souillée… Mais, compte tenu du désert qu’est notre système éducatif, ils n’avaient sans doute pas la moindre idée de qui était le personnage dont ils dénigraient le nom. Il leur suffisait que ce soit un roi, un héros, un reste de la présence de notre passé : ce passé qu’ils essayaient d’effacer, de mépriser, tout comme il est méprisé (ou ignoré) par l’ensemble de notre époque.
Il y a plus. Les « indignés », comme ils s’appellent eux-mêmes, ont lu publiquement, à la Plaza de Cataluña de Barcelone, le fameux best-seller Indignez-vous ! de Stéphane Hessel : ce mélange de vacuités et d’angélisme mièvre auquel je viens moi-même de répondre en publiant la plaquette ¡Escandalizaos! [Scandalisez-vous !] (1).
Si l’on y ajoute que les communistes d’Izquierda Unida, tout comme d’autres gauchistes purs et durs, se sont infiltrés dans le mouvement en essayant d’en tirer le plus de profit, l’affaire paraît entendue, n’est-ce pas ? Et pourtant, non. L’affaire est extrêmement complexe et c’est dans toute sa complexité qu’il convient de l’envisager : sans nous offusquer par tout ce qui nous gêne ; en oubliant des puretés impossibles à atteindre ; en visant, en définitive, l’essentiel.
Qu’est-ce que l’essentiel ? L’imprévisible, l’inattendu !
L’essentiel c’est, d’une part, la spontanéité indubitable qui a fait éclater un mouvement qui, tout en soulignant encore une fois l’énorme importance d’Internet dans la lutte contre des pouvoirs qui semblent tout contrôler, a démontré ce qu’un Dominique Venner est en train de répéter depuis longtemps : l’histoire est par définition imprévisible. Lorsqu’aucun espoir ne semble plus se dessiner à l’horizon ; lorsque les eaux sont si calmes qu’elles semblent mortes ; lorsqu’elles sont fermement contenues par de hautes digues levées par le pouvoir, c’est alors, au moment le plus inattendu, que ces mêmes eaux peuvent pourtant déborder et tout noyer.
Vont-elles en l’occurrence tout noyer ? Ou, par contre, elles ne vont rien noyer et c’est en eau de boudin qu’elles vont finir ? Nous n’en savons rien et personne ne peut s’aventurer au petit jeu des prévisions. Risquons-en une, pourtant. Le plus probable, c’est que les eaux qui ont commencé à déborder ne noieront finalement rien. Le plus probable, c’est que l’on assiste à la dissolution progressive d’un mouvement qui est dépourvu de toute véritable direction, qui n’a ni chefs ni figures charismatiques pour le diriger – quelque chose dont les « indignés », poussés par leur égalitarisme suicidaire, se vantent même…
Quoi qu’il arrive, quelque chose est pourtant manifeste : des milliers d’Espagnols, jeunes pour la plupart, entourés d’une grande sympathie populaire, des milliers d’Espagnols qui n’ont rencontré aucune hostilité sociale, se sont mobilisés avec une force jusqu’à présent inconnue contre le Système qui, dirigé par sa caste politico-financière, nous a conduits à la crise actuelle. (Nous l’avions toujours dit, rappelez-vous : sans une grande crise, très profonde, très dure, rien ne pourra jamais bouger d’un pouce.)
Et pourtant, c’est vrai : la façon dont le Mai espagnol conteste l’actuel ordre des choses, ce n’est pas la façon que nous aimerions, ce n’est pas celle que nous approuverions sans ciller. Dans l’esprit des « indignés », tout est absorbé par la revendication économique. C’est du reste bien logique : enfants de notre temps, ils sont aussi matérialistes que celui-ci. Si au lieu d’être voués au chômage et à des salaires de 1.000 euros ou moins, ils touchaient des salaires de 1.500 ou 2.000 euros, pas une seule manifestation n’aurait vu le jour et personne ne serait ému face aux manigances des puissants. Tout comme personne ne s’en émouvait lorsque les vaches étaient grasses.
Voilà ce qu’il en est. Personne, certes, n’est en train de se manifester, ni personne ne va jamais se manifester (sauf, peut-être, les lecteurs de ce journal) contre « la mort de l’esprit » (2). Ce n’est certes pas l’absurdité de notre vie dépourvue de sens et d’horizon ; ce n’est certes pas la vulgarité, la bêtise et la laideur d’un monde dépourvu autant de grand art que de beauté quotidienne ; ce ne sont certes pas de telles choses qui peuvent ébranler les foules.
Et alors ? Qu’importe ! Cela importerait beaucoup, cela serait même proprement catastrophique, si le profond changement de sensibilité et d’imaginaire, tout ce chambardement de notre conception du monde, tout ce bouleversement qui, comme dirait l’autre, « est la seule chose qui peut nous sauver », était au coin de la rue ou, tout au moins, à l’horizon. Mais ce n’est pas le cas : la question ne se pose nullement avec imminence, c’est là une affaire à longue portée, elle est tout sauf immédiate.
Derrière la bouffe et le travail, la contestation du Système
Ce qui est bien immédiat c’est qu’en dessous de ce qui pousse les manifestants, en dessous de ce malaise axé sur les questions de la bouffe et du travail – des questions, d’ailleurs, nullement dédaignables –, se trouve quelque chose qui n’y avait jamais été : la contestation de notre système politique. La conviction ou du moins l’intuition de l’immense tromperie, de la grande farce : le sentiment que ce qui se déploie sous le nom de « démocratie » – ce nom vide et compassé que nos politiciens répètent jusqu’à la nausée – n’a rien à voir avec celle-ci.
« Ils ne nous représentent pas ! » « Ne les votez pas ! » « Contre tous les partis ! » « Contre le système corrompu du PPSOE ! »… (3) s’écrient les manifestants. On n’avait jamais rien vu de pareil. Surtout parce qui est opposé à la démocratie actuelle n’a rien à voir avec une quelconque dictature. C’est bien la première fois qu’on lutte résolument contre le Système – contre le libéral-capitalisme, si l’on préfère – sans prétendre abolir le marché et sans prôner rien qui aurait à voir avec la « dictature du prolétariat ».
« La lutte des classes » chère au marxisme, ce puits sans fond de haine et de ressentiment, voilà ce qui a disparu de la scène. On ne trouve ici nulle trace des deux grands mots qui nous ont conduits jusqu’aux grands malheurs du XXe siècle. Personne n’a jamais prononcé ici – personne n’y a même songé – ni le mot bourgeoisie ni le mot prolétariat. Le mot capitalisme non plus. Ou plutôt si. A la Puerta del Sol madrilène (à la Porte du Soleil, donc…) une affiche proclamait : « Ni capitalisme ni socialisme ».
Et pourtant, l’enjeu qui pousse les foules dans la rue n’a rien à voir non plus avec le réformisme social-démocrate qui, au fil des années, a fini par conduire au « socialisme caviar » des DSK et autres multimillionnaires et magnats socialistes : les plus fermes défenseurs de l’actuel ordre financier et déprédateur.
C’est contre les requins des finances, c’est contre la convoitise spéculative qui nous ruine tous – y compris une partie importante des entrepreneurs productifs – que se lève une protestation dont les principales revendications économiques consistent dans des choses telles que : expropriation des logements invendus de la bulle immobilière, cette spéculation démente qui a conduit l’Espagne au bord de la faillite (c’est à plus d’un million qu’on évalue les logements jamais vendus : toute une métropole vide s’éparpillant, telle un fantôme, sur l’ensemble du pays) ; interdiction des rachats des banques, ainsi que du placement de leurs bénéfices sis dans des paradis fiscaux ; adoption d’une taxe sur les transactions internationales (la « taxe Tobin », comme on l’appelle).
« Nous sommes des personnes, non pas des produits du marché »
Comment ne pas soutenir de telles revendications ? Comment ne pas appuyer surtout l’esprit qui les sous-tend et qui s’exprime dans le Manifeste lancé au début de la protestation ? On pouvait y lire : « Ce qu’il faut, c’est une Révolution éthique. Nous avons placé l’argent au-dessus de l’être humain, et nous devons le mettre à son service. Nous sommes des personnes, non pas des produits du marché. »
Javier Ruiz Portella (Polémia, 23 mai 2011)
(Traduit par l’auteur pour Polémia)