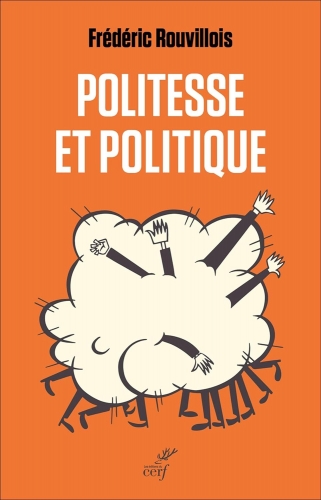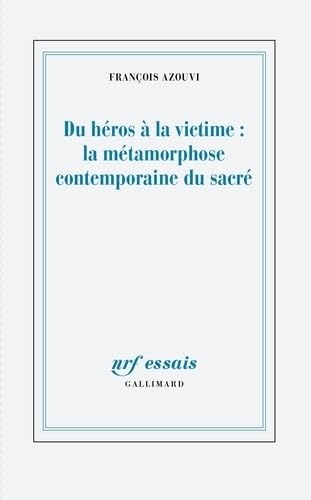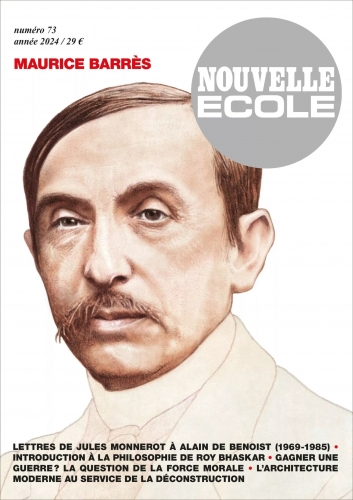Aya Nakamura : n’entrons pas dans la fausse polémique macronienne
Avec Aya Nakamura, la macronie lance une nouvelle opération de diversion, activement soutenue par les médias mainstream et aussi, hélas, par les gogos de droite. Car, dans l’affaire Aya Nakamura, tout est faux, comme la perruque blonde, les faux cils et les faux ongles de la chanteuse. Ne serait-ce que parce que la polémique a été lancée alors qu’aucune décision n’a été prise, semble-t-il. Alors, n’entrons pas dans la manipulation.
L’art de la diversion macronienne
La technique de la diversion macronienne est toujours la même : d’abord, on fait une annonce provocante – ici, la désignation d’une chanteuse franco-malienne au français douteux pour la cérémonie d’ouverture des prochains Jeux olympiques – destinée à jouer, vis-à-vis de l’opinion, le rôle de chiffon rouge.
Cette annonce permet alors de rassembler le camp progressiste autour du gouvernement qui lance le projet et de dénoncer le camp rétrograde. De son côté, la « droite », elle, se divise toujours entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre ou ceux qui s’abstiennent par peur de la diabolisation, et elle perd donc l’initiative.
Et pendant qu’on concentre « l’info » et les débats autour de l’annonce, on ne parle évidemment pas des sujets qui fâchent le pouvoir.
Ce scénario fonctionne depuis au moins la présidence Hollande et réside au cœur des réformes sociétales : fabriquer des oppositions factices, horizontales, pour diviser les Français de façon à neutraliser l’opposition verticale et radicale entre le peuple et les élites. Pendant que les polémiques sociétales permettent aussi de faire oublier la question sociale pour le plus grand profit du pouvoir économique.
Attendons-nous au pire, nous ne serons pas surpris
En vérité, le choix d’Aya Nakamura dans le rôle d’Édith Piaf ne saurait surprendre que les imbéciles.
Il est en effet à l’aune d’un pouvoir qui a pris le parti de mépriser l’identité nationale et de ridiculiser les Français en toute occasion.
Alors, pour les Jeux olympiques, attendons-nous au pire, nous ne serons pas surpris !
La cérémonie d’ouverture verra le remake inclusif [1], antiraciste et woke de celle du bicentenaire de la Révolution française : sauf qu’à l’époque on avait fait appel à la cantatrice soprano Jessye Norman. Aujourd’hui, on semble choisir Aya Nakamura, ce qui permet de mesurer la chute de notre pays depuis 1989 et le niveau culturel de nos décideurs actuels…
Il s’agira de « briser les codes », annonce le site Internet des JO. Nous voilà avertis.
Nous aurons donc, sans doute, des défilés d’athlètes transgenres, si possible de toutes les couleurs, et peut-être demandera-t-on à Volodymyr Zelensky de chanter La Marseillaise. Ou à Mme von der Leyen de brandir, en maillot arc-en-ciel, le drapeau de l’UE sous les ponts de Paris.
N’en doutons pas, les bobos vont exulter, à l’instar d’Amélie Oudéa-Castéra qui se pâme déjà devant le talent d’Aya, et c’est l’essentiel puisque les Français seront de toute façon exclus du programme tant par le prix des billets que par les mesures de police ou les interdictions de circulation. Un Paris Potemkine sans beaufs, sans voitures, et vidé pour la circonstance de ses migrants, sinon de ses rats : le rêve de la gauche bourgeoise [2].
Soyons plus « Djadja »
Alors n’entrons pas dans la fausse polémique du moment.
Si l’on vous interroge sur Aya Nakamura, demandez plutôt à votre interlocuteur d’évoquer par exemple le bilan diplomatique, économique et sécuritaire catastrophique d’Emmanuel Macron, son dangereux bellicisme, son isolement sur le plan international, ou encore la réduction continue des libertés publiques dans notre pays.
Ce sera nettement plus « Djadja »…
Michel Geoffroy (Polémia, 21 mars 2024)
[1] À la condition, bien sûr, de faire disparaître toute croix chrétienne de l’affiche des JO.
[2] Pléonasme français.