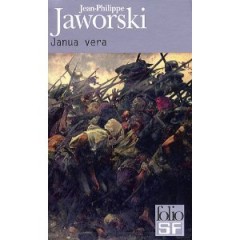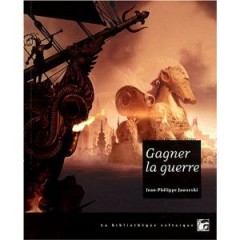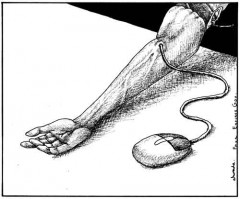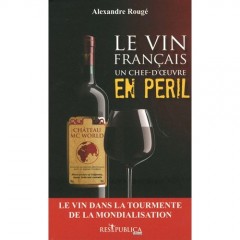Entretien avec Jacob Cohen à propos de son livre Le printemps des sayanim
Pourquoi ce titre ? J’ai voulu que le terme « sayanim » apparaisse d’emblée et interpelle le lecteur. On se pose la question, et la définition se trouve juste dans les premières lignes de la 4e.
La problématique est installée, sans faux-fuyants, et sans réserve. Idéalement, j’aimerais que ce terme entre dans le vocabulaire courant, dans les analyses, et dans les commentaires.
Voulez-vous nous la rappeler ?
Les sayanim - informateurs en hébreu - sont des juifs de la diaspora qui, par « patriotisme », acceptent de collaborer ponctuellement avec le Mossad, ou autres institutions sionistes, leur apportant l’aide nécessaire dans le domaine de leur compétence.
Comment avez-vous eu l’idée d’écrire sur les sayanim ?
C’est la conjugaison de plusieurs éléments. La lecture de tout livre sérieux sur le Mossad montre l’importance essentielle de ces citoyens juifs qui décident de travailler pour les services secrets israéliens. Imaginez des dizaines de milliers d’agents, occupant des fonctions dans toutes les couches sociales, et qui obéissent au doigt et à l’œil au Mossad. Il est à noter que les auteurs anglo-saxons sont beaucoup plus prolifiques sur ce sujet. Je suis d’assez près l’actualité proche-orientale, et je consulte les médias des 2 bords. Et je suis sidéré, presque fasciné, par la puissance médiatique du lobby pro-israélien. Et comment il arrive à faire rentrer dans les esprits, jusqu’à devenir des banalités admises, des concepts comme « la seule démocratie de la région », ou tellement aberrants, comme « assurer la sécurité d’Israël ». Le fait de savoir que des sayanim sont en grande partie le moteur de cette propagande permet une lecture plus lucide et plus pertinente de l’actualité.
Est-ce une réalité ?
Je comprends le sens de la question. Je cite Gordon Thomas au début du livre. C’est un spécialiste reconnu des services secrets, en particulier du Mossad. Tellement reconnu qu’il a interviewé tous les chefs du Mossad depuis les années 60, et tous ont admis, en s’en glorifiant, l’apport crucial des sayanim à travers le monde. Je cite également Victor Ostrovsky, l’un des rares agents du Mossad à avoir publié, après son départ de l’institution, un témoignage unique et inédit sur le service secret, ses méthodes, ses objectifs, ses ressources.
Quel est leur nombre ?
En France ils seraient près de 3000. Ostrovski, ex-agent du Mossad, estime leur nombre à 3000 rien qu’à Londres. On peut imaginer leur importance aux Etats-Unis. Mais le « réservoir » est infini. Si on associe le Bnai Brit (franc-maçonnerie juive internationale), la WIZO (organisation internationale des femmes sionistes), les organisations judéo-sionistes nationales, comme l’UPJF, l’UEJF, le CRIF... en France, et dans les autres pays, ainsi que les sympathisants, on arrive facilement au chiffre de un million de juifs prêts à travailler pour le Mossad. Evidemment ils ne sont pas tous recrutés à cette tâche. Car il faudrait des centaines d’agents pour les traiter. Le Mossad se contente d’en avoir dans tous les secteurs d’activité, avec un accent particulier sur les plus sensibles : les médias, les grands hôtels et les agences de voyage (pour surveiller les allées et venues des Arabes en général, des agents de renseignement, des hommes d’affaire, enfin de toute personne susceptible d’atteindre les intérêts israéliens.
Un cas concret pour en comprendre le mécanisme ?
Pour revenir à Victor Ostrovsky. Lorsque la France a construit une centrale nucléaire en Irak dans les années 70, des scientifiques irakiens étaient venus à Saclay pour se perfectionner. Le Mossad était bien sûr intéressé à les connaître pour pouvoir agir sur eux. N’importe quel autre service secret aurait eu besoin de moyens en hommes, de filature, d’argent pour corrompre, peut-^tre de tentatives d’effraction, et de temps, pour y arriver éventuellement. Le Mossad, et c’est sa supériorité, s’est tout simplement adressé à un informateur juif (sayan) qui travaillait à Saclay. Et a demandé que lui fussent fournis les dossiers complets originaux. Car il se méfiait des photocopies. La majorité des renseignements étant en arabe, c’est lui-même qui s’est acquitté de cette tâche. Quel autre service de renseignements peut bénéficier de telles complicités ? Après, ce fut un jeu d’enfant pour piéger l’un de ces scientifiques, remonter jusqu’à leur responsable, et l’assassiner lors de sa visite à Paris.
Ces agents juifs n’interviennent-ils que dans des cas d’espionnage ?
Pas du tout. Les sayanim interviennent aussi et surtout dans les manipulations médiatiques. D’ailleurs le Mossad possède un département important, appelé le LAP, pour « guerre de propagande ». Il me revient un exemple historique. Rappelez-vous le film EXODUS. Il a réécrit l’histoire de 1948 et imposé la vision sioniste pour au moins une génération. En 1961, c’est le premier ministre israélien en personne qui a accueilli l’équipe du film à l’aéroport. C’est dire l’importance qu’on lui accordait.
Rappelons l’importance du Bnai Brit. 500 000 membres dans le monde, probablement 400 000 aux Etats-Unis, dont 6 000 dans le secteur du cinéma. Comment imaginer qu’un film ou qu’une série défavorable à Israël puisse voir le jour ?
Et plus récemment ?
Le cas le plus flagrant est celui du soldat israélien enlevé par le Hamas. Le réseau des sayanim à travers le monde a fait en sorte que son nom soit tellement matraqué que personne ou presque n’ignore son nom. Par ailleurs, son père a été reçu à plusieurs reprises par tous les dirigeants occidentaux, par Sarkozy, Merkel, Blair, Berluscuni, Zapatero, Barroso, par le secrétaire général de l’ONU, par le parlement européen, par l’assemblée de l’UNESCO, enfin le gratin mondial. Comment est-ce possible sans l’intervention de sayanim bien placés dans les instances gouvernementales, économiques, culturelles, médiatiques ? Je rappelle qu’il s’agit d’un caporal d’une armée d’occupation. Quel autre prisonnier peut bénéficier d’une telle sollicitude internationale ? Et avoir son portrait géant sur l’édifice de la Mairie du 16e arrondissement ? Des hommes politiques français, dont Sarkozy et Kouchner, ont exigé sa libération pour raisons humanitaires. Sans dire un mot des milliers de prisonniers palestiniens.
Dans quel but ?
Il s’agit de faire pénétrer dans l’opinion internationale qu’Israël a un « otage » (un seul !) aux mains du Hamas. Cela fait oublier les 11 000 prisonniers palestiniens détenus dans les geôles israéliennes. L’écrasante majorité d’entre eux sont des prisonniers politiques, c’est-à-dire condamnés pour leur lutte pacifique pour l’indépendance. Rappelons qu’Israël est le seul pays « démocratique » au monde qui applique la détention administrative : pouvoir emprisonner n’importe quel citoyen sans avocat, sans jugement, sans motif, sans limitation dans le temps. Et c’est sur cette base que les forces d’occupation ont kidnappé, juste après l’enlèvement du soldat, 45 personnalités politiques du Hamas, en majorité des élus du peuple. Sans qu’elles aient rien à leur reprocher. Cela s’appelle des « représailles collectives » condamnées par le droit international, et rappelle le comportement de l’occupant nazi en France.
Ainsi, pendant que les médias nous matraquent avec le soldat « otage », on oublie le plus important, et le plus horrible.
Une expérience personnelle : Le 26 juin, le journal du matin de TV5 avait encore fait un reportage sur le drame de ce soldat « otage ». J’ai écrit en rappelant que l’honnêteté journalistique aurait exigé de mentionner les prisonniers soumis à la détention administrative et le kidnapping des 45 élus du Hamas. Aucune réponse, aucun correctif.
Comment se fait-il qu’on ne parle pas beaucoup des sayanim ?
Cela reste un mystère. Comment des journalistes aguerris ont pu disserter sur Israël sans mettre sur le doigt sur cet aspect capital ! Je mets cela sur la puissance des sayanim qui ont réussi l’exploit de ne pas faire parler d’eux. Il ne faut pas oublier que la chape qui écrasait les médias pour diffuser la pensée unique favorable à Israël n’a commencé à se fissurer que depuis quelques années.
Pourquoi des citoyens juifs français par exemple deviennent des sayanim ?
Vous savez, l’idéologie sioniste, jusqu’en 1948, était loin d’être majoritaire dans les communautés juives. Je me souviens qu’au Maroc, dans les années 50, les rabbins vilipendaient les sionistes. Et puis la création d’Israël, la propagande, la hantise d’un nouveau génocide, ont fait en sorte que les institutions juives ont basculé dans un appui inconditionnel à l’Etat juif. Aujourd’hui en France il n’est pas admissible d’exprimer la moindre réserve dans le cadre des institutions juives. La propagande est telle que les citoyens juifs qui vivent dans le cadre de ces institutions développent un second patriotisme et un nationalisme hors du commun. Au besoin, comme illustré dans le roman (l’épisode du cardiologue), le Mossad fera appel au chantage patriotique.
Vous donnez une grande importance à la franc-maçonnerie dans votre livre. Pourquoi ?
La franc-maçonnerie me paraît une illustration parfaite du travail d’infiltration et de propagande mené par les sayanim. D’abord pour montrer qu’aucun domaine ne leur échappe. Il n’y a pas de petits profits. Là où on peut pousser à la défense d’Israël, on le fait sans états d’âme. Par ailleurs, cela montre que les juifs sionistes ne reculent devant rien. Car peu de gens ignorent - même si on n’est pas familier avec la franc-maçonnerie - que celle-ci est d’abord laïque, ouverte à tous sans distinction de race, de religion, ou d’orientation politique. Et voilà que des franc-maçons juifs et sionistes créent en 2002 une loge spécifiquement juive, et sioniste pour défendre Israël.
Je l’ai vécu personnellement, car j’ai été franc-maçon pendant près de 17 ans. Cela s’est passé en 2002, au plus fort de la seconde intifada. Cela n’était pas dit expressément, car c’est contraire à l’éthique maçonnique, mais dans les faits cela revenait au même. Ne devinant pas de quel bord j’étais, ces frères m’ont mis au parfum sans ambages. Et à mon avis c’était couvert par les instances supérieures. Tout ce qui se disait dans la loge était favorable à Israël (voir le 1er chapitre et la conférence tendant à faire un parallèle entre les réfugiés palestiniens et les juifs partis des pays arabes, souvent à l’instigation du Mossad). Et chaque année, la loge organise un « voyage d’information » en Israël, encadré par des fonctionnaires du ministère israélien des Affaires étrangères.
Un de mes personnages principaux, Youssef El Kouhen, va subir les foudres des sayanim franc-maçons. Fils d’immigrés maghrébins, il pense faire un pas décisif dans son intégration républicaine en étant admis au sein du Grand Orient. Mais ayant découvert l’existence de cette loge « judéo-sioniste », il va tenter, avec d’autres frères arabes de contrer leur propagande en créant une loge pro-palestinienne. Mais là il va se heurter à la puissance du lobby sioniste implanté au Grand Orient de France et subira une défaite cinglante. Ce lobby va agir au mépris de toutes les lois de l’Obédience.
En parcourant le livre, on s’aperçoit que certains personnages ressemblent étrangement à des personnes connues, surtout pour leurs sympathies sionistes.
Parmi les 3 000 sayanim français, certains sont connus. Pas en tant que sayanim. Par définition, ce sont des agents secret. Mais étant donné leur soutien constant à Israël et leur participation active à des campagnes savamment orchestrées, il est probable qu’ils agissent dans ce cadre. J’ai voulu les montrer en action, par exemple pour recruter pour monter en épingle une rencontre sportive israélo-palestinienne à Paris, sans autre finalité que de donner l’illusion d’un processus de paix.
Et plus explicitement ?
Il y a plusieurs années, un match de football a eu lieu au Parc des Princes entre des jeunes israéliens et palestiniens. Ce qui avait donné lieu à un battage publicitaire démesuré. J’ai repris cet événement en tentant d’imaginer les coulisses, les pressions, les manipulations, les interventions. Pour obtenir gratuitement le stade, pour le remplir avec des jeunes de banlieue en faisant intervenir le rectorat, en sollicitant des subventions de l’Union européenne et de la Mairie de Paris, en faisant pression sur les dirigeants musulmans « modérés » pour qu’ils apportent leur caution. Une opération de propagande rondement menée grâce aux sayanim, et leurs alliés, dont les plus indéfectibles : SOS Racisme et la Mairie de Paris.
On retrouve souvent SOS Racisme. Pourquoi ?
Pour moi, cette organisation sert de courroie de transmission aux idéologies sionistes. Sa proximité incestueuse avec l’UEJF, un des piliers du soutien à Israël, en est une illustration. Jamais SOS Racisme n’a lancé par exemple une campagne contre l’occupation israélienne, alors qu’elle se démène contre le Soudan. En occupant le terrain, grâce à des subventions généreuses, SOS Racisme empêche l’émergence d’autres organisations anti-racistes plus proches des exigences de la majorité de ses membres. On entend d’ailleurs plusieurs voix, dont celle de Joey Star, réclamer une autre organisation anti-raciste, issue des quartiers, et les représentant légitimement.
Dans le roman, je développe un point de vue qui ne doit pas être loin de la réalité. En fait, c’est l’UEJF et ses alliés sionistes qui cherchent un candidat pour remplacer l’actuel président. D’ailleurs, quand un président de l’UEJF quitte son poste, il devient vice-président de SOS Racisme. Après un noir, les sionistes cherchent un beur présentable qui appliquera les consignes. Tout prétendant à ce poste connaît les enjeux.
Tout un chapitre est consacré à la Mairie du 16e arrondissement. Pour quelle raison ?
Cette Mairie est un des châteaux forts des sionistes. Le Bnai Brit (franc-maçonnerie juive internationale) s’y réunit régulièrement et y organise son salon du livre. Son maire est un ardent défenseur d’Israël. Un portrait géant du soldat israélien enlevé par le Hamas orne la façade de la Mairie.
Il y a ce personnage, MST, qui traverse tout le roman, et qui ressemble furieusement à BHL...
Je vous laisse la responsabilité de ce constat. Il est vrai qu’il y quelques ressemblances, mais en principe ce n’est pas lui. Ceci dit, il ne me déplait pas que certains fassent ce rapprochement. Michel-Samuel Taïeb est effectivement un personnage central, correspondant à son rôle flamboyant, à ses nombreux réseaux, à son implication sans réserve en faveur d’Israël, à l’acharnement avec lequel il recrute d’autres sayanim. C’est lui qui va recruter le cardiologue, qui va intervenir à l’Elysée pour donner l’ordre aux rectorats de remplir le stade de jeunes beurs, qui va appeler un responsable d’émission à Canal Plus pour humilier en direct des militantes de SOS Palestine, qui va faire pression sur le recteur de la Mosquée de Paris pour soutenir ce prétendu « match pour la paix », etc.
On a l’impression que vous vous êtes pas mal amusé avec les noms des sayanim.
Je n’ai pas pu m’en empêcher. Le fait de trouver ces noms, que d’aucuns pourraient rapprocher de personnages réels, me remplissait de joie à chaque fois. Il est vrai que mes sympathies vont là où vous savez. Je n’avais aucune raison de les épargner.
Est-ce à dire que c’est un roman politique ?
Si on entend par là qu’il prend position de façon claire et nette, tout en dénonçant les pratiques de chantages et de manipulations au profit d’une politique impérialiste, alors oui, c’est un roman politique. D’ailleurs il est dédié « à tous ceux qui se battent pour la justice en Palestine ». La forme romanesque n’est qu’un méthode pour y arriver. Bien qu’une grande partie du livre se base sur des faits réels, ou exprime une réalité telle qu’elle pourrait se dérouler. Lorsque MST appelle Canal Plus, je n’étais pas à l’écoute, mais la façon dont la plupart des grands médias lui déroulent le tapis rouge me fait penser que c’est sa manière d’agir. Et d’être obéi.
Est-ce qu’on vous mettra des bâtons des les roues ?
Certainement. Les sayanim et leurs complices, et ils sont nombreux et occupent des postes stratégiques, feront tout pour élever un mur de silence. Ou bien ce sera le déni. Ou enfin le recours à ces vieilles méthodes de l’amalgame. Une critique d’Israël équivaut à de l’antisémitisme. Parler des sayanim, c’est revenir à cette accusation de complot que certains antisémites au tournant du 20e siècle lançaient aux juifs pour les discréditer. Le discours du déni, et d’un certain terrorisme intellectuel, est bien rodé.
Que peut-on vous souhaiter ?
J’espère d’abord que ce livre ouvrira les yeux sur cette force puissante et insidieuse mise au service d’une idéologie de domination. Qu’il permette ensuite un décryptage plus pointu des événements. Et enfin qu’il favorise l’émergence de contre-pouvoirs.