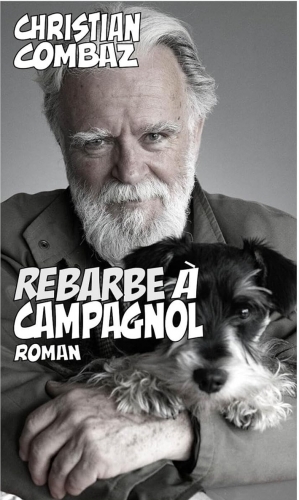L’État profond
Le terme « État profond » est de plus en plus utilisé aujourd’hui dans le discours politique, passant du journalisme au langage politique commun. Cependant, le terme lui-même devient quelque peu vague, avec l’émergence de différentes interprétations. Il est donc essentiel d’examiner de plus près le phénomène décrit comme « État profond » et de comprendre quand et où ce concept est entré en usage pour la première fois.
Cette expression est apparue pour la première fois dans la politique turque dans les années 1990, décrivant une situation très spécifique en Turquie. En turc, « État profond » se dit derin devlet. Cela est crucial car toutes les utilisations ultérieures de ce concept sont d’une certaine manière liées à la signification originale, qui a émergé pour la première fois en Turquie.
Depuis l’époque de Kemal Atatürk, la Turquie a développé un mouvement politique et idéologique particulier connu sous le nom de kémalisme. Il repose sur le culte d’Atatürk (littéralement, « Père des Turcs »), une laïcité stricte (rejet du facteur religieux non seulement en politique mais aussi dans la vie publique), le nationalisme (mise en avant de la souveraineté et de l’unité de tous les citoyens dans le paysage politique ethniquement diversifié de la Turquie), le modernisme, l’européanisme et le progressisme. Le kémalisme représentait, à bien des égards, une antithèse directe de la vision du monde et de la culture qui dominaient l’Empire ottoman religieux et traditionaliste. Depuis la création de la Turquie, le kémalisme était et reste largement le code dominant de la politique turque contemporaine. C’est sur la base de ces idées que l’État turc a été établi sur les ruines de l’Empire ottoman.
Le kémalisme a ouvertement dominé pendant le règne d’Atatürk, et par la suite, cet héritage a été transmis à ses successeurs politiques. L’idéologie kémaliste s’appuyait sur une démocratie de type européen, mais le pouvoir réel était concentré entre les mains des dirigeants militaires du pays, en particulier du Conseil de sécurité nationale (CNS). Après la mort d’Atatürk, l’élite militaire est devenue la gardienne de l’orthodoxie idéologique du kémalisme. Le CNS turc a été créé en 1960 après un coup d’État militaire, et son rôle s’est considérablement accru après un autre coup d’État en 1980.
Il est important de noter que de nombreux officiers supérieurs de l’armée turque et des responsables des services de renseignements étaient membres de loges maçonniques, mêlant ainsi le kémalisme à la franc-maçonnerie militaire. Chaque fois que la démocratie turque s’écartait du kémalisme – que ce soit vers la droite ou vers la gauche – l’armée annulait les résultats des élections et lançait un cycle de répressions.
Cependant, le terme derin devlet n’est apparu que dans les années 1990, précisément au moment où l’islamisme politique se développait en Turquie. C’est là que, pour la première fois dans l’histoire de la Turquie, un conflit s’est produit entre l’idéologie de l’État profond et la démocratie politique. Le problème est apparu lorsque des islamistes, comme Necmettin Erbakan et son partisan Recep Tayyip Erdoğan, ont poursuivi une idéologie politique alternative qui remettait directement en cause le kémalisme. Ce changement concernait tout: l’islam remplaçant la laïcité, des liens plus étroits avec l’Est par rapport à l’Ouest et la solidarité musulmane remplaçant le nationalisme turc. Dans l’ensemble, le salafisme et le néo-ottomanisme ont supplanté le kémalisme. La rhétorique antimaçonnique, notamment celle d'Erbakan, a remplacé l'influence des cercles maçonniques militaires laïcs par des ordres soufis traditionnels et des organisations islamiques modérées, comme le mouvement Nur de Fethullah Gülen.
À ce stade, l’idée d’État profond (derin devlet) est apparue comme une image descriptive du noyau militaro-politique kémaliste en Turquie, qui se considérait comme au-dessus de la démocratie politique, annulant les élections, arrêtant les personnalités politiques et religieuses et se positionnant au-dessus des procédures juridiques de la politique de style européen. La démocratie électorale ne fonctionnait que lorsqu’elle s’alignait sur la ligne de conduite de l’armée kémaliste. Lorsqu’une distance critique apparaissait, comme dans le cas des islamistes, le parti qui avait remporté les élections et même dirigé le gouvernement pouvait être dissous sans explication. Dans de tels cas, la « suspension de la démocratie » n’avait aucun fondement constitutionnel – l’armée non élue agissait sur la base d’un « opportunisme révolutionnaire » pour sauver la Turquie kémaliste.
Plus tard, Erdoğan a lancé une guerre à grande échelle contre l’État profond de la Turquie, qui a culminé avec le procès Ergenekon en 2007, où presque tous les dirigeants militaires de la Turquie ont été arrêtés sous prétexte qu'ils préparaient un coup d’État. Cependant, plus tard, Erdoğan s’est brouillé avec son ancien allié, Fethullah Gülen, qui était profondément enraciné dans les réseaux de renseignement occidentaux. Erdoğan a rétabli le statut de nombreux membres de l’État profond, en formant avec eux une alliance pragmatique, principalement sur le terrain commun du nationalisme turc. Le débat sur la laïcité a été atténué et reporté, et surtout après la tentative de coup d’État manquée des gülenistes en 2016, Erdoğan lui-même a commencé à être qualifié de « kémaliste vert ». Malgré cela, la position de l’État profond en Turquie s’est affaiblie lors de la confrontation avec Erdoğan, et l’idéologie du kémalisme s’est diluée, bien qu’elle ait survécu.
Principales caractéristiques de l’État profond
De l’histoire politique moderne de la Turquie, nous pouvons tirer plusieurs conclusions générales. Un État profond peut exister et a du sens lorsque:
1) Il existe un système électoral démocratique ;
2) Au-dessus de ce système, il existe une entité militaro-politique non élue liée à une idéologie spécifique (indépendamment de la victoire d'un parti particulier) ;
3) Il existe une société secrète (de type maçonnique par exemple) qui réunit l'élite militaro-politique.
L’État profond se révèle lorsque des contradictions apparaissent entre les normes démocratiques formelles et le pouvoir de cette élite (sinon, l’existence de l’État profond reste obscure). L’État profond n’est possible que dans les démocraties libérales, même nominales. Dans les systèmes politiques ouvertement totalitaires, comme le fascisme ou le communisme, il n’y a pas besoin d’État profond. Ici, un groupe idéologiquement rigide se reconnaît ouvertement comme la plus haute autorité, se plaçant au-dessus des lois formelles. Les systèmes à parti unique mettent l’accent sur ce modèle de gouvernance, ne laissant aucune place à l’opposition idéologique et politique. Ce n’est que dans les sociétés démocratiques, où aucune idéologie dominante ne devrait exister, que l’État profond émerge comme un phénomène de « totalitarisme caché », qui manipule la démocratie et les systèmes multipartites à sa guise.
Les communistes et les fascistes reconnaissent ouvertement la nécessité d’une idéologie dominante, rendant leur pouvoir politique et idéologique direct et transparent (potestas directa, comme l’a dit Carl Schmitt). Les libéraux nient avoir une idéologie, mais ils en ont une. Ils influencent donc les processus politiques fondés sur le libéralisme en tant que doctrine, mais seulement indirectement, par la manipulation (potestas indirecta). Le libéralisme ne révèle sa nature ouvertement totalitaire et idéologique que lorsque des contradictions surgissent entre lui et les processus politiques démocratiques.
En Turquie, où la démocratie libérale a été empruntée à l’Occident et ne correspondait pas tout à fait à la psychologie politique et sociale de la société, l’État profond a été facilement identifié et nommé. Dans d’autres systèmes démocratiques, l’existence de cette instance totalitaire-idéologique, illégitime et formellement « inexistante », est devenue évidente plus tard. Cependant, l’exemple turc revêt une importance significative pour comprendre ce phénomène. Ici, tout est limpide comme un livre ouvert.
Trump et la découverte de l’État profond aux États-Unis
Concentrons-nous maintenant sur le fait que le terme « État profond » est apparu dans les discours des journalistes, analystes et politiciens aux États-Unis pendant la présidence de Donald Trump. Une fois de plus, le contexte historique joue un rôle décisif. Les partisans de Trump, comme Steve Bannon et d’autres, ont commencé à parler de la façon dont Trump, ayant le droit constitutionnel de déterminer le cours de la politique américaine en tant que président élu, a rencontré des obstacles inattendus qui ne pouvaient pas être simplement attribués à l’opposition du Parti démocrate ou à l’inertie bureaucratique.
Peu à peu, à mesure que cette résistance s’intensifiait, Trump et ses partisans ont commencé à se considérer non seulement comme des représentants du programme républicain, traditionnel pour les politiciens et présidents du parti précédents, mais comme quelque chose de plus. Leur focalisation sur les valeurs traditionnelles et leur critique de l’agenda mondialiste ont touché une corde sensible non seulement chez leurs adversaires politiques directs, les « progressistes » et le Parti démocrate, mais aussi chez une entité invisible et inconstitutionnelle, capable d’influencer tous les processus majeurs de la politique américaine – la finance, les grandes entreprises, les médias, les agences de renseignement, le système judiciaire, les principales institutions culturelles, les meilleurs établissements d’enseignement, etc. – de manière coordonnée et ciblée.
Il semblerait que les actions de l’appareil gouvernemental dans son ensemble devraient suivre le cours et les décisions d’un président des États-Unis légalement élu. Mais il s’est avéré que ce n’était pas du tout le cas. Indépendamment de Trump, à un niveau supérieur du « pouvoir de l’ombre », des processus incontrôlables étaient en cours. Ainsi, l’État profond a été découvert aux États-Unis même.
Aux États-Unis, comme en Turquie, il existe indubitablement une démocratie libérale. Mais l’existence d’une entité militaro-politique non élue, liée à une idéologie spécifique (indépendamment de la victoire d’un parti particulier) et éventuellement membre d’une société secrète (comme une organisation de type maçonnique), était complètement imprévue pour les Américains. Par conséquent, le discours sur l’État profond pendant cette période est devenu une révélation pour beaucoup, passant d’une « théorie du complot » à une réalité politique visible.
Bien sûr, l’assassinat non résolu de John F. Kennedy, l’élimination probable d’autres membres de son clan, de nombreuses incohérences entourant les événements tragiques du 11 septembre et plusieurs autres secrets non résolus de la politique américaine ont conduit les Américains à soupçonner l’existence d’une sorte de « pouvoir caché » aux États-Unis.
Les théories du complot, populaires, ont proposé les candidats les plus improbables – des crypto-communistes aux reptiliens et aux Anunnaki. Mais l’histoire de la présidence de Trump, et plus encore sa persécution après sa défaite face à Biden et les deux tentatives d’assassinat pendant la campagne électorale de 2024, rendent nécessaire de prendre au sérieux l’État profond aux États-Unis. Ce n’est plus quelque chose que l’on peut ignorer. Il existe bel et bien, il agit, il est actif et il… gouverne.
Council on Foreign Relations : vers la création d’un gouvernement mondial
Pour expliquer ce phénomène, il faut d’abord se tourner vers les organisations politiques américaines du 20ème siècle qui étaient les plus idéologiques et cherchaient à fonctionner au-delà des clivages partisans. Si nous essayons de trouver le noyau de l’État profond parmi les militaires, les agences de renseignement, les magnats de Wall Street, les magnats de la technologie et autres, il est peu probable que nous parvenions à une conclusion satisfaisante. La situation y est trop individualisée et diffuse. Il faut d’abord et avant tout prêter attention à l’idéologie.
Laissant de côté les théories du complot, deux entités se distinguent comme les plus aptes à jouer ce rôle: le CFR (Council on Foreign Relations), fondé dans les années 1920 par des partisans du président Woodrow Wilson, ardent défenseur du mondialisme démocratique, et le mouvement beaucoup plus tardif des néoconservateurs américains, qui ont émergé du milieu trotskiste autrefois marginal et ont progressivement acquis une influence significative aux États-Unis.
Le CFR et les néoconservateurs sont tous deux indépendants de tout parti. Leur objectif est de guider la politique américaine dans son ensemble, quel que soit le parti au pouvoir à un moment donné. De plus, ces deux entités possèdent des idéologies bien structurées et claires: le mondialisme de gauche libéral dans le cas du CFR et l’hégémonie américaine affirmée dans le cas des néoconservateurs. Le CFR peut être considéré comme les mondialistes de gauche et les néoconservateurs comme les mondialistes de droite.
Dès sa création, le CFR s’est fixé pour objectif de faire passer les États-Unis d’un État-nation à un « empire » démocratique mondial. Contre les isolationnistes, le CFR a avancé la thèse selon laquelle les États-Unis sont destinés à rendre le monde entier libéral et démocratique. Les idéaux et les valeurs de la démocratie libérale, du capitalisme et de l’individualisme ont été placés au-dessus des intérêts nationaux. Tout au long du 20ème siècle, à l’exception d’une brève interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, ce réseau de politiciens, d’experts, d’intellectuels et de représentants de sociétés transnationales a œuvré à la création d’organisations supranationales: d’abord la Société des Nations, puis les Nations Unies, le Club Bilderberg, la Commission trilatérale, etc. Leur tâche consistait à créer une élite libérale mondiale unifiée qui partageait l’idéologie du mondialisme dans tous les domaines: philosophie, culture, science, économie, politique, etc. Les activités des mondialistes au sein du CFR visaient à établir un gouvernement mondial, impliquant le dépérissement progressif des États-nations et le transfert du pouvoir des anciennes entités souveraines aux mains d’une oligarchie mondiale, composée des élites libérales du monde, formées selon les modèles occidentaux.
Par le biais de ses réseaux européens, le CFR a joué un rôle actif dans la création de l’Union européenne (une étape concrète vers un gouvernement mondial). Ses représentants – en particulier Henry Kissinger, le leader intellectuel de l’organisation – ont joué un rôle clé dans l’intégration de la Chine au marché mondial, une mesure efficace pour affaiblir le bloc socialiste. Le CFR a également activement promu la théorie de la convergence et a réussi à exercer une influence sur les dirigeants soviétiques de la fin de l’ère soviétique, jusqu’à Gorbatchev. Sous l’influence des stratégies géopolitiques du CFR, les idéologues soviétiques de la fin de l’ère soviétique ont écrit sur la «gouvernabilité de la communauté mondiale».
Aux États-Unis, le CFR est un organisme strictement non partisan, qui regroupe à la fois des démocrates, dont il est un peu plus proche, et des républicains. Il fait office d’état-major du mondialisme, avec des initiatives européennes similaires – comme le Forum de Davos de Klaus Schwab – lesquelles sont comme filiales. À la veille de l’effondrement de l’Union soviétique, le CFR a créé une filiale à Moscou, à l’Institut d’études systémiques dirigé par l’académicien Gvishiani, d’où sont issus le noyau des libéraux russes des années 1990 et la première vague d’oligarques idéologiques.
Il est clair que Trump a rencontré précisément cette entité, présentée aux États-Unis et dans le monde entier comme une plate-forme inoffensive et prestigieuse pour l’échange d’opinions entre experts « indépendants ». Mais en réalité, il s’agit d’un véritable quartier général idéologique. Trump, avec son programme conservateur à l’ancienne, l’accent mis sur les intérêts américains et la critique du mondialisme, est entré en conflit direct et ouvert avec elle.
Trump n’a peut-être été président des États-Unis que pendant une brève période, mais le CFR a une histoire de plus d’un siècle qui détermine l’orientation de la politique étrangère américaine. Et, bien sûr, au cours de ses cent ans au pouvoir, le CFR a formé un vaste réseau d’influence, diffusant ses idées parmi les militaires, les fonctionnaires, les personnalités culturelles et les artistes, mais surtout dans les universités américaines, qui sont devenues de plus en plus idéologisées au fil du temps. Officiellement, les États-Unis ne reconnaissent aucune domination idéologique. Mais le réseau du CFR est hautement idéologique. Le triomphe planétaire de la démocratie, l’établissement d’un gouvernement mondial, la victoire complète de l’individualisme et de la politique de genre – tels sont les objectifs les plus emblématiques, dont il est inacceptable de s’écarter.
Le nationalisme de Trump, son programme America First et ses menaces de « drainer le marais mondialiste » représentaient un défi direct à cette entité, gardienne des codes du libéralisme totalitaire (comme de toute idéologie).
Tuer Poutine et Trump
Peut-on considérer le CFR comme une société secrète? Difficilement. Bien qu’il privilégie la discrétion, il opère ouvertement, en règle générale. Par exemple, peu de temps après le début de l’opération militaire spéciale russe, les dirigeants du CFR (Richard Haass, Fiona Hill et Celeste Wallander) ont ouvertement discuté de la faisabilité d’un assassinat du président Poutine (une transcription de cette discussion a été publiée sur le site officiel du CFR). L’État profond américain, contrairement à l’État turc, pense à l’échelle mondiale. Ainsi, les événements en Russie ou en Chine sont considérés par ceux qui se considèrent comme le futur gouvernement mondial comme des « affaires intérieures ». Et tuer Trump serait encore plus simple – s’ils ne pouvaient pas l’emprisonner ou l’exclure des élections.
Il est important de noter que les loges maçonniques ont joué un rôle clé dans le système politique américain depuis la guerre d’indépendance des États-Unis. En conséquence, les réseaux maçonniques sont étroitement liés au CFR et servent d’organismes de recrutement pour eux. Aujourd’hui, les mondialistes libéraux n’ont plus besoin de se cacher. Leurs programmes ont été pleinement adoptés par les États-Unis et l’Occident dans son ensemble. À mesure que le « pouvoir secret » se renforce, il cesse progressivement d’être secret. Ce qui devait autrefois être protégé par la discipline du secret maçonnique est désormais devenu un programme mondial ouvert. Les francs-maçons n’ont pas hésité à éliminer physiquement leurs ennemis, même s’ils n’en parlaient pas ouvertement. Aujourd’hui, ils le font. C’est la seule différence.
Les néoconservateurs : des trotskistes aux impérialistes
Le deuxième centre de l’État profond sont les néoconservateurs. À l’origine, il s’agissait de trotskistes qui détestaient l’Union soviétique et Staline parce que, selon eux, la Russie n’avait pas construit un socialisme international mais un socialisme « national », c’est-à-dire un socialisme dans un seul pays. En conséquence, selon eux, une véritable société socialiste n’a jamais été créée, et le capitalisme n’a pas été pleinement réalisé. Les trotskistes croient que le véritable socialisme ne peut émerger qu’une fois que le capitalisme est devenu planétaire et a triomphé partout, mélangeant de manière irréversible tous les groupes ethniques, peuples et cultures tout en abolissant les traditions et les religions. C’est seulement alors (et pas avant) que viendra le temps de la révolution mondiale.
Les trotskistes américains en ont donc conclu qu’ils devaient aider le capitalisme mondial et les États-Unis en tant que porte-étendard, tout en cherchant à détruire l’Union soviétique (et plus tard la Russie, son successeur), ainsi que tous les États souverains. Le socialisme, pensaient-ils, ne pouvait être que strictement international, ce qui signifiait que les États-Unis devaient renforcer leur hégémonie et éliminer leurs adversaires. Ce n’est qu’une fois que le Nord riche aura établi une domination complète sur le Sud appauvri et que le capitalisme international régnera partout en maître que les conditions seront mûres pour passer à la phase suivante du développement historique.
Pour exécuter ce plan diabolique, les trotskistes américains ont pris la décision stratégique d’entrer dans la grande politique – mais pas directement puisque personne aux États-Unis n’a voté pour eux. Au lieu de cela, ils ont infiltré les principaux partis, d’abord par l’intermédiaire des démocrates, puis, après avoir pris de l’ampleur, également par l’intermédiaire des républicains.
Les trotskistes ont ouvertement reconnu la nécessité de l’idéologie et ont considéré la démocratie parlementaire avec dédain, la considérant simplement comme une couverture pour le grand capital. Ainsi, aux côtés du CFR, une autre version de l’État profond s’est formée aux États-Unis. Les néoconservateurs n’ont pas affiché leur trotskisme mais ont plutôt séduit les militaristes américains traditionnels, les impérialistes et les partisans de l’hégémonie mondiale. Et c’est contre ces gens, qui jusqu’à Trump avaient pratiquement dominé le Parti républicain, que Trump a dû lutter.
La démocratie est une dictature
Dans un certain sens, l’État profond américain est bipolaire, c’est-à-dire qu’il possède deux pôles :
1) le pôle mondialiste de gauche (CFR)
et
2) le pôle mondialiste de droite (les néoconservateurs).
Les deux organisations sont non partisanes, non élues et portent une idéologie agressive et proactive qui est, par essence, ouvertement totalitaire. À de nombreux égards, elles sont alignées, ne divergeant que dans la rhétorique. Toutes deux sont farouchement opposées à la Russie de Poutine et à la Chine de Xi Jinping, et elles sont contre la multipolarité en général. Aux États-Unis, elles sont toutes deux tout aussi opposées à Trump, car lui et ses partisans représentent une version plus ancienne de la politique américaine, déconnectée du mondialisme et axée sur les questions intérieures. Une telle position de Trump est une véritable rébellion contre le système, comparable aux politiques islamistes d’Erbakan et d’Erdogan qui ont jadis défié le kémalisme en Turquie.
C’est ce qui explique pourquoi le discours autour de l’État profond a émergé avec la présidence de Trump. Trump et ses politiques ont gagné le soutien d’une masse critique d’électeurs américains. Cependant, il s’est avéré que cette position ne correspondait pas aux vues de l’État profond, qui s’est révélé en agissant durement contre Trump, en dépassant le cadre juridique et en piétinant les normes de la démocratie. La démocratie, c’est nous, a déclaré en substance l’État profond américain. De nombreux critiques ont commencé à parler d’un coup d’État. Et c’est essentiellement ce qu’il s’est passé. Le pouvoir de l’ombre aux États-Unis s’est heurté à la façade démocratique et a commencé à ressembler de plus en plus à une dictature – libérale et mondialiste.
L’État profond européen
Considérons maintenant ce que l’État profond pourrait signifier dans le cas des pays européens. Récemment, les Européens ont commencé à remarquer que quelque chose d’inhabituel se produit avec la démocratie dans leurs pays. La population vote selon ses préférences, soutenant de plus en plus divers populistes, en particulier ceux de droite. Pourtant, une entité au sein de l’État réprime immédiatement les vainqueurs, les soumet à la répression, les discrédite et les écarte de force du pouvoir. Nous le voyons dans la France de Macron avec le parti de Marine Le Pen, en Autriche avec le Parti de la liberté (FPÖ), en Allemagne avec l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) et avec le parti de Sahra Wagenknecht, et aux Pays-Bas avec Geert Wilders, entre autres. Ils remportent des élections démocratiques mais sont ensuite écartés du pouvoir.
Une situation familière ? Oui, cela ressemble beaucoup à la Turquie et au rôle de l’armée kémaliste. Cela suggère que nous avons affaire à un État profond en Europe également.
Il devient immédiatement évident que dans tous les pays européens, cette entité n’est pas nationale et fonctionne selon le même modèle. Il ne s’agit pas seulement d’un État profond français, allemand, autrichien ou néerlandais. Il s’agit d’un État profond paneuropéen, qui fait partie d’un réseau mondialiste unifié. Le centre de ce réseau se trouve dans l’État profond américain, principalement dans le CFR, mais ce réseau enveloppe aussi étroitement l’Europe.
Ici, les forces libérales de gauche, en étroite alliance avec l’oligarchie économique et les intellectuels postmodernes – presque toujours issus d’un milieu trotskiste – forment la classe dirigeante non élue mais totalitaire de l’Europe. Cette classe se considère comme faisant partie d’une communauté atlantique unifiée. Essentiellement, ils constituent l’élite de l’OTAN. Encore une fois, nous pouvons rappeler le rôle similaire de l’armée turque. L’OTAN est le cadre structurel de l’ensemble du système mondialiste, la dimension militaire de l’État profond collectif de l’Occident.
Il n’est pas difficile de situer l’État profond européen dans des structures similaires au CFR, comme la filiale européenne de la Commission trilatérale, le Forum de Davos de Klaus Schwab et d’autres. C’est à cette autorité que la démocratie européenne se heurte lorsque, comme Trump aux États-Unis, elle tente de faire des choix que les élites européennes jugent « mauvais », « inacceptables » et « répréhensibles ». Et il ne s’agit pas seulement des structures formelles de l’Union européenne. Le problème réside dans une force beaucoup plus puissante et efficace qui ne prend aucune forme juridique. Ce sont les porteurs du code idéologique qui, selon les lois formelles de la démocratie, ne devraient tout simplement pas exister. Ce sont les gardiens du libéralisme profond, qui répondent toujours durement à toute menace qui surgit de l’intérieur du système démocratique lui-même.
Comme dans le cas des États-Unis, les loges maçonniques ont joué un rôle important dans l’histoire politique de l’Europe moderne, servant de siège aux réformes sociales et aux transformations laïques. Aujourd’hui, les sociétés secrètes ne sont plus vraiment nécessaires, car elles fonctionnent depuis longtemps de manière ouverte, mais le maintien des traditions maçonniques reste une partie intégrante de l’identité culturelle de l’Europe.
Nous arrivons ainsi au plus haut niveau d’une entité antidémocratique, profondément idéologique, qui opère en violation de toutes les règles et normes juridiques et détient le pouvoir absolu en Europe. Il s’agit d’un pouvoir indirect, ou d’une dictature cachée – l’État profond européen, en tant que partie intégrante du système unifié de l’Occident collectif, lié par l’OTAN.
L’État profond en Russie dans les années 1990
La dernière chose qui reste à faire est d’appliquer le concept d’État profond à la Russie. Il est à noter que dans le contexte russe, ce terme est très rarement utilisé, voire pas du tout. Cela ne signifie pas qu’il n’existe rien de semblable à un État profond en Russie. Cela suggère plutôt qu’aucune force politique significative bénéficiant d’un soutien populaire critique ne l’a encore affronté. Néanmoins, nous pouvons décrire une entité qui, avec un certain degré d’approximation, peut être appelée « État profond russe ».
En Russie, après l’effondrement de l’Union soviétique, l’idéologie d’État a été bannie et, à cet égard, la Constitution russe s’aligne parfaitement sur les autres régimes prétendument libéraux-démocratiques. Les élections sont multipartites, l’économie est fondée sur le marché, la société est laïque et les droits de l’homme sont respectés. D’un point de vue formel, la Russie contemporaine ne diffère pas fondamentalement des pays d’Europe, d’Amérique ou de la Turquie.
Cependant, une sorte d’entité implicite et non partisane existait en Russie, en particulier à l’époque d’Eltsine. À l’époque, cette entité était désignée par le terme général de « La Famille ». La Famille remplissait les fonctions d’un État profond. Alors qu’Eltsine lui-même était le président légitime (bien que pas toujours légitime au sens large), les autres membres de cette entité n’étaient élus par personne et n’avaient aucune autorité légale. Dans les années 1990, la Famille était composée des proches d’Eltsine, d’oligarques, de responsables de la sécurité loyaux, de journalistes et d’occidentalistes libéraux de conviction. Ce sont eux qui ont mis en œuvre les principales réformes capitalistes du pays, les faisant passer au mépris de la loi, la modifiant à leur guise ou l’ignorant tout simplement. Ils n’ont pas agi uniquement par intérêt clanique, mais comme un véritable État profond: ils ont interdit certains partis, en ont artificiellement soutenu d’autres, ont refusé le pouvoir aux vainqueurs (comme le Parti communiste et le LDPR) et l’ont accordé à des individus inconnus et sans distinction, ont contrôlé les médias et le système éducatif, ont réaffecté des industries entières à des personnalités fidèles et ont éliminé ce qui ne les intéressait pas.
À cette époque, le terme « État profond » n’était pas connu en Russie, mais le phénomène lui-même était clairement présent.
Il convient toutefois de noter qu’en si peu de temps après l’effondrement du système de parti unique ouvertement totalitaire et idéologique, un État profond pleinement développé n’aurait pas pu se former de manière indépendante en Russie. Naturellement, les nouvelles élites libérales se sont simplement intégrées au réseau mondial occidental, en y puisant à la fois l’idéologie et la méthodologie du pouvoir indirect (potestas indirecta) – par le biais du lobbying, de la corruption, des campagnes médiatiques, du contrôle de l’éducation et de l’établissement de normes sur ce qui était bénéfique et ce qui était nuisible, ce qui était permis et ce qui devait être interdit. L’État profond de l’ère Eltsine qualifiait ses opposants de « rouges-bruns », bloquant préventivement les défis sérieux de la droite comme de la gauche. Cela indique qu’il existait une forme d’idéologie (officiellement non reconnue par la Constitution) qui servait de base à de telles décisions sur ce qui était bien et ce qui était mal. Cette idéologie était le libéralisme.
Dictature libérale
L’État profond n’apparaît qu’au sein des démocraties, fonctionnant comme une institution idéologique qui les corrige et les contrôle. Ce pouvoir de l’ombre a une explication rationnelle. Sans un tel régulateur supra-démocratique, le système politique libéral pourrait changer, car il n’y a aucune garantie que le peuple ne choisira pas une force qui offre une voie alternative à la société. C’est précisément ce qu’Erdoğan en Turquie, Trump aux États-Unis et les populistes en Europe ont essayé de faire – et y sont partiellement parvenus. Cependant, la confrontation avec les populistes oblige l’État profond à sortir de l’ombre. En Turquie, cela a été relativement facile, car la domination des forces militaires kémalistes était largement conforme à la tradition historique. Mais dans le cas des États-Unis et de l’Europe, la découverte d’un quartier général idéologique fonctionnant par la coercition, des méthodes totalitaires et des violations fréquentes de la loi – sans aucune légitimité électorale – apparaît comme un scandale, car elle porte un coup dur à la croyance naïve dans le mythe de la démocratie.
L’État profond repose sur une thèse cynique, dans l’esprit de La Ferme des animaux d’Orwell : « Certains démocrates sont plus démocrates que d’autres. » Mais les citoyens ordinaires peuvent y voir une forme de dictature et de totalitarisme. Et ils auraient raison. La seule différence est que le totalitarisme à parti unique opère ouvertement, tandis que le pouvoir de l’ombre qui se tient au-dessus du système multipartite est contraint de dissimuler son existence même.
Cela ne peut plus être dissimulé. Nous vivons dans un monde où l’État profond est passé d'une hypothèse issue d’une théorie du complot à une réalité politique, sociale et idéologique claire et facilement identifiable.
Il vaut mieux regarder la vérité en face. L’État profond est réel et il est sérieux.
Alexandre Douguine (Euro-Synergies, 4 novembre 2024)