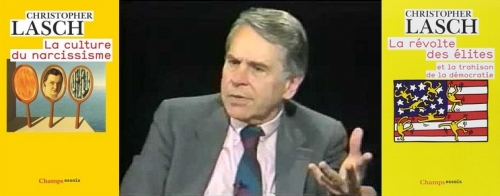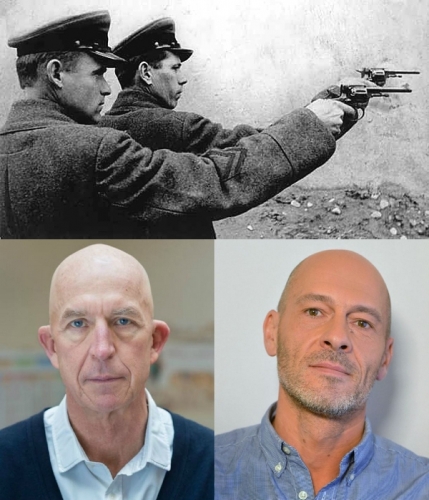Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Caroline Galactéros cueillli sur le Figaro Vox et consacré au populisme. Docteur en science politique, Caroline Galactéros est l'auteur de Manières du monde, manières de guerre (Nuvis, 2013) et intervient régulièrement dans les médias. Elle vient de créer, avec Hervé Juvin, Geopragma qui veut être un pôle français de géopolitique réaliste.

Caroline Galactéros : «Le populisme exprime l'instinct de survie des peuples»
La dénonciation d'une vague populiste planétaire, signe prétendu d'une montée des périls et de l'arrivée d'une nouvelle «peste brune» qui voudrait abattre les démocraties libérales et progressistes européennes, mais aussi américaine, brésilienne ou philippine, témoigne d'une gravissime incompréhension de la vérité même de l'expression démocratique contemporaine dans de vastes parties du monde. La solution, nous dit-on la mine grave? «Faire front»… en poursuivant la fuite en avant politicienne et la défausse technocratique. Haro sur le baudet! Tous ces apprentis dictateurs qui, en Hongrie, Pologne, République Tchèque, Autriche, Italie, aux États-Unis, aux Philippines et désormais au Brésil l'emportent sur les partis traditionnels sont les ennemis d'une «démocratie» incomprise, et leurs électeurs d'ignorantes victimes qui ne savent pas ce qu'ils font en votant pour eux.
Comme c'est commode! Gommant comme par magie toutes les turpitudes de gouvernants déchus souvent corrompus ou démagogues, qui n'ont en commun que leur arrogance et leur inefficacité dans la gestion de leurs pays respectifs, on les idéalise et l'on s'y identifie même, nous considérant immaculés et surtout «du bon côté», de celui de l'humanisme irénique, de la fin consentie des États, des nations et des frontières, du progressisme sociétal sans frein, de l'accueil d'une diversité ethnique et religieuse dont on veut ignorer la charge déstabilisatrice.
Qu'est-ce que le populisme? La crispation rétrograde de masses ignorantes et précarisées par une mondialisation qui a pris le mors aux dents et les traite comme des nombres et des ensembles, qu'il faut faire taire en leur assurant un minimum vital? Ou bien le chant malheureux et de plus en plus insistant d'un abandon ressenti et d'un refus de l'engloutissement progressif de ce qui faisait la riche diversité des nations, leur tonalité culturelle et politique spécifique et irréductible? Discréditer cette heureuse résilience, c'est se tirer une balle dans le pied. Le melting-pot américain lui-même est en souffrance. L'Amérique, nous dit-on, est en guerre civile froide… Mais le problème des démocrates américains lors de la dernière présidentielle - et l'une des causes de la défaite d'Hillary Clinton - fut de croire pouvoir gagner en misant sur le communautarisme et en segmentant furieusement le corps électoral sans percevoir son besoin de rassemblement. Trump, quels que soient ses travers et ses fautes, a su incarner ce besoin de cohésion, de destinée collective. C'est tout le génie de son «Make America great again». Ce n'est pas pour rien que ses adversaires l'accusent sans cesse de diviser le pays. Il manifeste violemment un manque de souffle collectif et ne met pas la poussière sous le tapis lénifiant de grandes déclarations creuses. Et puis, dans le cas américain, il existe encore un garde-fou: la conviction d'une vocation «impériale» et le sentiment diffus d'appartenance à une grande nation, qui sont toujours bien vivants dans la population, tandis qu'ils succombent chez nous sous les inhibitions et la repentance même de ceux qui devraient le défendre bec et ongles.
Mais ces incantations courroucées contre le danger «populiste» et la réaffirmation martiale du «no pasaran» contre des «valeurs démocratiques et républicaines» sont sans objet et seront sans effet. Et même contre-productives. Premièrement, car les mots ne valent pas action. Confusion particulièrement aiguë chez les élites françaises. Deuxièmement, car la peur n'évite pas le danger. C'est le déni de la réalité, l'ignorance et l'aveuglement qui sont dangereux, pas les réalités électorales et politiques désormais lourdes que nos Cassandre démagogues prétendent ainsi conjurer. Les peuples parlent, les peuples crient même désormais, et c'est là une preuve de vitalité démocratique, d'instinct de survie. Ils manifestent leurs angoisses identitaires, leur «insécurité culturelle» tout autant qu'économique, mais surtout leur refus de se résigner à l'indifférence et au mépris que l'on témoigne depuis trop longtemps à leur bon sens et souvent à leur clairvoyance. Ils ne supportent plus l'incurie satisfaite de ceux qui prétendent les diriger et disent les comprendre. Alors, ils votent avec leurs pieds, (comme en France), ou bien ils écoutent chaque jour d'avantage les voix qui leur promettent des «solutions» aussi radicales et simplistes fussent-elles, celles qui mettent les pieds dans le plat et abordent les questions taboues et celles qui fâchent, depuis trop longtemps délaissées par les partis traditionnels. Car ils veulent que leurs politiciens retombent sur terre, prennent la mesure de phénomènes planétaires qui menacent leur sentiment toujours vivace d'appartenance à des nations... en danger. Ils voudraient bien, quel scandale, voir émerger des leaders… dotés de leadership, d'une vision, d'une volonté de les protéger de l'insécurité culturelle mais aussi de l'insécurité tout court.
Des gros mots? Non, simplement des évidences qui gênent les utopistes et les politiciens qui depuis longtemps ont abdiqué leurs responsabilités et oublié ce que signifie précisément gouverner en démocratie: écouter, comprendre, représenter et servir les intérêts du peuple de vos mandants qui vous a délégué sa souveraineté. Servir, c'est d'abord s'oublier, totalement, penser plus grand que soi et agir par total dévouement. C'est voir loin et penser librement. C'est oser décider et affronter l'impopularité immédiate de décisions nécessaires. C'est convaincre. C'est protéger ceux qui vous ont fait confiance. C'est leur dire la vérité. C'est comprendre la complexité des mutations planétaires, qu'elles soient démographiques, économiques, culturelles, religieuses, environnementales. C'est prendre la mesure de leur signification géopolitique et de l'évolution probable des rapports de force dans lesquels il faut préserver l'intérêt national. C'est enfin parvenir à conjuguer la préservation des libertés politiques et des droits humains sans laisser la collectivité nationale se fragmenter autour de corporatismes revendicatifs qui insidieusement, privatisent peu à peu l'espace public et l'exposent à toutes les instrumentalisations internes et externes.
Gouverner, c'est donc trouver l'alchimie délicate entre libéralisme économique, progressisme tempéré et un certain conservatisme sociétal autour des notions de lien, de famille, de patrie aussi. C'est ne pas sauter à pieds joints, juste pour «être dans le coup», dans les fantasmes transhumanistes et les ruptures anthropologiques en cours, cyniquement présentées comme des vecteurs de progrès humain, en fait accélérateur de la satisfaction illimitée du tout-puissant désir des individus. Ce désir qui est une tyrannie, qui arase tout sur son passage, la famille, l'Histoire, la filiation, le cœur même de l'humanité de l'homme. Évidemment, tout cela est difficile, aléatoire, ingrat. Il est plus aisé de pratiquer frénétiquement la méthode Coué et de faire tourner les moulins à vent en stigmatisant les relents de «fascisme» au lieu de traiter enfin les problèmes.
En Europe, c'est la question migratoire qu'il faut en premier affronter, car elle est à l'origine du sentiment croissant d'insécurité culturelle. La décision d'Angela Merkel de l'été 2015 lui a coûté sa popularité mais a surtout fait se lever une immense inquiétude sur tout le continent. C'est une faute stratégique majeure. L'arrivée de formations politiques très à droite est directement liée à cet angélisme ahurissant complètement hors sol. En second lieu, il faut oser traiter sans mollir l'explosive question du rapport entre l'Islam et le socle historique, culturel et religieux européen, donc celle des conditions et proportions de leur compatibilité pratique. C'est ensuite les conditions de l'autonomisation économique de l'Europe, qui passe par un affrontement avec la prétention américaine à décider du niveau de prospérité des économies européennes comme de leur indépendance énergétique via l'imposition d'une extraterritorialité juridique léonine devenue un pur et simple avantage concurrentiel. C'est enfin décider notre sortie de l'enfance stratégique, repenser notre relation avec notre grand voisin russe, et structurer une défense européenne autonome permettant une affirmation géopolitique devenue impérative pour échapper à la tenaille américano-chinoise qui se referme lentement mais sûrement sur notre pusillanimité.
La démagogie est donc de fait l'inverse du populisme qu'il faut cesser de diaboliser. La démagogie est du côté des élites dont l'indifférence aux peurs et au bon sens des peuples est si forte qu'elle s'apparente à un silence assourdissant et conduit au «dégagisme» que l'on voit à l'œuvre partout. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. Écouter les peuples n'est pas de la démagogie. Comprendre leur besoin de leadership et de sécurité n'est pas menacer nos libertés, c'est les préserver et refuser de nous laisser dévorer en silence par un communautarisme qui va achever de fragmenter puis tuer notre démocratie.
Cessons de nous payer de mots, de nous gargariser de nos fantasmes confortables. L'indifférence des grands partis de gouvernement comme de la superstructure européenne aux craintes populaires est suicidaire. La démocratie n'est pas une statue d'airain figée dans une pureté absolue. C'est un équilibre fragile et meuble, qu'il faut sans cesse consolider en l'adaptant aux menaces qui l'attaquent et qui ne sont certainement pas l'instinct de survie des peuples exprimé fébrilement dans les urnes. La démocratie libérale occidentale doit se repenser, oser questionner ses fondements et les conditions de sa sauvegarde, de son ressourcement, qui passent notamment par des freins à mettre sur l'ultra mondialisation, qui a déclassé et fragilisé les classes moyennes, les rendant vulnérables à des discours extrémistes. Elle doit repenser son lien avec le peuple, mais aussi les notions de limite, de frontière, de droits et de devoirs. Elle est, depuis une génération surtout, devenue le creuset d'un communautarisme qui la dissout et elle a, au nom de la tolérance et du progrès humain, totalement mésestimé les dangers politiques de celui-ci et l'influence domestique, notamment sécuritaire, de problématiques géopolitiques lointaines et globales.
Si on continue de croire faire disparaître le danger en le niant, nous allons subir nous aussi un effet de boomerang difficile à dominer. Le danger en effet, c'est l'arrivée, par la voie des urnes, de partis extrémistes et démagogiques dont le discours rassure mais qui n'ont que des solutions outrancières. C'est l'expression à leur profit des instincts de repli et de fermeture de populations fragilisées. L'urgence est donc, pour les partis européens dits de gouvernement, de se reconnecter au niveau de conscience et de lucidité des peuples et d'entendre leurs craintes sans les mépriser. Car l'Europe entière, plongée dans un environnement international inquiétant qu'elle ne comprend pas ou si mal, coincée dans un idéalisme complètement dépassé, semble courir à tombeau ouvert vers son engloutissement. Ainsi faut-il redéfinir l'identité européenne en brisant les tabous et en refusant l'ouverture de notre ensemble à tous vents, car des offensives politiques et confessionnelles sont en cours qui misent sur notre manque de lucidité et notre goût immodéré pour la contrition.
Sur le plan stratégique, c'est la même chose. Nous n'avons plus d'autre choix que de sortir de l'impuissance et de cesser de galvauder la notion de souveraineté pour enfin la pratiquer. C'est valable évidemment pour l'Europe, mais déjà pour la France. Pour ne prendre qu'un exemple, celui si triste de la Syrie, quel est aujourd'hui l'intérêt de Paris à persister à défendre l'indéfendable? La France ne peut être le fossoyeur d'États laïcs. Après avoir miraculeusement su éviter de participer à la destruction de l'Irak, elle s'est fourvoyée dans une entreprise de déstabilisation régionale en Lybie et en Syrie, parfaitement contraire à ses intérêts nationaux et dont elle doit très vite se désolidariser. Elle ne peut non plus continuer, pour quelques milliards toujours dus, d'appuyer même à mi-mots, un régime saoudien dont la réalité moyenâgeuse, à mille lieues de toute modernité ou progressisme, apparaît au grand jour, rendant plus indécente encore l'indignation embarrassée de ses soutiens cyniques. La France doit être faiseur de paix. La paix concrète, la paix qui passe par la reconnaissance de la survie d'un État, la Syrie, qui ne s'est pas laissé abattre. Faire la paix, c'est d'abord reconnaître ses erreurs de jugement, ses choix politiques erronés, et prendre part à un processus constructif qui préserve nos intérêts et nos valeurs, loin des diabolisations ridicules qui ne satisfont qu'une cohorte d'intellectuels éthérés, auxquels on pourrait d'ailleurs recommander un stage in situ, à Idlib par exemple, pour enfin ouvrir les yeux et comprendre que le martyre du peuple syrien a assez duré et que rien ne le justifie plus.
Notre déni du réel devient plus que ridicule: il est tragique. Nos gouvernants doivent enfin écouter leurs mandants, reconnaître leur impéritie sécuritaire, leurs incohérences diplomatiques dont les effets sanglants se ressentent sur le territoire national, cesser d'alimenter le communautarisme en favorisant l'expression d'intérêts corporatistes et des dépendances destructrices de la cohésion nationale comme de l'enracinement multiséculaire de l'identité française sur un socle judéo-chrétien et humaniste. Dire cela n'a rien à voir avec de l'intolérance religieuse, tout à voir avec le refus de se voir dicter par l'extérieur des «canons» confessionnels, culturels ou politiques d'expression «identitaire» qui n'ont rien à voir avec la république, la laïcité, l'histoire, les valeurs et la loi françaises. Le fracas du monde doit nous éclairer. Les peuples n'ont pas tort parce qu'ils sont peuples. Ils refusent juste d'être des «populations» et des «territoires» gérés comme de simples réalités statistiques interchangeables.
Le pragmatisme, c'est une honnêteté essentielle, c'est le courage de se reconnecter au réel, ici, et là-bas, même s'il nous déplaît ou nous heurte. C'est entrer en cohérence comme on entre en religion pour conjurer le véritable danger: l'éclatement des nations sous les coups conjugués de l'ultra individualisme et du communautarisme. Réconcilier progrès et ordre, cesser de confondre autorité et autoritarisme. Revisiter le conservatisme qui n'est pas une régression mais une marque aussi d'humilité et de limite mise à l'hubris narcissique de l'homme, désormais galvanisée par les illusions technologiques. Faire des choix difficiles qui nous sauveront, sauveront notre crédit et notre ascendant moral. La lumière est au bout du chemin de cette mue douloureuse. La popularité aussi, pour celui qui saura en convaincre son peuple et en tenir l'exigence dans le temps. Il faut crever l'abcès maintenant.
Caroline Galactéros (Figaro Vox, 2 novembre 2018)