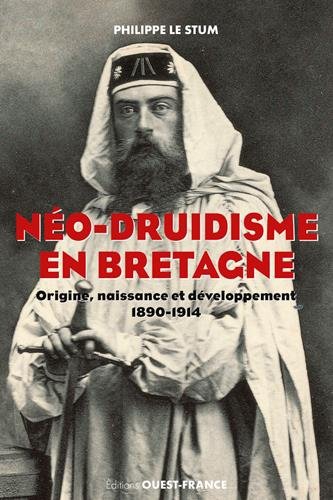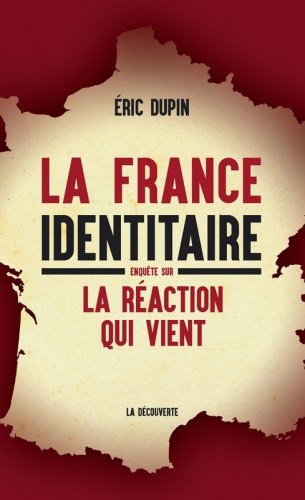L’Alt Right s’exprime !
Europe Maxima : En préalable, pouvez-vous présenter le National Policy Institute (« Institut de politique nationale ») que vous dirigez ?
Richard B. Spencer : J’ai fondé et dirige le National Policy Institute, un cercle de réflexions indépendant à but non lucratif dédié au patrimoine, à l’identité et à l’avenir des Européens aux États-Unis et dans le monde. En parallèle, j’anime aussi le Washington Summit Publishers et je suis l’éditeur – créateur de Radix Journal (RadixJournal.com). J’ai enfin cofondé le site récemment lancé Alt Right (altright.com).
Europe Maxima : Les médiats vous perçoivent comme le porte-parole de la désormais célèbre Alt Right. Or, l’Alt Right est plus une nébuleuse constituée de différentes tendances qu’un mouvement homogène. Où vous situez-vous dans cette constellation intellectuelle et politique ?
Richard B. Spencer : J’ai inventé le terme « Alt Right » en 2008 afin de me différencier des échecs du conservatisme américain dominant. Je voyais ce dernier comme une forme purement réactionnaire qui cherche à préserver le statu quo au lieu de nous concentrer sur la transmission de nos traditions ancestrales majeures aux générations futures. Je me vois en avant-garde intellectuelle de ce mouvement.
Aujourd’hui, Alt Right a pris une acception générique afin de désigner ceux qui cherchent à sortir de la postmodernité libérale qui domine les États-Unis et l’Europe par des actions culturelles, sociales et politiques. La diversité actuelle de l’Alt Right correspond à son premier stade initial. Au fur et à mesure de son développement, nous affirmerons notre message et améliorerons notre communication auprès de nos homologues hors des États-Unis.
Europe Maxima : Plusieurs acteurs de l’Alt Right paraissent influencés par la « Nouvelle Droite » française, notamment par Guillaume Faye et Alain de Benoist. En ce qui vous concerne, vous avez invité ce dernier en 2013 pour traiter de la question identitaire. Qu’avez-vous appris de la « Nouvelle Droite » et croyez-vous par ailleurs que son influence soit si importante auprès des « Alt Righters » ?
Richard B. Spencer : La « Nouvelle Droite » française a eu un impact énorme sur l’Alt Right, ainsi que les premières interprétations de la Droite en Europe continentale, de Friedrich Nietzsche aux penseurs conservateurs révolutionnaires de l’Entre-deux-guerres. L’une des raisons de cette influence est que l’Europe continentale possède une riche tradition d’intellectuels de droite alors que les États-Unis n’en ont peu, proportionnellement à leur population. Outre un certain nombre d’exceptions notables, la droite aux États-Unis réunit aujourd’hui les néo-conservateurs, les libertariens et les paléo-conservateurs qui, soit ne répondent pas aux questions essentielles sur l’identité, soit ne vont pas assez loin dans la bonne direction.
Europe Maxima : Outre la « Nouvelle Droite » et quelques penseurs célèbres tels Julius Evola et Oswald Spengler, qui sont les penseurs américains, souvent méconnus des Européens, qui influencent l’Alt Right.
Richard B. Spencer : Certains de ces penseurs notables s’appellent Sam Francis, Patrick Buchanan, Murray Rothbard et Paul Gottfried. De diverses façons, ils ont critiqué la politique étrangère de Washington, appliquée par les néo-conservateurs et les interventionnistes libéraux, qui propage le chaos. Ils s’interrogent aussi sur le déclin de l’Occident et examinent les questions d’identité.
Europe Maxima : La Lügenpresse vous dépeint en « néo-nazi suprémaciste blanc » alors que vous vous définissez comme un « race realist (réaliste racial) ». Cela signifie-t-il que vous défendez un « beau pays blanc » ou bien acceptez-vous de vivre dans un pays multiculturel tant qu’il n’y a pas de mélange racial et culturel entre ses différentes communautés ?
Richard B. Spencer : Je me considère comme un identitaire. J’ai aussi répété à plusieurs reprises que pour aller de l’avant, nous devons rejeter toutes les idéologies du passé. Les partisans du libéralisme (y compris ceux qui s’inscrivent dans la gauche mainstream) usent contre tout opposant de mots-clés émotionnellement chargés. Cela montre la puissance de ces termes destinés à clore toute discussion rationnelle. Leur emploi témoigne de l’actuelle hystérie des élites mondialistes et de leurs partisans en raison du lent changement de paradigme qui aboutit, depuis le Brexit et – surtout – l’élection et l’investiture de Trump, à un populisme axé sur l’identité. Si vous regardez les échauffourées survenues le jour de l’inauguration de Trump ou celles de Berkeley (NDT : suite à la venue de Milo Yiannopoulos, l’éditorialiste du site Breibart News à l’université de Berkley en Californie, le 1er février dernier), vous remarquerez que ceux qui ont été attaqués – verbalement et physiquement – ne sont pas seulement des personnes comme moi, aux idées audacieuses et radicales, mais aussi des conservateurs de base à la casquette rouge (NDT : le couvre-chef des supporters de Trump). Nos assaillants ne font aucune différence entre nous. La nature explicite de cette distinction ami/ennemi est excellente : nos adversaires nous sont hostiles, voire violents, ce qui devrait convertir les plus réceptifs à notre message.
Europe Maxima : Le concept de race est-il pour vous plus qu’un simple matérialisme biologique ? Et que faire face à la vacuité spirituelle et au nihilisme qui affligent l’homme blanc post-moderne ?
Richard B. Spencer : Je ne souscris pas au déterminisme biologique pur. Je crois que l’identité de chacun est un jeu complexe de nature et de culture, de l’ADN jusqu’aux interactions culturelles et sociales et, bien sûr, à la géographie – le sens de l’enracinement dans son paysage natal. Nos homologues européens doivent comprendre l’unicité du développement américain : notre société est hyper-racialisée parce que notre histoire sur ce continent inclut l’esclavage, les diverses vagues d’immigration, provenant principalement d’Europe et, plus récemment, d’autres parties du monde, la ségrégation, et ainsi de suite. Alors que certaines communautés d’immigrants plus anciennes, comme les Irlandais par exemple, perdurent, la majorité des Américains d’ascendance européenne n’est pas seulement ethniquement mélangée, mais s’identifie simplement en tant que Blancs. C’est à la fois leur réalité en termes de perception de soi et en terme d’altérité, lorsqu’ils rencontrent des membres d’autres groupes ethniques. À certains égards, cette perception est similaire pour les Américains d’origine africaine, hispanique et autres. Pourtant, alors que ces groupes minoritaires sont encouragés à maintenir leurs identités respectives par le biais de leurs propres institutions et sur l’incitation de l’État via l’« affirmative action (la discrimination positive) » dans l’éducation, les Américains d’origine européenne ne bénéficient pas de ces facilités. Il est vrai que les Américains blancs détenaient, il y a peu de temps encore, l’hégémonie sociale et culturelle et n’éprouvaient donc aucun besoin d’avoir leurs propres organisations. La combinaison de la démographie, de l’immigration et d’une sorte de « Kulturkampf » multiculturaliste nuit maintenant aux Euro-Américains.
Europe Maxima : Depuis quelques années en France, des activistes comme Laurent Ozon ont forgé le concept de « remigration », soit le retour des populations étrangères dans leur pays d’origine d’une manière pacifique grâce, par exemple, à des accords bilatéraux. Pensez-vous que quelque chose de semblable pourrait se réaliser un jour aux États-Unis ?
Richard B. Spencer : L’Alt Right n’en est qu’à ses débuts. Nous devons utiliser notre temps judicieusement plutôt qu’avoir des yeux plus gros que le ventre en se fixant des objectifs politiques pour l’heure irréalisables. Toutefois, je crois que nous devons agir de façon collective uniquement dans notre propre intérêt, ce qui exclut, par définition, ceux qui n’en font pas parti. En théorie, cela pourrait être réalisé par divers moyens pacifiques et volontaires. Je n’exclus donc pas ce concept de « remigration » de la liste des possibles.
Europe Maxima : Quelle est votre avis sur l’islam ?
Richard B. Spencer : Dans les meilleures circonstances, nous pourrions « vivre et laisser vivre ». Envisager la question de l’immigration – ou de la migration de masse – vers l’Europe et les États-Unis en y mêlant l’islam est incorrect. L’islam est pratiqué dans des régions très différentes dans le monde : les musulmans indonésiens se distinguent de ceux du Liban et du Nigéria. L’Arabie Saoudite pratique avec horreur la décapitation, tandis que les musulmans tatars en Russie sont en grande partie des adhérents laïques à la culture générique russo-européenne. Ainsi, cette question devrait-elle non seulement s’inscrire dans le sens de la religion, mais aussi selon l’ethnie, la culture et la géographie. Ceci dit, à quelques exceptions près, comme celle des communautés minoritaires autochtones historiques, les migrations musulmanes à grande échelle n’ont pas leur place en Europe. Dans le même temps, Washington et ses alliés européens doivent arrêter le chaos et la destruction qu’ils ont provoqués au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale, suscitant un flux apparemment sans fin de réfugiés de guerre et de migrants économiques, et même de terroristes. Je demeure surpris quand la question des réfugiés est débattue, presque personne – même pas les soi-disant militants gauchistes anti-guerre – ne mentionne que la meilleure solution, après l’arrêt des aides aux prétendus « rebelles modérés » et de contribuer à la lutte contre le terrorisme mondial, est la réinstallation des réfugiés accompagnée, peut-être, d’une aide à la reconstruction sur leurs propres terres ancestrales, pas en Europe ou aux États-Unis !
On se demande s’il sera possible un jour de « vivre et pouvoir vivre » avec l’islam, et non « vivre et pouvoir mourir ». J’ai suivi de loin les débats sur l’islam des années 2000. D’un côté, les libéraux (y compris George W. Bush) ont affirmé que l’islam était une « religion de paix »… De l’autre côté, des partisans conservateurs de Bush et de la « Guerre contre le terrorisme » ont assuré que l’islam était une religion de dingues vouée à installer la charia dans l’Oklahoma – ce pourquoi nous devrions nous livrer à des guerres sans fin pour la démocratie au Moyen-Orient. Inutile de dire que les deux camps se trompent. Bien que je déteste l’admettre, parce que je me suis opposé à la guerre en Irak avec beaucoup de véhémence, le côté conservateur contient un brin de vérité. L’islam – à son apogée (par exemple, l’islam wahhabite ou salafiste – l’islam en tant qu’idéologie politique) – n’est pas une confession pacifique comme le méthodisme ou le bouddhisme. L’islam arbore le pavillon noir. C’est une idéologie expansive, dominatrice, dirigée contre l’Europe. L’islam donne aux non-Européens un esprit de combat et les intègre dans un dépassement ontologique. L’islam, « civilisation » au sens de Huntington, est un grave danger pour les peuples européens.
Europe Maxima : En même temps qu’un ras-le-bol général, d’une méfiance envers les élites politiques et médiatiques et la montée du populisme, les tensions raciales et culturelles se développent de plus en plus des deux côtés de l’Atlantique. Est-ce à cause d’une crise économique et sociale, d’une crise politique, d’une crise d’identité, d’une crise de sens ou même de tout cela à la fois ?
Richard B. Spencer : La crise actuelle en Occident a des causes multiples, immédiates et profondes. La première est évidente : l’État-Providence en guerre favorise des crises à l’étranger et en accepte les conséquences (migrants et réfugiés), ce qui profite aux élites mondialistes et à leurs intérêts capitalistes transnationaux. Ce cycle perpétuel se produit dans un contexte de dégénérescence morale et culturelle marquée du passage de la culture du divertissement à la « tolérance » suicidaire. Même si c’est possible pour quelques cas, les réfugiés ne peuvent pas être assimilés, car il n’existe plus de culture viable pour les assimiler. Les résultats sont horribles. Pourtant, maintes des critiques de la présente situation ne veulent que revenir en arrière, idéalement trois ou quatre décennies en arrière, quand les choses semblaient raisonnablement « correctes », sans se poser des questions difficiles ou fondamentales. C’est une erreur. Après tout, c’est ce temps apparemment confortable qui nous a placés sur la trajectoire qui nous entraîne à la situation d’aujourd’hui. D’autres placent le déclin de l’Occident à l’ère des Lumières qui a engendré certaines des idéologies de la Modernité. D’autres encore aux origines du christianisme tandis que des penseurs (Heidegger) vont aussi loin que la Grèce antique et le « cadrage de l’être «. Nous devons donc nous poser des questions ardues : « Qui sommes-nous ? » et « Quelle est notre place dans l’histoire ? »
Europe Maxima : Croyez-vous que les concepts de gauche et de droite sont toujours valables ?
Richard B. Spencer : D’une part, le spectre politique auquel tout le monde est habitué est largement dépassé. Après l’effondrement du communisme, le libéralisme est devenu la seule idéologie debout de la modernité avec des aspirations globales, dans lesquelles la gauche et la droite traditionnelles représentent deux versions cosmétiques différentes d’une même trajectoire fondamentale. C’est ainsi de nombreux identitaires qui se définiraient eux-mêmes comme de droite, expriment un vif intérêt pour l’environnement et sa préservation, c’est-à-dire des questions traditionnellement associées au gauchisme « vert », ou bien souscrivent à une politique étrangère anti-interventionniste – une position plutôt à « gauche ». En même temps, dans un sens un peu abstrait et sémantique, on peut parler d’une Gauche et d’une Droite éternelles, quand la première correspond au mouvement horizontal, à la destruction des normes existantes, à la décentralisation, tandis que la seconde concerne l’éternité, le mouvement vertical, la centralisation, la consolidation, l’esprit créatif et la monumentalité. Ces formes sémantiques sont cycliques.
Europe Maxima : Donald Trump est finalement devenu président des États-Unis. Qu’attendez-vous de lui en matière de politique intérieure et étrangère ?
Richard B. Spencer : Mon espoir vis-à-vis de Trump reste pragmatique et donc modeste. Au mieux, il se focalisera sur les questions intérieures afin de tenter de résoudre justement à une multitude de problèmes de politique intérieure, tout en adhérant à la Realpolitik dans les relations internationales. Je ne m’attends pas à ce qu’il démantèle l’OTAN – bien que cette alliance soit une relique de la Guerre froide – à rebours des théories paranoïaques de ses adversaires. Mais il va sans dire que l’alliance doit être radicalement repensée. Pour moi, Trump est plus important en tant que symbole et type d’énergies qu’il a déchaînées plutôt que ses politiques réelles. Il a, par exemple, récemment nommé un protestant anglo-saxon, Neil Gorsuch, pour la Cour suprême. Dans la pratique, les décisions de Gorsuch vont probablement adhérer à l’examen du droit constitutionnel. Symboliquement, il représente cependant le fondateur de l’Amérique comme un État naissant, alors qu’aucune des sélections récentes n’a été représentative de celui-ci. De même, les commentaires de Trump, relatifs à une relation raisonnable avec la Russie, à l’interrogation explicite de l’immigration, donnent l’espoir d’un changement de paradigme à venir.
Europe Maxima : Comme le nom de notre site le suggère, nous défendons la Grande Europe. Quelle est votre opinion à la fois sur l’Europe en tant que civilisation et en tant que (pseudo-)structure politique et économique que l’on nomme Union européenne ?
Richard B. Spencer : Si vous regardez par exemple des cartes du Saint-Empire romain germanique dans le passé et de l’Union européenne, il y a un petit chevauchement. Cela prouve qu’il y a une vaste entité spirituelle, géographique et ethnoculturelle que nous pourrions appeler la Grande Europe. Pourtant, la forme de cette entité a été remplie de contenus différents à travers l’histoire. L’actuelle Union européenne représente tout ce qui ne va pas : de sa bureaucratie massive à ses politiques culturellement destructrices. Conclusion : la forme doit être remplie de contenus corrects en liaison avec de vraies identités et traditions européennes. J’ai exprimé mon scepticisme pour le « Brexit », ainsi que pour toutes les formes de nationalisme ethnique, c’est-à-dire ces nationalismes qui voient les autres Européens comme « l’Autre ». Qu’on le veuille ou non, les lignes de fracture du XXIe siècle – et au-delà – sont celles de la race et de la civilisation. Il faut aborder les problématiques et les crises à ce niveau. En ce sens, nous devons penser et agir de façon raciale. Reste à savoir comment exprimer exactement cet esprit identitaire en termes de structures politiques…
Richard Spencer, propos recueillis et traduits par Thierry Durolle (Europe Maxima, 12 février 2017)