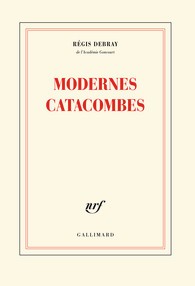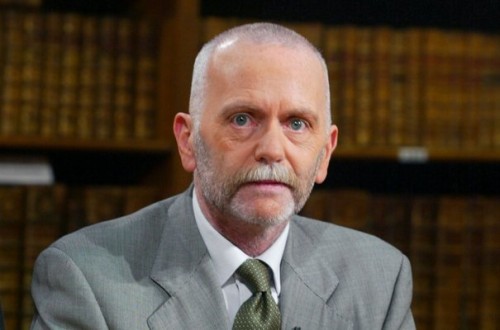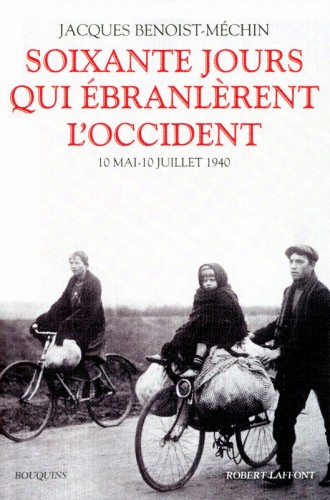Il pleut dans les couloirs du RER
La France d'aujourd'hui, c'est la Pologne des années 1980
Il y a la pauvreté d’abord. La récente « conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale » s’en est inquiétée, débouchant sur un « pacte de solidarité » annoncé par le premier ministre. Autant de jolis mots qui masquent très mal la terrible réalité : 9 millions de personnes, soit 14% de la population, vivent en dessous du seuil de pauvreté (fixé à 964 euros par mois pour une personne seule). La réalité crue de la pauvreté nous saute de plus en plus violemment à la figure. Les bidonvilles ont refait leur apparition tout le long du périphérique, le bois de Vincennes est investi été comme hiver par des sans-abris vivant sous la tente, les marchés de biffins permettent à ces pauvres de gagner 5 euros par jour en vendant de la nourriture périmée à d’autres pauvres. A côté de cette misère – très souvent d’importation –, il y a aussi la pauvreté petite bourgeoise, celle de ces Français qui vous demandent discrètement un euro ou deux pour manger, ou qui renoncent à chauffer leur logement. Ce n’est pas l’augmentation prévue du RSA qui va remédier au problème. Si le choix politique de l’assistanat marchait, ça se saurait. La préférence française pour l’assistanat est, au contraire, le terreau de la pauvreté, notamment parce qu’il encourage son importation.
Il pleut dans le RER
La pauvreté n’est pas qu’individuelle. En témoigne l’indigence des infrastructures. Certes, le TGV est formidable, mais de moins en moins de gens le prennent car son prix a explosé. L’usage d’une voiture, et même sa simple possession, étant devenu un luxe, nombreux sont ceux qui sont de fait assignés à résidence, comme l’étaient les malheureux Polonais que nous regardions avec pitié dans les années 1980.
Parlons donc des infrastructures que nous pouvons ou devons utiliser, celles du quotidien en région parisienne. Il pleut dans le RER. Non, j’exagère, il ne pleut pas encore sous terre, mais l’humidité suinte des murs et des plafonds lépreux et l’usager slalome entre les flaques et le troupeau. Le RER est plein toute la journée, mais aux heures de pointe, les gens sont traités comme du bétail. Pas comme des salers sur les pentes du massif Central, non, comme du bétail de batterie. En plus d’être inhumaines et dégradantes, les conditions de transport sont telles qu’elles sont dangereuses. Il y aura des morts un jour, et d’ailleurs il y en a déjà (agressions, « pousseurs »). Autre joie du transport, le défilé de mendiants de toute sorte qui énervent ou émeuvent (et dans le dernier cas finissent par coûter cher). Le métro de Moscou, au moins, était propre, beau et ordonné.
« Vous avez vu leur tête ? »
Et la profonde dépression qui se lit sur les visages… Où est la Parisienne des gravures de mode et celle que s’imaginent les étrangers ? Les femmes que l’on voit dans les transports en commun n’ont pas plus envie de s’habiller que les Polonaises des années 1980. Là, l’argent seul n’est pas en cause. C’est bien l’envie qui manque. L’envie de plaire, l’envie de se plaire, l’envie de se faire beau pour les autres, pour paraître en société.
A quoi bon se faire beau dans une société aussi laide ? En haut, il y a les soi-disant « élites », en fait la nouvelle nomenklatura : footeux, mannequins, acteurs, chanteurs, politiques et « grands » journalistes, en vacances d’hiver à Marrakech en leur riad. Et en dessous il y a tous les autres – même ceux qui ne s’en rendent pas encore compte – voués à des autoroutes trop chères, à des routes saturées, à des transhumances annuelles et à des séjours touristiques de plus en plus brefs. Invités à se précipiter dans des magasins encore ouverts le 23 et le 24 décembre jusqu’à minuit pour pouvoir acheter leurs « derniers cadeaux ». Il y a la consommation pour les pauvres – les cadeaux made in China achetés dans la cohue – et celle pour les riches, l’équivalent français et actuel des magasins d’Etat soviétiques et des beriozka réservées aux possesseurs de devises. La malbouffe pour le grand nombre, et la gastronomie pour les riches. En région parisienne, voit-on encore des ouvriers manger dans des petits restos ? Non, les ouvriers vont à la boulangerie s’acheter une quiche qu’ils mangent dehors, comme les étudiants, comme les « profs » (on n’ose plus parler de professeurs), comme les employés de bureau dont les tickets restaurant couvrent non pas le prix d’un resto mais celui d’une quiche et d’une boisson gazeuse à la Défense.
« C’est la débandade généralisée ! »
La pauvreté collective, c’est aussi celle des services publics en déshérence. Hôpital, école, université, police, justice, armée, la paupérisation avancée gangrène tous ces secteurs. A la poste, vous avez de la chance si vos cartes de vœux ne mettent pas plus d’une semaine à arriver et si vos colis ne sont pas ouverts et pillés. Il est un domaine toutefois où l’Etat français sait encore être efficace : le recouvrement de l’impôt, surtout sur les classes moyennes.
« Joyeuses fêtes ! »
La pauvreté collective est aussi spirituelle. Haine de soi et démoralisation imposée aux Français, avec pour résultat une défrancisation massive, manifeste dans la langue de tous les jours, les prénoms, la disparition de l’histoire de France. La belle fête de Noël est réduite à la surconsommation alimentaire et matérielle, sans plus aucune référence chrétienne. D’ailleurs le mot même de Noël, pas assez « inclusif », tend à être remplacé par celui de « fêtes ».
Big brother est partout
Et pire que tout, le mensonge permanent dans lequel nous vivons, et l’autocensure. Car la police de la pensée rôde, certes, sans violence physique, mais après tout même la Stasi utilisait plus la contrainte psychologique que la violence physique. Est-on libre quand on risque son travail ou un contrôle fiscal pour penser et surtout vouloir faire savoir que l’immigration n’est pas forcément une chance pour la France, que l’avenir européen n’est pas radieux et/ou que le pays est dirigé de façon catastrophique et irresponsable depuis 30 ans ? Pierre Sautarel a été convoqué une quinzaine de fois au commissariat en un an par des autorités qui l’accusent d’être responsable du blog fdesouche. Pour l’affaire de la mosquée de Poitiers, quatre militants ont été mis en examen et contraints à se présenter chaque semaine au commissariat de Poitiers, même quand ils habitent à l’autre bout de la France. Leur porte-parole a été viré de son école et est convoqué au commissariat le 31 décembre au soir. L’arsenal répressif est riche, entre les lois liberticides et les intimidations et vexations de toute sorte.
300 000 à 400 000 citoyens français vivent dans la capitale britannique
Et puis, il y a l’exode de tous ceux qui le peuvent : les riches, mais aussi les jeunes, et ceux qui ont un diplôme vendable à l’étranger. Le phénomène est absolument massif et n’a pas encore fait l’objet de la prise de conscience qu’il mérite. La dette, la paupérisation, les bidonvilles, même, tout cela a fait l’objet ou est en train de faire l’objet d’une prise de conscience : même le JT de France 2 en parle ! Quand les médias parlent de l’émigration – qu’ils préfèrent d’ailleurs qualifier du nom euphémisant d’expatriation – c’est pour la présenter comme un phénomène positif, et non comme la véritable sécession à bas bruit qu’elle est souvent.
La drogue, la recherche du bonheur ou le rejet de la débine ?
Pour ceux qui ne peuvent pas changer de vie, il y a aussi la fuite dans la drogue ou dans les médicaments psychotropes. Les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cannabis et les Français (surtout les femmes) sont champions du monde de la consommation d’antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Comme toujours, on accuse les médecins, qui prescrivent trop, paraît-il. Mais ne faudrait-il pas s’interroger plutôt sur le besoin auquel ces médecins répondent ?
Conclusion : les Français sont pauvres et malheureux !
Les Français vivent mal, les Français sont pauvres. Le Tiers-Monde sans le soleil, c’est ça la France d’aujourd’hui. Face à une telle dépression, il n’y a qu’une alternative : la renaissance ou le suicide. En Pologne, pendant l’Avent, il y a des chorales d’enfant, des crèches et des vendeurs de carpes à tous les coins de rue. Toute l’année, les ouvriers et les employés mangent au restaurant, dans des restaurants où la patronne fait la cuisine. Trouverons-nous notre Solidarnosc ?
Cathy Cardaillac (Polémia, 26 décembre 2012)