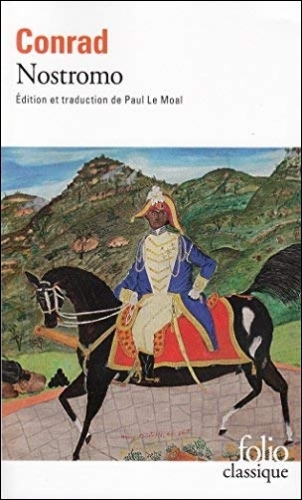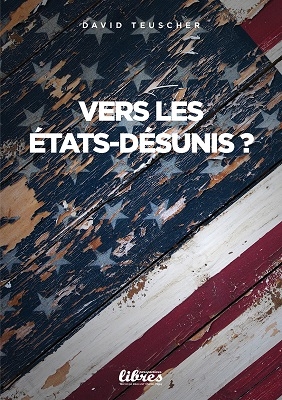Assassinat du général Qassem Soleimani : la 4e guerre mondiale a bien commencé !
L’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, revendiqué par les Etats-Unis, apporte une nouvelle preuve que la quatrième guerre mondiale a bien commencé. Nous sommes en effet entrés dans la quatrième guerre mondiale, qui a succédé à la troisième – la guerre froide. C’est une véritable guerre des mondes car elle voit s’opposer différentes représentations du monde et aussi parce qu’elle a la stabilité du monde pour enjeu.
Le monde unipolaire contre le monde polycentrique
Cette guerre oppose avant tout les Etats-Unis, de plus en plus souvent alliés à l’islamisme, qui ne comprennent pas que le monde unipolaire a cessé de fonctionner, aux civilisations émergentes de l’Eurasie – principalement la Chine, l’Inde et la Russie – qui contestent de plus en plus leur prétention à diriger le monde.
Les Etats-Unis, bras armé de la super classe mondiale, veulent en effet maintenir leur rôle dirigeant mondial, acquis après la chute de l’URSS, car ils continuent de se voir comme une « nation unique », comme n’avait pas hésité à l’affirmer encore le président Obama devant une assemblée générale des Nations Unies stupéfaite !
Même affaiblis, ils entendent conserver leur hégémonie par n’importe que moyen, y compris militaires. Avec leurs alliés occidentaux transformés en valets d’armes, ils font donc la guerre au monde polycentrique, c’est-à-dire aux cultures, aux civilisations et aux peuples qui ne veulent pas d’un monde unidimensionnel.
Monde unipolaire versus monde polycentrique, voilà la matrice de la quatrième guerre mondiale.
La dé-civilisation occidentale
Ce que l’on nomme aujourd’hui l’Occident, correspond à un espace dominé et formaté par les Etats-Unis, et n’a plus qu’un rapport lointain avec la civilisation qui l’a vu naître, la civilisation européenne.
L’Occident aujourd’hui correspond à l’espace qu’occupe l’idéologie de l’américanisme : le matérialisme, l’individualisme fanatique, le culte de l’argent, le multiculturalisme, le féminisme hystérique, le messianisme, l’idéologie libérale/libertaire, et une certaine appétence pour la violence, principalement.
Cet Occident fait la guerre aux autres civilisations, y compris à la civilisation européenne, car les « valeurs » qu’il se croit en droit de promouvoir partout par la force, sont en réalité des antivaleurs, des valeurs mortelles de dé-civilisation. Pour cette raison aussi, la civilisation européenne entre en décadence, alors que la plupart des autres civilisations renaissent au 21ème siècle
La quatrième guerre mondiale recouvre donc un affrontement civilisationnel : le choc entre les civilisations renaissantes de l’Eurasie et la culture de mort véhiculée par l’américanisme.
Et ce choc contredit la croyance cosmopolite en l’émergence d’une unique civilisation mondiale.
Le mythe américain de la paix démocratique
Depuis la chute de l’URSS, les Etats-Unis sont passés d’une stratégie d’endiguement du communisme à une stratégie d’élargissement de leur modèle de société à tous les peuples, comme l’a annoncé sans détour Bill Clinton devant l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993 : « Notre but premier doit être d’étendre et de renforcer la communauté mondiale des démocraties fondées sur le marché » [1].
Cette stratégie expansive correspond à la croyance dans la « paix démocratique » selon laquelle les Etats démocratiques seraient pacifiques par nature et parce que le modèle américain serait profitable à tous.
Mais, comme le souligne Christopher Layne [2], il s’agit d’une illusion : car rien ne vient confirmer que l’instauration de la démocratie au niveau d’un Etat annule les effets structuraux de la pluralité contradictoire des puissances et des intérêts au plan international.
Mais, surtout, la croyance dans la paix démocratique conduit nécessairement à souhaiter le renversement des Etats « non démocratiques » – les Etats-voyous selon le langage imagé nord-américain contemporain – pour que des démocraties leur succèdent. Mais cette présomptueuse volonté de changement de régime [3] – qui a beaucoup de points communs avec l’islamisme – implique une ingérence conflictuelle dans les affaires intérieures des autres Etats.
L’impérialisme de la démocratie n’a donc rien à envier au plan belliqueux à tous les autres impérialismes et ce n’est pas un hasard si dans leur courte histoire, les Etats-Unis ont été si souvent en guerre [4] !
La guerre chaotique occidentale
La quatrième guerre mondiale se déroule pour le moment principalement dans l’ordre géoéconomique : elle a pour enjeu la maîtrise des ressources énergétiques mondiales et celle des flux économiques et financiers et notamment la remise en cause de la domination du dollar, instrument de la domination globale des Etats-Unis puisqu’il leur permet de financer facilement leur arsenal militaire démesuré.
Mais elle se déroule aussi sur le terrain des guerres infra-étatiques et des « guerres civiles » internationalisées car commanditées de l’extérieur.
Depuis la fin du bloc soviétique, les Occidentaux, emmenés par les Etats-Unis, n’ont eu de cesse en effet d’encourager la destruction chaotique des puissances susceptibles de contrer leur projet de domination mondiale. Il s’agit de créer partout des poussières d’Etats impuissants et rivaux en application du vieux principe « diviser pour régner » !
La destruction de la Yougoslavie (1989-1992), suivi de la guerre illégale de l’OTAN au Kossovo (1998-1999) a constitué le coup d’envoi de la quatrième guerre mondiale.
Ces conflits ont contribué à affaiblir la périphérie de la Russie et aussi, par contre coup, à déstabiliser l’Union Européenne : désormais ingouvernable à 28 ou à 27 états et dirigée de fait par une Allemagne atlantiste, l’Union Européenne, ne compte quasiment pas sur la scène internationale comme acteur indépendant !
Encercler la Russie
De même, la fin de l’URSS n’a nullement mis fin à la politique américaine d’encerclement de la Russie. Comme on le dit parfois avec humour : « la preuve que la Russie est menaçante : elle à mis ses frontières exprès à côté des bases de l’OTAN ! »
Car il s’agit de programmer l’émiettement de la puissance russe : notamment en encourageant la sécession Tchétchène (guerre de 1994 à 2000) et en soutenant les révolutions de couleur [5] qui organisent à chaque fois la mise en place de nouvelles équipes politiques anti-russes. Et bien sûr en s’efforçant de satelliser l’Ukraine grâce à la « révolution » d’Euromaïdan (hiver 2013 à février 2014), ayant, par un heureux hasard, abouti à la destitution illégale du président Yanoukovytch qui souhaitait le maintien des relations privilégiées avec la Russie [6]. Et aussi, par contre coup, à la séparation de la Crimée et à la guerre dans le Donbass.
Le scénario Euromaïdan s’est d’ailleurs aussi reproduit en Amérique Latine : avec le renversement en 2017 du président de l’Equateur, le radical Rafael Correa en 2017 et son remplacement par un pro-occidental, Lenin Moreno ; la tentative de déstabilisation du président du Venezuela, Nicolàs Maduro en fin 2018 ; les menaces contre Ortéga Président du Nicaragua et contre Cuba [7], présentés comme « la troïka de la tyrannie » par les Etats-Unis ; le renversement du président de la Bolivie Evo Morales en 2019, suite à un coup d’état institutionnel ayant conduit à….annuler sa réélection.
La guerre civile partout !
Mais c’est au Moyen et au Proche-Orient que la stratégie chaotique occidentale est la plus aboutie.
Avec la « guerre contre le terrorisme » en Afghanistan qui dure depuis… 18 ans, la seconde guerre d’Irak (2003) ; la déstabilisation de la Lybie, menée par la France (opération Harmattan), la Grande Bretagne et l’OTAN de mars à octobre 2011 – qui a provoqué par contrecoup la « crise migratoire » de 2015 en Europe et un chaos civil qui n’en finit pas [8]– et enfin la « guerre civile » en Syrie à partir de 2011, qui se termine en 2019 avec la défaite totale de l’Etat Islamique, suite à l’intervention décisive de la Russie à partir de 2015 ; sans oublier la guerre au Yemen.
Les uns après les autres, les Etats susceptibles de constituer un pôle de puissance et de stabilité, dans une région qui représente un enjeu énergétique majeur, mais aussi une mosaïque de peuples, de religions et où aucune frontière n’est jamais sûre, ont ainsi été attaqués et durablement déstabilisés. Avec toujours le même résultat : non pas la « démocratie », mais le chaos, la guerre civile, des milliers de morts civils et la voie ouverte à l’islamisme radical. Et la mainmise américaine sur les ressources énergétiques comme en Syrie.
Comme l’écrit le géopoliticien Alexandre Del Valle, il « suffit pour s’en convaincre de voir ce que sont devenus les Etats afghan, irakien, libyen, ou même l’ex-Yougoslavie, aujourd’hui morcelée en mille morceaux «multiconflictuels» comme la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine ou le Kossovo, autant de pays déstabilisés durablement par les stratégies cyniques pro-islamistes et ou anti-russes et anti-bassistes des stratèges étatsuniens [9]».
Et toujours selon le même scénario : des bobards médiatiques à répétition (soutien du terrorisme, épuration ethnique, armes de destruction massive, utilisation de gaz contre la populationetc…) servent à présenter à l’opinion occidentale l’agression contre des Etats souverains, en violation des principes des Nations Unies, comme une opération humanitaire !
L’Iran prochaine victime ?
Les Etats-Unis n’ont jamais caché que l’Iran était le prochain sur la liste du « changement de régime ». L’assassinat du général Qassem Soleimani, revendiqué par les Etats-Unis , venant après la récusation américaine du Traité sur le nucléaire iranien et le soutien américain ostensible aux manifestations en Iran, s’inscrivent à l’évidence dans une stratégie de changement de régime en devenir.
Même s’il s’agit d’un très gros morceau à avaler.
L’Iran, avec plus de 82 millions d’habitants en 2019, retrouve en effet progressivement son rôle de puissance régionale, héritière lointaine de l’empire Perse, qu’il jouait au temps du Shah. Il dispose aussi des 4èmes réserves prouvées de pétrole et des 1ères réserves de gaz mondiales….
L’Iran chiite développe son influence politique et religieuse sur un arc qui part de sa frontière afghane pour rejoindre l’Irak, la Syrie et le Liban. Il concurrence l’islam sunnite sous domination Saoudienne et soutenu par les Etats-Unis, qui regroupe, lui, l’Egypte, la Jordanie, les Etats du Golfe et la péninsule arabique. La confrontation avec l’Iran constitue un enjeu majeur pour l’Arabie Saoudite, d’autant que sa minorité chiite se concentre dans sa région pétrolifère et aussi pour Israël.
Dans un tel contexte, un conflit, direct ou indirect, entre les Etats-Unis et l’Iran ne pourrait qu’avoir de très graves répercussions mondiales.
Les Etats-Unis, véritable Etat-voyou
Le président Trump, qu’une certaine droite adule curieusement alors qu’il embarque allègrement les Européens dans la quatrième guerre mondiale, adopte à l’évidence un comportement qui tranche avec la relative prudence de ses prédécesseurs. Même si la ligne politique de cette nation messianique reste la même.
En fait, les Etats-Unis se croient désormais tout permis, en véritable Etat-voyou : récuser les traités qu’ils ont signé, relancer la course aux armements nucléaires [10], imposer des « sanctions » unilatérales à toute la planète sans aucun mandat du conseil de sécurité des Nations Unies, espionner les communications mondiales y compris celles de leurs « alliés », s’ingérer dans les affaires intérieures des Etats, taxer arbitrairement les importations, tuer des responsables politiques et militaires étrangers sans aucune déclaration de guerre etc…
Et l’on s’étonne encore que l’image de marque des Etats-Unis et de leurs « croisés » occidentaux, décline dans le monde, en particulier dans le monde musulman ?
Comme le souligne Alexeï Pouchkov [11] , ancien président de la commission des affaires étrangères de la Douma, la présidence Trump incarne une Amérique fiévreuse et nerveuse car elle a pris conscience de sa fragilité croissante dans le monde polycentrique qui vient. Une Amérique qui se tourne aussi de plus en plus vers elle-même pour faire face à ses problèmes intérieurs croissants.
Make America Great Again – rendre l’Amérique de nouveau grande -, le slogan de campagne du candidat Trump, revient à reconnaître que, justement, l’Amérique a perdu de sa superbe alors qu’elle ne se résout pas à abandonner sa suprématie.
Une contradiction dangereuse pour la paix du monde !
Michel Geoffroy (Polémia, 7 janvier 2020)
Notes :
[1] Le 27 septembre 1993
[2] Christopher Layne « Le mythe de la paix démocratique » in Nouvelle Ecole N° 55, 2005
[3] Regime change en anglais
[4] On dénombre pas moins de 140 conflits et interventions américaines dans le monde depuis le 18ème siècle même s’ils sont évidemment d’ampleur très variables
[5] Révolution des roses en Géorgie (2003), révolution orange en Ukraine (2004) et révolution des tulipes au Kirghizstan (2005); sans oublier la deuxième guerre d’Ossétie du Sud opposant en août 2008 la Géorgie à sa province « séparatiste » d’Ossétie du Sud et à la Russie ; un conflit étendu ensuite à une autre province géorgienne , l’Abkhazie.
[6] Une Ukraine dans l’UE et dans l’OTAN provoquerait le contrôle américain de la mer Noire
[7] Après «l’empire du mal», qui désignait l’URSS dans les années 1980 et «l’axe du mal», qui qualifiait les pays réputés soutenir le terrorisme dans les années 2000, un nouveau concept est venu de Washington pour identifier les ennemis des États-Unis: c’est la «troïka de la tyrannie».Dans un discours sur la politique de Washington concernant l’Amérique latine, John Bolton, conseiller à la sécurité du Président américain a désigné en novembre 2018 : le Venezuela bolivarien de Nicolas Maduro, le Nicaragua de Daniel Ortega et Cuba, où Miguel Diaz-Canel a succédé aux frères Castro.
[8] Le pays est actuellement secoué par le conflit armé entre les forces du maréchal Khalifa Haftar, et son rival installé à Tripoli, le Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU
[9] RT France du 10 avril 2019
[10] Les Etats -Unis se sont retirés le 1er février 2019 du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (en anglais : intermediate-range nuclear force treaty INF) – signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, et l’un des grands symboles de la fin de la guerre froide – Ils se montrent déjà réticents à prolonger pour cinq ans le traité New Start – ou Start III – sur les armements nucléaires stratégiques qui, signé en 2011, arrive à échéance en 2021.Les Etats-Unis se sont aussi retirés du traité ABM en 2001
[11] Conférence de présentation de son ouvrage « Le Jeu Russe sur l’Echiquier Global » le 14 novembre 2019