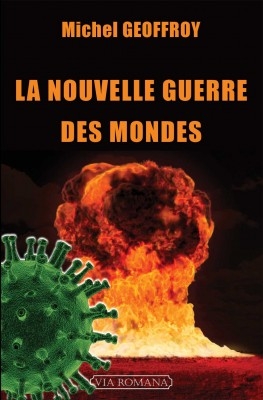Alignez-vous !
Tournant en 1943, peu avant de mourir, ses yeux vers l’après-guerre, Simone Weil a dit sa crainte qu’une fois le danger hitlérien écarté, ne survienne « une américanisation de l’Europe qui préparerait sans doute une américanisation du globe terrestre ». Elle ajoutait que dans ce cas « l’humanité perdrait son passé ».
On peut se demander si ce n’est pas la sujétion du globe à la loi du Capital, via le dollar, la world music et le Web, qui a rendu possible la mutation de l’ethos européen, mais peu importe la cause et l’effet, l’admirable Simone avait vu juste. Il n’y a plus lieu de craindre mais simplement de prendre acte que notre présent est désormais au standard, et notre passé (bien au-delà de quelques statues, mortelles comme nous tous) fort mal en point. Le processus séculaire d’absorption entamé en 1919 (avec l’arrivée à Paris du charleston et la version du Traité de Versailles en anglais exigée par le président Wilson, première entaille à la tradition séculaire du français comme langue officielle de la diplomatie) semble être parvenu non à ses fins, car n’ayant rien d’un complot, il n’en avait probablement pas, mais à sa conclusion historique.
Marée montante
La séquence américanisation achevée, nous sommes en mesure de jouir d’une américanité heureuse, devenue force tranquille et seconde nature. La romanisation de l’œkoumène entre le premier et le troisième siècle de notre ère – de la Tamise à l’Euphrate en passant par l’Afrique numide – n’a nullement pâti d’un Caligula ou d’un Héliogabale foldingue au Capitole. L’américanisation du monde occidental se moque d’un éphémère Père Ubu à la Maison-Blanche. L’écume politique est une chose, l’attraction de la lune et du soleil sur les us et coutumes en est une autre. Nous parlons ici non d’une loufoquerie passagère, mais des façons de vivre et de penser, de parler et de rêver, de protester et d’acquiescer. D’une marée montante et non d’une vaguelette au bassin des enfants.
Un phénomène d’ordre et d’envergure anthropologique n’appelle pas plus de jugement de moralité, louange ou condamnation, qu’un solstice d’été ou d’hiver. Il a suscité, dès ses prodromes, chez quelques « nez » prémonitoires, l’intérêt d’un Valéry pour la fin d’un monde en 1945, ou encore l’étonnement d’un Jean Zay (le ministre du Front populaire assassiné par la milice en 1944) débarquant du Normandie à New York en 1939 et notant dans son Journal : « quand on quittait la vieille Europe aux nerfs malades, rongée de folie fratricide, pour aborder cette Amérique éclatante de jeunesse et de puissance créatrice, toute entière tournée vers l’avenir, on comprenait que l’axe de la civilisation se déplaçait peu à peu, pour finir par passer l’Atlantique avec les prochains clippers. » La translatio imperii et studiorum est un passage obligé du devenir historique, depuis Sumer et Babylone jusqu’à l’Angleterre de la reine Victoria et les États-Unis du président Wilson, la Chine attend son tour.
Formater les autres
Chaque époque a son caput mundi, sa culture rectrice et directrice, sa civilisation la mieux dotée en capacité d’absorption et d’émission (l’une parce que l’autre), la plus apte, de ce fait, à irradier, informer, formater les autres, soit qu’elles aient vieilli, soit qu’elles peinent à naître. Les captations d’hégémonie, y compris picturale et musicale, épousent les rapports de force monétaires et militaires. Derrière Périclès, il y a l’hoplite, derrière Virgile, le légionnaire, derrière Saint-Thomas, le Chevalier, derrière Kipling, la Royal Navy et derrière Hollywood, la Silicon Valley et Marilyn Monroe, le billet vert et dix porte-avions. Il appartient aux plus gros canons de fixer à chaque reprise le canon universel du Beau, du Vrai et du Juste. Rien de nouveau dans la ritournelle. Jérémiades inutiles. C’est la loi immémoriale du Devenir. Et nous avons assez d’orgueil, ou de pudeur, pour nous voiler la marque du remorqueur qui nous a pris dans son sillage en parlant de « mondialisation ». Dans le vague, l’honneur est sauf.
Le succès d’une domination par le centre nerveux de la planète à tel ou tel moment se reconnaît à ceci qu’elle est intériorisée non comme une obligation mais comme une libération par les innervés et les énervés de la périphérie ; quand un nous exogène devient le on de l’indigène, sans marque de fabrique, sorti de nulle part et libre d’emploi. Quand M. Macron écoute La Marseillaise en mettant la main sur le cœur, quand M. Mélenchon met un genou à terre, quand Mme Hidalgo donne le plus bel emplacement parisien aux tulipes en bronze de Jeff Koons ou quand un dealer honore ses juges d’un « Votre honneur », ils n’ont pas tous conscience d’imiter qui que ce soit. Ils veulent être dans le ton.
Quand le lycée Colbert de Thionville, région Grand-Est, se rebaptise, à l’initiative du président « républicain » de la région, Rosa Parks (ou tel autre, Angela Davis), c’est sans doute pour être smart, pour faire comme tout le monde mais c’est d’abord pour vivre avec son temps, parce qu’un monde est devenu le monde. Se rebaptiser, pour ce lycée, Toussaint Louverture, Pierre Vidal-Naquet (qui mériterait le Panthéon) ou bien Sonthonax, le jacobin qui fut l’initiateur de l’abolition de l’esclavage en 1793 (ou pour un autre, Che Guevara), eut été contre-nature. Une emprise est parachevée quand on prend l’autre pour soi et soi-même pour un autre. Quand le particulier peut se faire prendre pour un universel. Quand les journaux de notre start-up nation cessent de mettre en italiques running, cluster, prime time, ou mille autres scies de notre globish quotidien.
Métamorphose
Au terme de trois siècles de romanisation, les « Barbares » ont envahi la botte italienne par amour, pour devenir enfin de vrais romains. Le souci des Pères conscrits du Mont Palatin était de freiner ce désir unanime d’assimilation, comme celui de Washington, à présent, d’empêcher les « Barbares » immigrés de devenir Américains, avec un mur au Texas et des rafles ailleurs. Ils ont peut-être tort de regarder seulement vers le Sud, en négligeant leur Occident. Après seulement cinquante ans de séries US à la télé, de Débarquement chaque soir en Normandie et de Young Leaders aux postes de commande, nos traders, nos managers, nos spin-doctors rêvent eux aussi de pouvoir s’installer à Manhattan, tout comme les membres du groupe « Sexion d’assaut » (la France est le pays où le rap, la musique la plus vendue au monde, est le plus écouté), tout comme les fans de Heavy Metal de Clisson, notre Rock City.
Avec « l’accélération de l’histoire », les délais de la translation d’axe ont raccourci. Il a fallu quatre ou cinq siècles à la Grèce pour devenir romaine (de la mort d’Alexandre à la mort de Philpœmen, « le dernier des Grecs »). Trois siècles pour transformer la romanité en chrétienté. Un siècle à la grand-mère des arts, des armes et des lois pour assimiler les normes et réflexes de l’hyperpuissance, mais comparaison est à demi-raison. Le Grec vaincu a donné pour une très longue durée sa langue aux élites victorieuses. On ne sache pas que les Marc-Aurèle de la Maison Blanche méditent dans la langue de Molière, mais la French theory, les Foucault et Baudrillard, ont trouvé bon accueil dans les universités de pointe du XXe siècle (moyennant de sérieux contresens), tout comme la physique épicurienne et la morale stoïcienne, Zénon de Cittium et Chrysippe sous les portiques romains les plus huppés du IIIe siècle.
Classer les individus d’après leur « race » ?
Il y a une originalité dans la présente phagocytose. On procédait jusqu’ici, dans tous les cas de figure (y compris, quoi qu’on ait dit du rôle des femmes et des esclaves dans la métamorphose du Romain en chrétien), du fort au faible, des centres vers les marges. La règle du jeu, pour nous, les contemporains, c’eut été qu’Homo œconimicus pour nous convertir à ses vues et ses valeurs, nous délègue ses meilleurs éléments, le haut du panier (disons, pardon pour le prosaïsme, ses Alain Minc, BHL ou Moscovici). Généralement, il y a de la résistance au nouveau, chez les retardataires. Ici, en France, c’est l’enthousiasme qui frappe. Homo academicus, réputé jadis anticonformiste, en rajoute dans le mimétisme avec nos gender et cultural studies, et fait de nos campus des annexes de Harvard ou Stanford.
La protestation antisystème s’exprime, chez les plus radicaux, dans les termes du système central, où le fin du fin consiste à classer les individus d’après leur « race », leur sexe, leur handicap physique ou leur provenance, une manie jusqu’ici réservée, dans nos provinces reculées, à l’extrême-droite. Maurras a remplacé Jaurès. Montaigne avait raison : l’histoire est une branloire pérenne. Et peu importe aux esprits avancés si la « diversité » peut servir d’alibi au maintien des inégalités économiques, conformément au nouvel esprit du capitalisme. Mettre une femme de plus, un black ou un beur dans un conseil d’administration ne change rien à l’ordre du profit maximal. Et peu importe si au jeu des minorités, tournant le dos à l’idée d’une même citoyenneté pour tous, le petit Blanc majoritaire, misogyne, homophobe et raciste, ne tardera pas à se poser en minorité victimisée, et à sortir, pour nous culpabiliser, une Tea Party de sa poche.
Mise aux normes
« L’Europe, disait Valéry dès 1930, aspire visiblement à être gouvernée par une commission américaine, tant sa politique s’y dirige ». Il ne pouvait prévoir que cette Commission serait en fait, cinquante ans plus tard, installée à Bruxelles, siège du quartier général de l’Otan, pour faire respecter les règles de la concurrence libre et non faussée entre les pays et les individus aussi, les desiderata des lobbies et la privatisation des services publics. Ce que nous, nous n’avions pas prévu, c’est que la mise aux normes s’avère aussi irrésistible dans les marges et chez les opprimés que dans le centre-ville et chez les grands patrons. Que la langue du maître – Black lives matter – devienne, sans traduction, celle de l’esclave, et son drapeau aussi. Aux États-Unis, beaucoup de manifestants, Noirs et Blancs réunis, brandissent le drapeau étoilé parce qu’ils sont fiers de leur pays auquel ils demandent d’être fidèle à ses valeurs proclamées. Ils ont encore en tête et dans leur cœur l’Amérique de Roosevelt, si chère à mon ami Stéphane Hessel auquel elle donnait toujours espoir, mais qui m’eût sans doute fait remarquer, s’il était vivant, qu’au moment où George Floyd était ignoblement asphyxié, un handicapé palestinien sur sa chaise roulante seul dans une rue de Jérusalem, était tué par balle, ce qui n’a ému personne en France. Il s’en serait, lui, ému mais sans illusion, car il est dans l’ordre des choses que ce qui se passe à New York fasse un gros titre à Paris, mais que ce qui se passe à Paris, à peine un entrefilet à New York.
Il y a une géopolitique à la verticale des événements, des mots et des images ; le haut déverse les siens vers le bas, ceux des contrebas ne remontent pas. On ne voit pas les émeutiers du Deep South brandir le drapeau tricolore, mais c’est le Star and Stripes qu’on voit brandir à domicile. Martin Luther King a mené son combat en tant que Noir et en tant que patriote, indissolublement. Là est la différence entre un centre qui aspire et des pourtours qui s’inspirent. C’est comme si, chez nous, Spartacus se dressait contre son ennemi Cassius, le consul romain, avec les codes, les images et les enseignes de Cassius (qui fera crucifier 6000 révoltés le long de la route). Les voies de la suprématie – en l’occurrence de la Manifest Destiny – sont décidément impénétrables, encore que l’Ambassade US à Paris sait donner des coups de pouce à la divine Providence en allant recruter dans les banlieues, pour des camps d’été décoloniaux et des séminaires de formation à l’antiracisme en métropole, tous frais payés. Le Nord ne perd pas le nord. Il veille à son image et à l’avenir en draguant côté Sud. Le contrôle préventif des éléments possiblement contestataires témoigne d’un remarquable sens stratégique.
Le mode de domination du XXIe siècle n’est plus militaire (sauf en cas d’urgence, au Moyen-Orient ou en Amérique latine), mais culturel. Préventif et non répressif. Surveillance en amont des communications et formatage des mentalités (les GAFA). L’imprégnation visuelle, en vidéosphère, est décisive. Aucun médiologue ne peut s’étonner de voir Minneapolis à Paris, et le Bronx dans le quartier des Grésilles, à Dijon. L’Est européen fut jadis kidnappé par l’Empire des Soviets ; l’Ouest européen est médusé par l’empire des images. Rencontrant la fibre communautaire, la fibre optique libère une charge émotionnelle, un choc catalyseur que n’auront jamais un imprimé ou un discours savant avec notes en bas de page. Elle le fait sur l’instant, en live, ce qui est irrésistible, et réduit encore plus les frais de transport et de traduction. Là où il a fallu trois décennies pour importer le identity politics (expression forgée en 1977 par des Afro-Américains), encore une dizaine d’années pour déployer à Paris la Gay Pride (inaugurée à New York en 1979), mais seulement un mois pour traduire le #metoo en #balancetonporc, c’est à présent en 24 heures que nous sont fournis le slogan et le geste qui s’imposent. Nos maîtres et magistères locaux sont ainsi pris à revers par les outils de leur maîtrise, le clip, le spot, les flashes et les news en direct. Inversion du jour et de la nuit.
Les people confisquaient la visibilité sociale à leur profit – à eux le buzz et les caméras –, et voilà que les paumés jusqu’ici invisibles, ont trouvé, en surdoués du visuel, les moyens de la voyance, et l’art de passer au journal de 20 h, avec le show-biz en garant. Les gilets jaunes et les peaux noires, les femmes à la maison et les aides-soignants, les livreurs de pizza et les derniers de cordée, les réfugiés et les sans-papiers avec leur smartphone en poche, retournent l’impolitesse aux premiers de cordée. Vous gouvernez en mode image ? Nous nous soulevons en mode image. Un prêté pour un rendu. Chapeau.
Épidémie de mea-culpa
C’est l’intelligence des exclus. Quand une nation a été construite par un État et que l’État démissionne, la nation se disloque. Plus de peuple mais des populations, c’est-à-dire des communautés, c’est-à-dire des clientèles. Les ex-colonisés, victimes de violences policières, sont alors fondés à se mettre sur les rangs, et à réclamer le respect dû autant à leurs épreuves actuelles qu’aux souffrances ancestrales, blessures inscrites au fond de l’âme des descendants d’esclaves. L’Élysée et Matignon vont avoir un agenda chargé, ironiserait un chroniqueur un peu cynique. Déjà requis par le CRIF pour s’asseoir sur la sellette et rendre des comptes aux représentants officiels de la communauté, nos gouvernants doivent désormais prévoir, outre l’assistance déjà obligatoire au Nouvel an chinois et à la rupture du jeûne, le dîner du CRAN (conseil représentatif des associations noires), celui du CFCM (conseil français du culte musulman), celui du CCOAF (conseil de coordination des organisations arméniennes de France), celui du CNEF (conseil national des évangéliques de France), en attendant les Manouches et les Tchétchènes en voie d’organisation. Épidémie de mea-culpa. Les communautés vont-elles faire la chaîne ? Du online shaming en perspective (en patois, du pain sur la planche).
L’heure n’est pas à l’ironie mais à l’embarras, du moins pour les rescapés du monde ancien encore en vie. L’anti-impérialiste aux poils blancs, toujours de mèche avec Franz Fanon et les damnés de la Terre, ne peut pas, dans un pays qui dénie son passé colonial, ne pas soutenir, dans leur colère, les brimés et les humiliés, mais il ne peut s’empêcher de voir que l’émancipation des parties s’effectue de telle façon, dans les pas et les mots du World leader, qu’elle accélère et renforce l’asservissement cybernétique du tout. Le progressiste ne peut pas ne pas voir une fieffée régression dans le remplacement de la classe par l’ethnie, des arguments de Raison par des cris du cœur, et dans son ethnie à lui, (sa petite zone de confort), du militant par le pénitent. Le laïque ne peut pas se satisfaire que ce soit la mosquée, et non la mairie, qui scelle un armistice au nom d’Allah miséricordieux entre Maghrébins et Tchétchènes. Ni voir d’un bon œil les confessions religieuses redevenir ce qu’en disait Marx – « l’expression de la misère et la protestation contre la misère, le soupir de la créature accablée, le cœur d’un monde sans cœur » –, les meetings remplacés par des réunions de prière et les programmes politiques par des sermons évangéliques, comme c’est l’usage outre-Atlantique.
Un Français, last but not least, ne peut pas sacrifier de bon cœur ses traditions provinciales de galanterie et d’amour courtois, son goût des mots à double sens, ses clins d’œil et ses bises, ses sourires ambigus à la transparence morale du puritain, et à la surveillance du vocabulaire désormais de mise dans les multinationales, pour le marketing, et bientôt dans nos rues et nos mails. C’est le malheur de la France, « la patrie de la politique », disait Marx, que d’être le pays d’Europe qui, étant donné son passé, avec ses barricades et ses salons mixtes, a le moins à gagner et le plus à perdre dans l’acculturation en voie d’achèvement.
Régime d’américanité
En régime d’américanité, il y aura comme dans ceux qui l’ont précédé, des gains et des pertes, et l’optimiste pourra nous appeler à voir, dans chaque renoncement recommandé, une mesure d’économie. On s’adapte à tout. Perdre son passé, comme dit Simone Weil, c’est sans doute embêtant pour la musique classique, une musique de Blancs, et pour l’Europe aussi. Continent habité plus qu’un autre par le temps. Il se définit usuellement par la confluence de trois héritages – le romain, avec le Droit, le grec, avec la Science et le chrétien, avec la Conscience. Voilà de bien douteux antécédents car le monde antique, un millénaire d’histoire lourd à porter, était férocement et fièrement esclavagiste et patriarcal. Rappelons-nous que le Code noir avait pour fin et premier but de forcer les esclaves des Îles à aller à la messe. Mais après tout, ne faut-il pas laisser les morts enterrer les morts, et avons-nous vraiment besoin, à l’heure du tube et de la house, du clavecin et du violoncelle, de latin et de grec, et de droit romain là où devra régner la common law ?
Perdre l’avenir sera un peu plus déprimant mais on doit l’envisager avec la même sérénité. Là où l’Origine fait un nœud coulant et rend inutile tout espoir de Dénouement, à quoi bon s’occuper du bonheur des générations futures si, born this way, les jeux sont joués dès la naissance ? Plus de deuxième chance. Le stigmate du bourgeois oppresseur n’était pas irrémédiable. On pouvait encore s’inscrire au parti communiste, rejoindre la CGT ou un maquis au Mozambique. Mais avec le « privilège de l’homme blanc » – comment se racheter ? Le dermatologue, le psychanalyste ? Et si me vient l’envie de prendre à cœur, moi, mâle blanc hétérosexuel cisgenre, la cause et les luttes de mes frères en humanité autrement équipés, je peux craindre d’être accusé de m’approprier et confisquer des souffrances qui ne me regardent pas, dans le seul but de renforcer ma pole position, dans une parfaite inauthenticité. Mais réfléchissons bien : vu les effets dévastateurs de la croyance au Progrès, et le coût en vies humaines des messianismes séculiers, n’est-il pas salutaire de renoncer au sens de l’histoire et aux utopies fatales ? De s’en tenir à l’aménagement de ce qui est, et non à la vaine poursuite de ce qui devrait ou pourrait être ?
La vision politique du monde a eu beaucoup d’inconvénients. Voyons donc le bon côté des choses. Il fallait bien refermer un jour l’ère judéo-chrétienne, avec son temps fléché, son éternelle attente d’un Messie qui ne vient jamais, ses prétentions à l’universel (dont l’entracte socialiste aura été une variante), pour la restituer à sa vérité, comme un bref moment du quaternaire supérieur. Et parmi les avantages du New deal, la nouvelle donne, n’en n’oublions pas un, dont un certain nombre d’entre nous, férus de belles phrases et d’envolées un peu creuses, pourront se féliciter : être dispensé de tout apprentissage rhétorique. Chacun devant rester sur ses rails, inutile de vouloir le convaincre d’autre chose que de ses choses à lui, sous peine d’appropriation culturelle.
"Il n’est nul besoin d’aimer le monde qui vient pour le voir venir"
Il est clair qu’il nous faut mettre à profit l’interrègne entre notre statut actuel d’État libre associé, 2020, et notre futur statut d’État fédéré de plein droit, 2120, pour se réinventer courageusement. Et commencer à mettre au point une nouvelle économie psychique, un nouvel agenda pratique, dussent-ils heurter nos préjugés, qui nous éviterait de gaspiller nos énergies dans des occupations, notamment civiques, devenues obsolètes. La class action est acquise. La discrimination positive s’impose de toute évidence ; également la fixation, dans chaque profession, de quotas ethniques, comme Charles Maurras l’avait déjà recommandé, mais aussi l’utilisation de tests génétiques préalables par les compagnies d’assurances et les entreprises, pour les avertir de toute modification chromosomique susceptible de reconsidérer les droits et avantages des assurés et employés. Des biologistes s’attellent déjà à une clarification des frontières entre peuplades – tâche difficile compte-tenu des sang-mêlés ultra-marins et autres. Nos chercheurs peuvent s’inspirer, il est vrai, des juristes allemands qui ont eu naguère à fixer les frontières exactes entre juif, demi-juif, et quart de juif. Il y a, dans ce domaine, côté national-socialiste, une expérimentation de l’infâme à ne pas négliger. Voilà quelques-unes des tâches dévolues, horresco referens, à ceux et celles qui n’hésiteront pas à tirer les saumâtres conséquences de la définition médiologique de la culture : une réponse adaptative à un milieu technique en plein chamboulement.
« Il n’est nul besoin d’aimer le monde qui vient pour le voir venir », annonçait Chateaubriand, l’enchanteur aux bonnes jumelles. Des paroles à méditer, par quiconque entend, bon gré mal gré, se mettre en ligne avec le temps assez peu aimable qu’on aimerait ne pas voir arriver jusqu’à nous.
Régis Debray (Le Carnet des médiologues, 30 juin 2020)