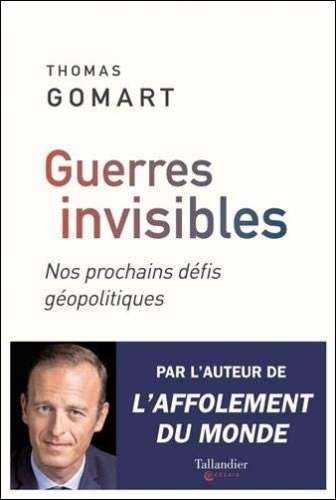Make America gentle again ?
1/ La présidence de D.Trump se terminera donc comme certaines œuvres de Shakespeare, dans le bruit et la fureur, dans un mélange de tragique et de farce où l’on ne sait plus trop qui est le bouffon et qui est son maître. De quoi donc l’Amérique est-elle désormais le nom ? Jusqu’alors elle représentait la liberté, le dynamisme et la réussite ; aujourd’hui le déferlement de cancel culture et de philosophie woke, d’un côté, l’incapacité à reconnaître ses échecs, de l’autre, associent l’Amérique au déni de réalité.
Mais les Etats-Unis ont désormais le visage de J.Biden dont la victoire a, certes dans des conditions ahurissantes, été « certifiée » par le Congrès le 6 janvier. Le 6 janvier, c’est le jour pendant lequel les Anciens fêtaient la renaissance de la lumière, source de toute vie, c’est aussi le jour pendant lequel les Chrétiens se réjouissent de la venue de Dieu au monde, venue reconnue et saluée (« certifiée », est-on tenté d’écrire) par les Rois Mages. Doit-on en conclure que J.Biden permettra, comme un autre dirigeant il y a quarante ans, de « passer de l’ombre à la lumière » et apportera l’amour à l’humanité ? Beaucoup, en Europe et particulièrement en France, l’espèrent, voire en sont persuadés.
Bien sûr, disparaîtront les tweets rageurs, les foucades inattendues et intempestives, les propos vulgaires et les accusations simplistes. Très certainement, la diplomatie sera plus policée et plus courtoise. Sans doute, les Etats-Unis respecteront davantage les accords internationaux, joueront plus que ces dernières années le jeu des organisations internationales et recourront moins au protectionnisme. Mais peut-on espérer que J.Biden fera évoluer la politique étrangère américaine d’une façon favorable à nos espoirs et nos intérêts ?
2/ Les Etats-Unis n’ont pas attendu D.Trump pour considérer que leur principale menace venait de Chine. B.Obama a cherché à manier à la fois le dialogue dans le domaine économique et l’affirmation de sa puissance aéronavale, puis D.Trump a joué la carte du protectionnisme : les deux ont largement échoué et ont même aidé la Chine à accélérer son autosuffisance et à légitimer sa montée en puissance. Quelle tactique J.Biden utilisera-t-il et celle-ci aura-t-elle davantage de succès ? Rien n’est moins certain et l’Union européenne l’a anticipé il y a quelques jours en signant avec la Chine un accord sur les investissements, montrant qu’elle avait compris qu’elle devait compter sur ses propres forces. Mais cet accord est plus de l’affichage qu’un acte engageant puisqu’il est muet sur les sujets qui handicapent le plus les entreprises européennes : la propriété industrielle, les transferts de technologie, les soutiens publics. La puissance militaire chinoise continuera de croître au moins aussi vite que le PIB du pays, la zone d’influence économique, donc politique, de la Chine continuera de s’étendre comme l’a montré en novembre la signature par quinze pays asiatiques du « Partenariat régional économique global » (RCEP) et les nouvelles routes de la soie continueront d’ouvrir les marchés européens aux entreprises chinoises ; gageons que J.Biden n’y changera pas grand-chose.
3/ Au Moyen-Orient le mandat de D.Trump s’achève en même temps qu’est franchie une étape importante de la recomposition régionale initiée par la seconde guerre du Golfe et poursuivie par le « printemps » arabe, qui ont l’une et l’autre dynamité les équilibres antérieurs. D’une part, les Emirats Arabes Unis et Bahreïn ont engagé en août un processus de reconnaissance de l’Etat d’Israël auquel le Maroc et le Soudan se sont joints et que l’Arabie Saoudite rejoindra très probablement à brève échéance. D’autre part, les monarchies du Golfe ont fait taire leurs divergences et le Qatar a été réintégré dans le Conseil de coopération du Golfe Persique. Le résultat est clair : Israël et l’Arabie Saoudite, longtemps ennemis mais ayant peu à peu fait taire leur aversion mutuelle, sont à présent les deux piliers d’une alliance régionale contre l’Iran soutenue avec force et moyens par les Etats-Unis. Subsistent cependant deux ombres à ce beau tableau : la Syrie, où la Russie et la Turquie ont empêché l’achèvement du processus de dislocation, et le besoin qu’a R.Erdogan de faire oublier ses échecs économiques par des rodomontades militaires dans les zones à population kurde et dans le bassin méditerranéen oriental. Certains mauvais esprits remarqueront que la situation des Palestiniens n’est toujours pas réglée, mais les Palestiniens n’intéressent plus personne – sauf les Iraniens bien sûr, par Hezbollah interposé, mais par sollicitude réelle ou pour disposer d’une future monnaie d’échange ?
Il est peu probable que J.Biden ait l’intention de remettre en cause cette belle construction dont les principes correspondent aux objectifs retenus par les Etats-Unis depuis au moins vingt-cinq ans, sous les mandatures démocrates comme républicaines. Il s’est certes dit, durant la campagne électorale, déterminé à réintégrer l’accord JCPOA sur le nucléaire signé en 2015 – donc lorsqu’il était Vice-président – par l’Iran, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France et dénoncé par D.Trump en 2018. Mais il a ajouté souhaiter élargir le champ de l’accord, ce qui réduit singulièrement la portée de l’intention et permettra de justifier tout échec, y compris volontaire, des négociations.
Les Français n’ont donc ici pas grand-chose à espérer de lui : bien qu’elle ait joué le rôle de supplétif américain en Syrie, la France est sortie du processus de paix en cours et l’on ne voit pas pourquoi les leçons données par E.Macron à la classe politique libanaise inciteraient J.Biden à l’y réintégrer. De même, J.Biden ne va pas reprocher au prince héritier saoudien l’accolade qu’il a donnée récemment à l’émir du Qatar bien qu’elle ait pour conséquence de permettre à ce dernier de continuer à favoriser les ambitions des Frères Musulmans en France et dans tout le pourtour méditerranéen. Enfin, il est peu probable que J.Biden accepte de lever l’embargo pesant sur l’Iran avant l’adoption d’un nouvel accord : un tel accord étant bien incertain, les entreprises françaises ne sont pas prêtes de retrouver les marchés qu’elles avaient, grâce à leurs compétences, conquis dans ce pays.
4/ C’est l’administration démocrate de B.Obama qui a officiellement reconnu que l’Europe n’est plus la priorité des Etats-Unis : en 2011 H.Clinton, alors Secrétaire d’Etat, a revendiqué un basculement vers l’Asie, l’« Asian pivot ». D.Trump n’a fait que renchérir, notamment en faisant valoir que les Européens ne dépensaient pas suffisamment pour leur propre défense. Mais l’attitude américaine est en fait plus complexe puisque les Etats-Unis ne se privent pas d’utiliser l’OTAN pour influencer la politique étrangère des pays européens et pour faire pression pour qu’ils achètent du matériel militaire américain, freinant de ce fait le développement d’une industrie d’armement européenne. On aurait pu penser que la franchise de D.Trump et ses mauvaises relations avec la chancelière allemande auraient incité les Européens à prendre davantage en main leur propre destin mais ces derniers ont préféré concentrer leurs efforts sur les mesures économiques et sur l’attribution de nouveaux pouvoirs financiers à la Commission. Bien plus, la ministre de la Défense d’Allemagne, dont on pouvait attendre qu’elle favorise l’identité européenne, d’autant que les Etats-Unis sont en train de repositionner une partie de leurs troupes stationnées dans son pays, a préféré déclarer que « l’idée d’une autonomie stratégique de l’Europe va trop loin si elle nourrit l’illusion que nous pourrions assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Europe sans l’OTAN ni les Etats-Unis ». Il est peu probable que J. Biden rompe avec la politique de ses prédécesseurs qui parvient à concilier un relatif désengagement militaire avec le maintien d’un contrôle des stratégies diplomatiques des Européens. Il continuera à pointer du doigt, comme les Démocrates le font avec constance depuis quatre ans, les accointances réelles ou supposées de D.Trump avec les responsables russes, ce qui l’aidera à présenter la Russie comme animée de la même volonté expansionniste que l’URSS : il pourra ainsi empêcher la constitution d’une Europe s’étendant de l’Atlantique à Oural, qui constituerait un troisième pôle mettant à mal le duopole sino-américain.
A l’outil militaire s’ajoute d’ailleurs l’outil juridique. En faisant condamner par la justice américaine, en application de lois américaines, des entreprises et des banques étrangères qui ont commercé avec des pays frappés d’un embargo américain, les Etats-Unis ont mis en place de manière purement unilatérale un système d’extraterritorialité du droit américain. Or ceci est l’œuvre, non de D.Trump, mais de B.Obama et Technip, Alcatel-Lucent, Total, BNP-Paribas, Alstom et le Crédit Agricole ont versé 11,4 Md$ au fisc américain entre 2010 et 2015, donc sous une présidence démocrate. Est-il raisonnable d’imaginer que J.Biden remettra en cause ce dispositif institué lorsqu’il était Vice-Président, alors même que le Congrès, avec l’adhésion des Démocrates, vient de le renforcer et de l’étendre en adoptant l’Anti-Money Laundering Act qui, au nom bien sûr de la lutte contre la corruption, permet désormais au Department of the Treasury et au Department of Justice d’accéder aux comptes des banques étrangères et, en cas de refus, d’infliger une amende à l’établissement financier récalcitrant et de lui interdire toute relation avec ses homologues américains ?
5/ Les présidents des Etats-Unis ont également fait preuve de leur capacité à promouvoir et défendre leurs grands champions économiques exerçant leur activité dans les domaines de souveraineté. Les GAFA sont devenus d’extraordinaires machines de captation des revenus publicitaires (Google et Facebook recueillent 50 % de la publicité en ligne mondiale) mais surtout des données individuelles et, comme l’actualité le montre, des instruments d’une censure collective ou privée extrajudiciaire ; incapable de faire émerger des concurrents, l’Europe n’a trouvé de solution que dans la voie fiscale mais le dernier épisode du feuilleton de la « taxe GAFA » n’est pas pour demain : les membres de l’équipe de J.Biden qui ont exercé des responsabilités dans un des GAFA ou chez Twitter seront attentifs à ce dossier, comme l’ont été leurs prédécesseurs des équipes de B.Clinton ou de B.Obama. Dans le domaine spatial, le contraste est grand entre, d’un côté Blue Origin et Space X qui, grâce aux financements apportés par la NASA, ont fait le pari des ruptures que sont la réutilisation des lanceurs et la miniaturisation des satellites, ce qui permet de réduire drastiquement les coûts, et de l’autre Arianespace qui a conçu Ariane 6 en fonction des conceptions traditionnelles ; de même, la Commission européenne a attendu décembre dernier pour annoncer la sélection de neuf entreprises chargées d’une étude de faisabilité d’un réseau de communication par satellites alors que Space X a commencé dès mai 2019 le déploiement de sa constellation Starlink dont 895 satellites avaient déjà été déployés fin octobre dernier. Dans le domaine médical enfin, il est frappant de constater que les deux premiers vaccins contre la Covid, ceux de Pfizer et de Moderna, sont américains et utilisent une technologie nouvelle, passant par l’ARN, permettant une mise sur le marché plus rapide.
Les Européens, clairement à la traîne des Etats-Unis dans ces domaines, sont toutefois en grande partie responsables de cette situation. Si les Américains ont une plus grande capacité à discerner les évolutions technologiques et à financer les initiatives disruptives, au nom de quoi pourrait-on le leur reprocher ? Les start-up françaises savent que pour se développer elles trouveront davantage de capitaux auprès d’investisseurs américains (ou chinois) qu’auprès de leurs homologues français, d’autant que, sauf dans l’aéronautique et l’énergie, les grands groupes français privés ont peu d’appétit pour les domaines de souveraineté (le luxe représente 33 % de la valorisation du CAC 40).
Si les Européens veulent corriger ce déséquilibre, ils doivent donc compter sur eux et non attendre de J. Biden une remise en cause d’un système dont les performances sont indubitables.
6/ J.Biden gouvernera très probablement selon des méthodes et avec un style qui n’auront pas grand-chose à voir avec ceux de D.Trump. Mais ses grandes orientations de politique étrangère seront-elles différentes et favoriseront-elles davantage les intérêts de la France ? C’est peu probable. Comme ses prédécesseurs, J.Biden cherchera avant tout à défendre les intérêts des Etats-Unis et c’est bien normal : il a été élu pour cela. Dans certains domaines ces intérêts sont communs avec ceux de la France, dans d’autres pas, et la venue aux affaires de J.Biden ne changera pas grand-chose à ce constat. S’imaginer que le second président catholique des USA a pour seule ambition, tel le bodhisattva Avalokiteshvara, de faire régner la compassion et l’harmonie est une vue de l’esprit.
Jean-Philippe Duranthon (Geopragma, 11 janvier 2021)