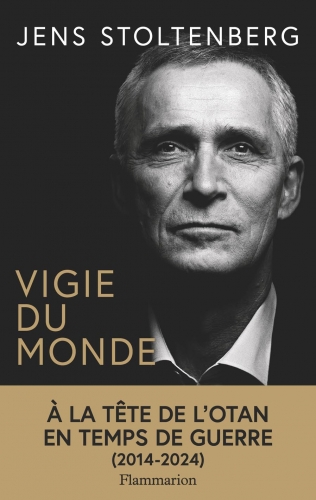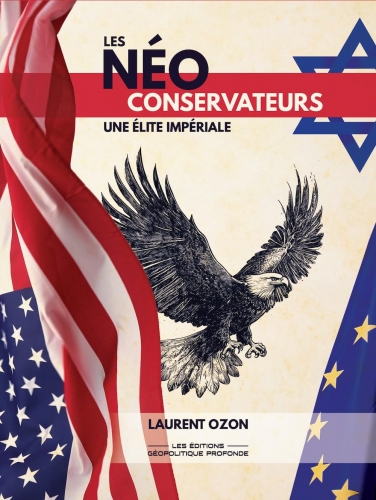Raphaël Glucksmann, l’atlanto-mondialiste qui se rêve à l’Élysée
Le 7 octobre, en pleine crise gouvernementale, Raphaël Glucksmann, conducator de Place Publique, était reçu à Matignon par Sébastien Lecornu avec toute la pompe requise, à l’instar des autres chefs des « grands » partis (à l’exception de La France insoumise et du Rassemblement national, non invités car favorables à une nouvelle dissolution) et l’on évoquait sa présence à un poste prestigieux dans le gouvernement en formation. Au même moment, une avalanche de sondages sur le premier tour de la prochaine présidentielle lui prédisait 14 à 16 % des suffrages. Ce qui ferait de lui, certes très loin de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, crédités par tous les instituts de 33 à 35 % des voix, un sérieux candidat pour le second tour puisque, au premier, son score dépasserait celui de Bruno Retailleau et de Gabriel Attal et le placerait au niveau de Jean-Luc Mélenchon ou de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il lui suffirait donc de rameuter suffisamment de bobos, de gogos et même d’aristos et de cocos pour se poser en barrage contre le « fascisme », et l’emporter avec l’aide des médias qui lui sont tout acquis.
Une Place Publique bien dépeuplée
Mais qu’est donc Place Publique, dite PP et revendiquant dix mille adhérents ? Une resucée de « Nuit debout », mais propre sur elle et débarrassée de ses oripeaux et de ses arguments trop antifas. Selon son fondateur et ses groupies (Aziliz Gouez, Caroline Kamal, Jérôme Karsenti, Thierry Kuhn, Jo Spiegel, André Aahiud, etc.), le parti articulé « autour de quatre urgences : écologique, démocratique, sociale et européenne », a vocation à se structurer sur tout le territoire français et au-delà, à travers l’Europe, à multiplier les réunions publiques, à contrer les lobbies et à bouleverser le champ politique.
Pour se consacrer à ce vaste programme, Raphaël Glucksmann avait, du reste, théâtralement renoncé, le 29 novembre 2018, à participer sur France Inter au Grand Face à face dont il était un habitué — et où il fut remplacé par Gilles Finchelstein.
Néanmoins, pour ce qui est de bouleverser le champ politique, le but fut raté : associée au Parti socialiste, PP n’obtint que deux sièges lors des élections européennes de 2019, dont un, bien sûr, pour son leader. Auxquelles les élections européennes de 2024 ne furent guère plus favorables puisque, toujours associée au PS, seuls trois sièges lui furent attribués, malgré un indécent soutien médiatique. Dû essentiellement au copinage, mais aussi à son adhésion forcenée aux thèses ukrainiennes, à son refus de condamner les atrocités commises par Tsahal dans la bande de Gaza ou la colonisation à marche forcée de la Cisjordanie, et à ses positions ultralibérales sur la tsunamigration.
Raphaël Glucksmann avait en effet défendu la création de voies d’immigration légales en Europe, proposant le développement de quotas basés sur les besoins économiques des États et la nécessité de « répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs », quitte à faire baisser les salaires. Et tant pis pour les travailleurs européens, dont se fiche d’ailleurs l’État profond américain — initiateur du wokisme — dont Glucksmann est le commis-voyageur.
Ce que pressent une partie de l’électorat, puisque Place Publique, bien que ralliée au Nouveau Front populaire, ne réussit à faire élire, aux législatives anticipées de juillet 2024, qu’un député, Aurélien Rousseau, éphémère ministre de la Santé dans le gouvernement Borne, après avoir dirigé l’Agence régionale de santé d’Île-de-France — alors même que son épouse Marguerite Cazeneuve bossait pour un laboratoire pharmaceutique, ce qui posait un problème d’éthique.
Trois eurodéputés, deux sénateurs, un seul député national et 8 % seulement des voix le 28 septembre pour le candidat de Place Publique, éliminé lors de la législative partielle dans la 5e circonscription de l’étranger. Autant dire qu’en soi, ce parti ne pèse rien. Mais il peut compter sur la médiaklatura française comme anglo-saxonne pour faire mousser cet « aventurier des temps modernes » — cf. Courrier international.
Petit-fils d’un agent de Staline
Comme nul ne l’ignore, l’avantageux Raphaël est le fils du défunt maoïste puis néo-philosophe André Glucksmann, l’un des idéologues de Mai 68 avec ses acolytes Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner, avant de verser dans le néo-conservatisme à l’instar des trotskistes américains Richard Perle, Caspar Weinberger ou Paul Wolfowitz, les boutefeux des guerres contre l’Irak sous les deux présidences Bush.
Et ses aïeux sont tout aussi intéressants. Sa grand-mère maternelle, la future philosophe Josette Colombel, issue d’une famille d’extrême gauche mais mariée à un militant de l’Action française qu’elle trompa allègrement, adhéra au Parti communiste en 1943 avant de créer, avec Jeannette Vermeersch, l’épouse de Maurice Thorez, l’Union des femmes françaises, puis quitta le PCF en 1968 pour se rapprocher de Jean-Paul Sartre et lancer le Secours rouge, rival vite oublié du Secours populaire.
Quant à son grand-père paternel, Rubin Glucksmann, né austro-hongrois dans l’actuelle Ukraine et agent de renseignement du GRU (renseignement militaire soviétique), il gagna la France en 1935, mais continua ses activités pour le Komintern au sein de la Wostwag, qui livrait du matériel aux républicains espagnols. C’est d’ailleurs en l’honneur du Petit Père des peuples que ce stalinien d’élite donna Joseph comme premier prénom à son fils André.
On comprend qu’issu d’une telle lignée, Raphaël proclame dans son pamphlet Génération Gueule de bois. Manuel de lutte contre les réacs (Allary Éditions, 2015) : « Nous sommes tous des flics juifs arabo-martiniquais, dessinateurs libertaires, prophètes clients de supérette kasher, Clarissa, Stéphane, Ahmed, Yoav ou Franck. » Et qu’il rêve du jour où « les communautés nationales, ethniques ou religieuses [vont] se dissoudre dans une acculturation planétaire émancipatrice, les individus se débarrasser des contraintes et des carcans, des églises et des partis, du temps et de l’espace, pour former une société globale libre et pacifiée » (1).
C’est donc à bon droit que Le Monde pouvait écrire le 21 mars 2014, non sans cruauté : « La révolution, c’est son rayon […] À 34 ans, Raphaël Glucksmann a fait des soulèvements nationaux son fonds de commerce. Après la Géorgie, c’est en Ukraine qu’il conseille les leaders pro-Europe […] S’il devait définir sa fonction aujourd’hui, il dirait “consultant en révolution”. “Mais ça n’existe pas” […] Se mobiliser pour une cause française, ce serait déchoir ? “Ça ne m’a jamais fait vibrer de manifester pour les retraites”, répond-il. »
Une phrase que l’intéressé regrette amèrement aujourd’hui…
Mai 68, naissance de la société black-blanc-beur
Né en 1979, le « fils Glucks » entre dans la carrière politique en 2004 en coréalisant avec quelques potes, dont David Hazan et Michel Hazanavicius (futur récipiendaire d’un Oscar pour le film The Artist), Tuez-les tous !, un documentaire frénétiquement antifrançais sur le Rwanda, où, à son initiative, l’Union des étudiants juifs de France organise dans la foulée des voyages d’études. L’année suivante, il lance de nouveaux voyages d’études, cette fois pour « sauver la culture tchétchène » menacée par le bulldozer russe. Voyages financés, selon l’AFP du 21 juillet 2005, par « des donations privées (Fondation Soros notamment) et subventions publiques (mairie de Paris, région Île-de-France) », car l’objectif est de « former une élite à la démocratie », comme l’ont fait les ONG américaines. Parallèlement, il contribue à la revue Le Meilleur des mondes, émanation du très atlantiste Cercle de l’Oratoire.
Puis, avec son père, il signe Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy (Denoël, 2008), où il proclame que, « sans son slogan le plus fou, “Nous sommes tous des juifs allemands !”, jamais [Nicolas Sarkozy] n’aurait pu être président de la République ». Dans Le Point, il confirme à ceux qui en douteraient que « 68 est une assomption du déracinement qui a donné la société “black-blanc-beur”, multiculturelle et ouverte dans laquelle nous vivons. Qu’est-ce qui symbolise mieux l’abolition des frontières que le juif errant ? »
En Géorgie, Birkin arme absolue contre Poutine
C’est justement pendant l’été 2008, quand le très américanolâtre président géorgien Mikheil Saakachvili lance une attaque contre l’Ossétie du Sud voisine, restée fidèle à Moscou, que la révolution devient réellement « son fonds de commerce ». Bernard-Henri Lévy le presse de partir, lui aussi, à Tbilissi, ce qui, dit-il, va « déclencher un virage radical dans [s]on existence ». Très bien accueilli par le gouvernement Saakachvili, formé de son propre aveu de « jeunes gens dont la double nationalité américaine, anglaise, fait ressembler Tbilissi à une Babel occidentale plantée au cœur du Caucase », il multiplie les initiatives pour narguer les Russes et ancrer les Géorgiens dans l’Occident. Par exemple, « un concert géant près de la frontière abkhaze avec Youssou N’Dour, MC Solaar et Jane Birkin, amie de la famille » — cf. Le Monde du 5 octobre 2011.
Birkin contre Poutine, il fallait y penser !
Mais il n’y a pas que la chansonnette et le rap dans la vie. Entre-temps, Raphaël Glucksmann, qui fréquente assidûment la jet-set tbilissienne, a épousé en 2009 une étoile de la nomenklatura locale, Ekaterina, dite Eka, Zgouladzé. Depuis 2004, Eka, qui a fait ses études outre-Atlantique, est au service de l’antenne géorgienne de la Millennium Challenge Corporation (MCC), un fonds de développement américain fondé par George W. Bush en 2002, conçu par le National Security Council et soutenu par sa directrice d’alors, Condoleezza Rice (plus tard patronne de la diplomatie états-unienne de 2005 à 2009, sous le second mandat du même Bush). Mais voici bientôt Mme Glucksmann bombardée vice-ministre de l’Intérieur de Géorgie, qu’elle travaille assidûment à faire intégrer à l’OTAN.
Ukraine : grandeur et décadence d’une princesse
Las, les élections législatives de 2012 puis la présidentielle de 2013 sont fatales au clan (ou au gang, tant la Géorgie est mise au pillage) de Saakachvili. Au grand dam de son conseiller spécial qui, dans Libération (du 20 avril 2015), reconnaîtra avec une certaine naïveté : « On n’a rien vu venir. On s’adressait aux citoyens comme à des actionnaires d’une entreprise nationale alors que nos adversaires parlaient à leur âme. »
Toutefois, une nouvelle aire de jeux s’offre bientôt au couple : l’Ukraine, où se multiplient les manifs de l’Euromaïdan pour l’adhésion à l’Union européenne et contre le président en place Viktor Ianoukovitch, trop proche du Kremlin. Fin 2013, Raphaël se rue à Kiev où il devient l’intime et le conseiller politique richement rémunéré du maire Vitali Klitschko, un ancien boxeur, puis de la blonde Ioulia Timochenko, ancien Premier ministre. Son obsession : convaincre les oligarques ukrainiens que, « s’ils veulent prouver qu’ils sont devenus pro-européens, ils doivent aider les autres (Biélorusses, Russes, Géorgiens) à faire leur révolution », déclare-t-il dans Le Monde du 21 mars 2014.
De son côté, son épouse renonce sans états d’âme à la nationalité géorgienne pour être à nouveau nommée vice-ministre de l’Intérieur… mais cette fois en Ukraine, dans le second gouvernement Iatseniouk !
Ekaterina Zgouladzé, qui se décrivait elle-même dans Le Figaro du 20 juin 2011 comme une patriote géorgienne et, surtout, « une princesse au comportement impeccable », n’en est pas à une contradiction près. Elle qui avait juré, en prenant ses fonctions à Kiev, de se vouer corps et âme à la lutte contre la corruption est arrêtée en décembre 2015 à l’aéroport international de Kiev-Boryspil, avec des valises pleines de billets — entre dix et quatorze millions de dollars qui, selon Vasyl Gritsak, le chef des services secrets ukrainiens (SBU), auraient été détournés des sommes allouées à la réforme… de la police, dont elle était justement chargée !
Léa Salamé : quel bonheur d’avoir un père (et une sœur) !
Le scandale épargne Raphaël Glucksmann, divorcé en 2014, rentré seul à Paris et toujours très présent dans les médias, cette fois pour son idylle avec Hala, dite Léa Salamé, étoile montante de l’audiovisuel d’État croisée dans l’émission On n’est pas couché — ça ne s’invente pas.
Mais ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Comme Raphaël est « fils de », Léa est « fille de », et tous deux appartiennent à la fine fleur du cosmopolitisme à la sauce ketchup.
Par sa mère arménienne, la Beyrouthine Léa, évidemment inscrite gamine à l’École alsacienne, où elle côtoie tous les rejetons des membres du « Siècle », la côterie « au cœur du pouvoir » décrite par Emmanuel Ratier, est issue de la dynastie Boghossian, opulents diamantaires et joailliers ayant pignon sur avenue chic de Rio à Bruxelles, où la famille a racheté le château du baron Empain. Par son père Ghassan, de confession grecque-catholique, diplômé de multiples universités dont la Sorbonne et l’université américaine de Beyrouth, ministre libanais de la Culture de 2000 à 2003 dans le gouvernement du richissime Rafiq Hariri (logeur et bienfaiteur à Paris du couple Chirac après le double mandat de celui-ci), puis derechef à partir de janvier 2025 dans le gouvernement de Nawaf Salam, elle est introduite dans tous les cénacles internationaux.
Professeur d’université, politologue et surtout lobbyiste d’élite, Ghassan Salamé, ancien Rockefeller Fellow en relations internationales, ancien guest scholar de la Brookings Institution de Washington (émanation du Council on Foreign Relations et lieu de rencontre des démocrates mondialistes), ancien conseiller spécial du Ghanéen Kofi Annan, alors président de l’ONU, puis envoyé spécial de l’ONU en Irak, ce diable d’homme trouve le temps d’enseigner au CNRS, à Paris-I et à Sciences Po Paris, où, rappelait Emmanuel Ratier, « il deviendra, en novembre 2008, le premier “joint professor” entre Sciences Po et la Columbia University dans le cadre du programme “Alliance”. Depuis septembre 2010, il dirige la Paris School of International Affairs de Sciences Po (financée par la Fondation MacArthur à hauteur de 80 000 dollars), où les cours sont dispensés en anglais et où la quasi-totalité des étudiants sont étrangers, car le programme ambitionne de former les élites mondialisées des pays émergents. »
On ne s’étonnera donc pas de liens si étroits entre Salamé père et le multimilliardaire George Soros, que ce dernier l’imposa à la direction de l’Open Society, sa fondation prétendument humanitaire, très active désormais dans l’accueil aux migrants, et comme président du conseil d’administration de l’International Crisis Group, basé à Bruxelles. Lobby mondialiste où siégeaient notamment Javier Solana, ancien secrétaire général de l’OTAN, et le général Wesley Clark, né Kanne, commandant suprême des forces alliées de l’OTAN en Europe lors de l’agression contre la Yougoslavie au printemps 1999 — c’est à cet officier qu’on doit la fameuse phrase prononcée en 2004 : « Il ne doit plus y avoir de place en Europe pour les peuples non métissés. Les peuples non mélangés appartiennent aux idées du XIXe siècle. » Une prédiction hélas en bonne voie de réalisation.
Et comme si cela ne suffisait pas, Louma, la sœur de Léa, a épousé en juillet 2011 le comte Raphaël de Montferrand, fils de l’ambassadeur de France Bernard de Faubournet de Montferrand, ce dernier ancien conseiller diplomatique du Premier ministre Édouard Balladur, puis directeur de cabinet du ministre de la Coopération Michel Aurillac, et bien évidemment membre, lui aussi, du Siècle.
Après la « princesse » Eka Zgouladzé, la sœur d’une comtesse. On voit que Glucksmann choisit bien ses compagnes.
“En marche”… vers la présidence ?
Et quand ses amours avec la seconde font accéder le petit-fils d’un agent communiste à la haute aristocratie, puisque le beau-père de Louma préside depuis 2013 l’influente Société des Cincinnati de France, regroupant les nobles descendants du marquis de Lafayette et de ses amis venus, à partir de 1777, épauler les insurgents américains contre le colonisateur anglais, société qui refusa toujours d’intégrer le parvenu Valéry Giscard d‘Estaing, c’est encore plus profitable.
Comme le sont, de l’autre côté du prisme, les gros titres des magazines people, très lus par « la ménagère de plus de 50 ans », consacrés à l’attelage Raphaël-Léa, si glamour. Surtout depuis que, heureux hasard, Salamé s’est vu offrir, en septembre dernier, par Delphine Ernotte, patronne de la télévision d’État, ce graal audiovisuel qu’est la présentation du journal vespéral de France 2. Où elle a d’ailleurs commencé en fanfare en confondant, à l’occasion du procès Sarkozy, Claude Guéant et Henri Guaino. Sans doute cette ancienne étudiante à l’université de New York connaît-elle mieux l’Establishment de la côte Est.
La visibilité de sa compagne et son aura personnelle suffiront-elles à permettre au commis-voyageur de la nouvelle révolution permanente made in US de conquérir l’Élysée lors de la prochaine présidentielle ? C’est à l’évidence son objectif, mais ses électeurs potentiels feraient bien de méditer le jugement définitif porté sur lui par François Asselineau le 1er mai 2024 : « Glucksmann est le candidat quasi officiel de l’oligarchie euro-atlantiste. Il est mentionné tous les jours de façon très positive, alors que tout le monde sait que c’est un agent américain. […] Il a été le collaborateur de l’ancien président géorgien Mikheil Saakachvili, lui-même agent de la CIA, et qui est aujourd’hui en prison. Si cela ne vous suffit pas, il suffit d’écouter ce qu’il défend. Glucksmann soutient tous les intérêts géopolitiques américains. »
Voici prévenu le peuple souverain. Si, par malheur, le « fils Glucks » succédait à Macron, la France, déjà protectorat américain grâce au « Mozart de la finance » qui brada tant de nos « pépites » industrielles à des trusts états-uniens, serait réduite à l’état de simple colonie.
Camille Galic (Polémia, 15 octobre 2025)
Note :
(1) Comme beaucoup d’autres dans cet article, cette citation est tirée des remarquables portraits que le très regretté Emmanuel Ratier, disparu le 19 août 2015 à l’âge de 57 ans, consacra dans sa lettre confidentielle Faits et Documents à Raphaël Glucksmann (nos 408, 409, 414 et 420) et à sa compagne Léa Salamé (nos 389, 409, 413 et 416 de F&D). Dix ans après la disparition de notre confrère et ami, Faits et Documents reste, comme ses livres, dont les deux tomes de Au cœur du pouvoir, annuaire très commenté des membres du Siècle paru aux éditions Facta, une inestimable mine de renseignements pillée par tous les journalistes, quelle que soit leur couleur politique.