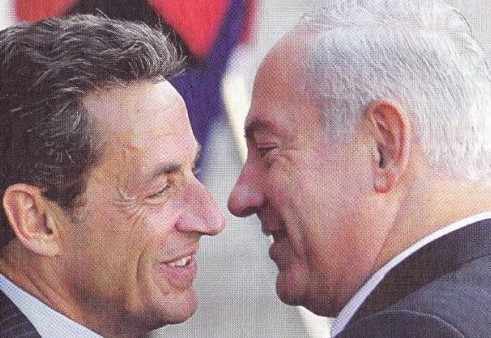Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alexandre Latsa cueilli sur le site La voix de la Russie et consacré aux appels à la guerre contre la Syrie lancés par quelques intellectuels germanopratins, dont l'ineffable Bernard-Henri Lévy...

Réponse aux intellectuels français du Café de Flore
Dans une tribune publiée le lundi 22 octobre dans le journal Le Monde, des politiques et intellectuels français ont appelé ouvertement à une intervention militaire occidentale en Syrie, pour abattre le régime de Bashar-El-Assad. Le texte, signé par Jacques Bérès, Mario Bettati, André Glucksmann, Bernard Kouchner et Bernard-Henri Lévy est l’aboutissement d’une pensée politique Occidentale, Americano-centrée, qui associe les notions de « droit d’ingérence » et « d’occident gendarme de la planète ». L’article arrondit des chiffres invérifiables. Bashar El Assad aurait fait assassiner 40.000 personnes (!), alors que ce chiffre est visiblement le total des morts, comprenant quand même les milliers de soldats Syriens et de civils assassinés par ceux que les auteurs de l’article osent qualifier « d’opposition Syrienne ». Il est sans doute inutile de revenir sur le parallèle grossier et irresponsable qui est fait entre la Syrie et la Libye, puisque désormais tout le monde sait que la Libye d’aujourd’hui ne mérite même plus le nom d’état, tellement elle est gangrenée par l’Islamisme radical, la violence et les volontés séparatistes. Il faut aussi noter, dans cet article, le ridicule parallèle historique fait entre la Russie de Vladimir Poutine qui soutient la Syrie et l’époque ou Mussolini et Hitler armaient les putschistes de Franco pendant la guerre d’Espagne. Mais les choses, observées depuis le café de Flore, paraissent simples : il faut que les puissances occidentales interviennent militairement.
Pour nos va-t-en guerre, « Le Conseil de sécurité de l'ONU étant paralysé par les vetos russe et chinois, n'importe quelle autre alliance est justifiée pour arrêter les rivières de sang qui coulent dans les villes syriennes (…) L'OTAN, l'UE, la France, les Etats-Unis devraient donc cesser de se dérober et enfin organiser une aide décisive à la Syrie démocratique ». Ceux qui s’opposent à une intervention militaire occidentale s’inquiètent eux du sort qui pourrait être réservé aux minorités chrétiennes, alaouites, druzes, ismaélites, turkmènes, arméniennes, après un changement de régime en Syrie, et des risques de déstabilisation pour les pays voisins, Turquie, Liban, Jordanie et Israël. Mais par ailleurs, le véto russo-chinois au conseil de sécurité de l’ONU est peut être bien un soulagement pour les puissances occidentales qui hésitent, face à la complexité de la situation dans la région. Est-ce qu’il s’agit du début d’un grand affrontement entre Islam chiite et Islam sunnite ? Quelles sont les rivalités entre l’Egypte, l’Arabie saoudite et la Turquie ? Quel est le rôle exact du Qatar qui vient de briser l’isolement diplomatique du Hamas dans la bande de Gaza et surtout soutient l’internationale Djihadiste qui combat l’armée Syrienne ?
Ceux qui poussent à une intervention occidentale en Syrie se servent également de l’arme médiatique pour ranger le régime syrien dans « l’axe du mal ». Tout comme la Serbie en 1992, la Syrie est elle aussi victime d’une guerre de désinformation de très haute intensité et se retrouve menacée d’une agression militaire. Mais alors qu’Alep est présentée comme une ville en ruines et en sang par toute la presse occidentale (« des rivières de sang » disent nos va-t-en-guerre), un article récent explique qu’en fait la capitale économique du pays était largement aux mains du régime et que de nombreux quartiers de la ville n’étaient même pas touchés par les combats. Mieux encore, le reporter ébahi y constate que le marché fonctionne et que la liaison par bus avec Damas n’est pas coupée. Malgré toute la propagande déployée et l’offensive subventionnée de milliers de mercenaires islamistes, ni l’attaque de Damas ni la bataille d’Alep n’ont pourtant abouti a déstabiliser le régime Syrien.
La méthode il est vrai n’est pas nouvelle, la Yougoslavie en a fait les frais de 1992 à 1999, lorsqu’elle fut attaquée elle aussi par les mêmes puissances qui menacent la Syrie aujourd’hui. Après une campagne de désinformation médiatique exemplaire, les forces croates et bosniaques furent elles aussi épaulées par des Djihadistes Islamistes acheminés dans la région via le soutien logistique et politique du département d’état américain pour combattre l’armée serbe, il y a de cela déjà 20 ans!
Depuis le démantèlement de la Yougoslavie qui n’est toujours pas terminé (Kosovo), les interventions militaires de l’occident en Irak, en Afghanistan et en Lybie n’ont pas donné de résultats probants, c’est le moins qu’on puisse dire. Ces trois pays sont déstabilisés pour longtemps, et une intervention en Syrie pourrait être lourde de conséquences. Déstabiliser toute la région, détériorer les rapports entre les occidentaux d’une part, la Russie et la Chine d’autre part, et de plus enlever toute crédibilité au conseil de sécurité de l’ONU. Alors à quoi jouent nos apprentis sorciers dans les colonnes du journal Le Monde ? Ceux-ci s’étaient faits en 1992 les apôtres de l’impardonnable alliance entre les nationalistes croates, les mercenaires arabes et les intérêts américains dans la région. Nul surprise des lors de les retrouver aujourd’hui a appeler à la croisade en Syrie et à soutenir la diabolique et désormais cyclique alliance entre les puissances occidentales et les pétromonarchies Islamiques du golfe.
Il convient de tenter de comprendre l’objectif de ces opérations militaires contre la Serbie et la Syrie et celles-ci sont très claires. Ces deux pays ont un point commun essentiel: avoir refusé l’alignement géostratégique imposé par les Occidentaux, nouveaux gendarmes du monde, et être des alliés objectifs de la Russie. Les interventions contre la Serbie et la Syrie ont donc un objectif géopolitique clair: il s’agit d’annihiler la sphère d’influence de la Russie en détruisant un à un ses alliés les plus fiables, et les plus vulnérables. Nul doute que les prochaines étapes de ce remodelage géostratégique planifié viseront l’Iran, puis la Biélorussie, les deux derniers alliés clefs de la Russie. Et ensuite?
Quel que soit le résultat de l’élection américaine, qui pourrait voir l’arrivée à la maison blanche d’un candidat ayant déclaré que la Russie était l’ennemi puis l’adversaire principal de l’Amérique, une chose est certaine, le conflit Syrien semble parti pour s’intensifier et pour durer.
Alexandre Latsa (La voix de la Russie, 30 octobre 2012)