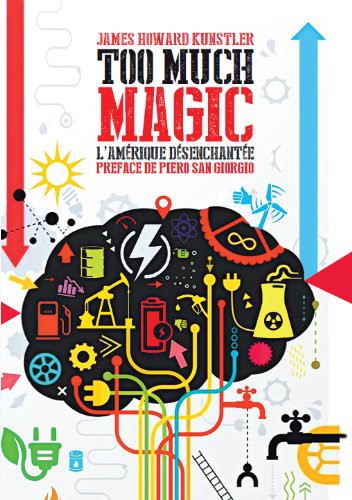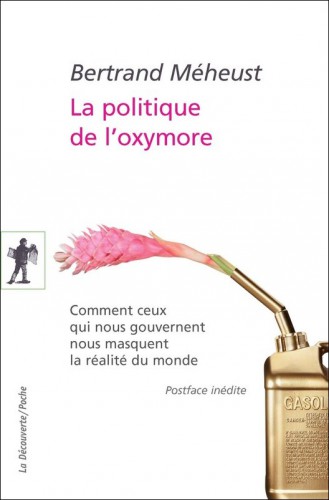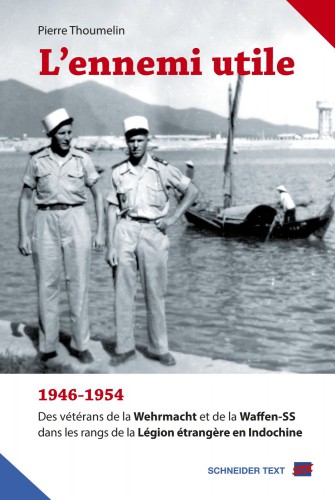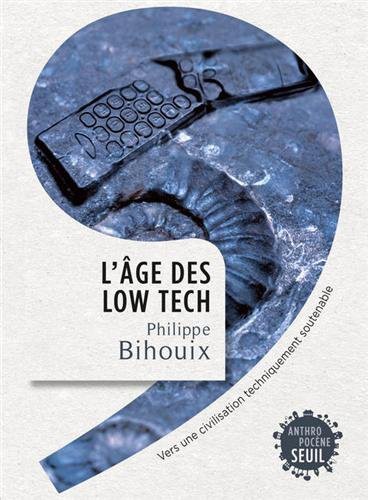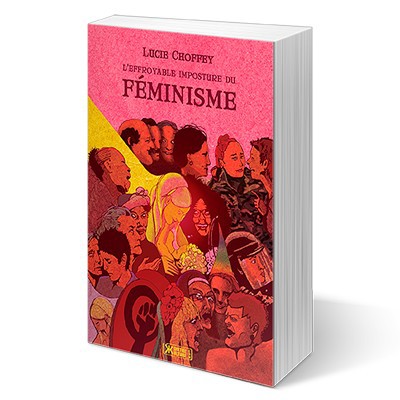Les éditions Perspectives libres viennent de publier un essai de Norman Palma intitulé Pourquoi Marx a-t-il échoué ? . Economiste et philosophe, collaborateur de la revue Perspectives Libres, Norman Palma est l'auteur avec Edourad Husson de l’ouvrage, Le capitalisme malade de sa monnaie (François-Xavier de Guibert, 2009).
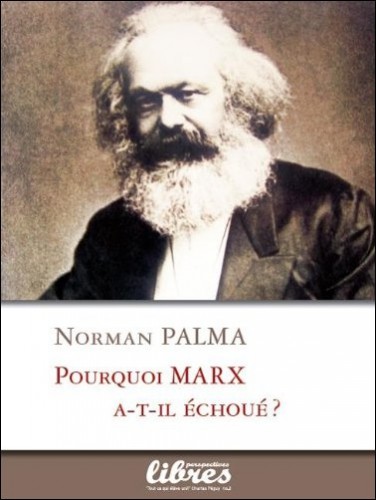
" La grande crise que nous traversons n’aurait-elle pas dû réveiller le fantôme de Marx ? Comment expliquer cette absence du maître du socialisme scientifique, au moment où le capitalisme apparaît plongé dans une crise qui pourrait s’avérer être la grande crise terminale tant attendue ? Norman Palma propose une lecture de Marx qui souligne les silences du philosophe sur l’une des questions centrales de notre temps : la monnaie.
Fils de la pensée de son temps, Marx était marqué par les derniers économistes classiques et leur théorie de la monnaie comme par un voile. Hégélien, il était en rupture avec Athènes. De ces deux filiations naquit une cécité, sur les questions monétaires, aujourd’hui criante.
Il s’agit ici d’une nouvelle lecture de Marx, pour tirer les leçons radicales de l’échec de l’expérience politique inspirée par le marxisme. A travers cette lecture, nécessaire si l’on veut sauver l’oeuvre critique de Marx, Norman Palma nous invite à un voyage philosophique où nous remontons aux racines grecques de la pensée européenne marquée par Aristote. "