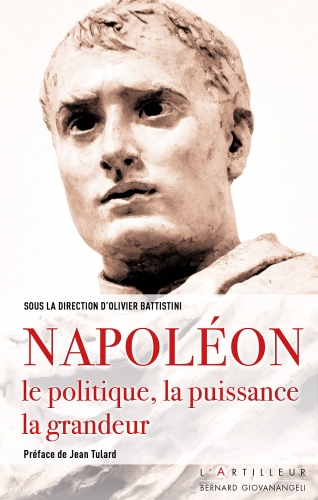Décroissance et puissance sont-elles compatibles ?
Le monde moderne a très mal compris le mythe de Prométhée. Dans le mythe grec, le titan Prométhée, après avoir dérobé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, est condamné par Zeus à être attaché à un rocher où un aigle lui dévore le foie. Plus tard, Héraclès libère Prométhée, qui se réconcilie avec Zeus et lui apprend ce dont il doit s’abstenir pour ne pas être détrôné, comme l’ont été avant lui Ouranos et Cronos. À la révolte contre le donné et ses limites, le mythe donne sa place, mais cette révolte n’est qu’un moment, inscrit dans un horizon ordonné qu’elle a fait évoluer mais dans lequel, finalement, elle se résorbe. Les modernes ne voient pas les choses ainsi. Pour eux, la révolte contre le donné n’a d’autre horizon qu’elle-même, sa vocation est d’être permanente, de se poursuivre à l’infini. La suite que les modernes donnent à Prométhée enchaîné n’est pas, comme chez Sophocle, Prométhée délivré, mais Prométhée toujours plus déchaîné.
Après quelques siècles d’un tel déchaînement, le monde naturel comme le monde humain se trouvent en piètre état. Le monde naturel : de nos jours, l’humanité est en passe d’épuiser des ressources qui avaient mis des millions d’années à se constituer et sollicite trop la nature pour que celle-ci parvienne encore se régénérer. Hésiode, dans sa Théogonie, parlait de « Gaïa aux larges flancs, assise sûre à jamais offerte à tous les vivants » : aujourd’hui, la pauvre Gaïa n’en peut plus. Trop martyrisée, elle risque de devenir stérile. Au demeurant, les progressistes qui, naguère encore, promettaient, grâce à l’empire humain sur la nature, l’advenue du paradis sur terre, reconnaissent eux-mêmes le caractère critique de la situation. Un exemple parmi d’autres : pour promouvoir le maillage du territoire par la 5G, le président Emmanuel Macron ne prétend pas que ladite 5G améliorera notre condition, mais qu’elle est nécessaire pour relever les « défis que nous avons sur tous les secteurs », indispensable pour affronter « la complexité des problèmes contemporains [1] ». Plus question, on le voit, de lendemains qui chantent : seulement de survivre, par l’innovation technologique, aux « défis » et à la « complexité des problèmes » légués par les progrès antérieurs.
Le monde naturel n’est pas le seul à être menacé, abîmé. L’état du monde humain est tout aussi grave. Du fait qu’il appartient à la vocation humaine de prendre ses distances d’avec la nature, certains en ont déduit que plus l’homme s’éloignait de la nature, plus il était humain. L’être humain, cependant, n’est pas seulement un être d’arrachement, il est aussi un être de lien. Pour reprendre une expression de Péguy : l’arrachement doit demeurer raciné. On peut se rappeler, une fois encore, un mythe grec, celui du géant Antée, invulnérable tant que ses pieds touchaient le sol, et qu’Héraclès étouffa en le soulevant de terre. Les peuples sont comme Antée : quand les modes de vie s’artificialisent à outrance, ils meurent en tant que peuples. Ils se défont en amas d’individus et de groupes antagonistes, sans héritage ni héritiers.
Des individus non seulement privés, de par la dissolution des peuples qui, du même coup, dissout l’existence politique, d’une dimension essentielle de l’humanité, mais qui de plus, en tant qu’individus, n’ont pas fière allure. Des individus très à cheval sur leurs « droits », mais complètement dépendants, dans tous les aspects de leur vie, du dispositif général en dehors duquel ils ne savent plus rien faire. Prenons, à titre d’exemple paradigmatique, la numérisation de tout, dont le président de la République nous dit qu’elle est impérative pour relever les « défis que nous avons sur tous les secteurs » : la 5G ne fera pas qu’augmenter par cent ou mille le débit des données, elle rendra les individus encore plus impotents en dehors d’un branchement continu au réseau, elle accélérera la baisse déjà avérée des capacités physiques (qui, chez les jeunes, ont décru d’un quart en quarante ans, selon une étude relayée par la fédération française de cardiologie), et des capacités intellectuelles (le QI moyen baisse depuis vingt ans).
Pour conjurer ces maux, on ne voit d’autre solution sensée que de mettre certaines limites au déploiement technologique – ce qui implique, l’exubérance technologique étant le principal « moteur de la croissance », une forme de décroissance. Reprocher à une telle attitude son caractère « négatif » est stupide : c’est comme si, à quelqu’un qui a atteint 150, 200, 250 kilos, il fallait s’abstenir de conseiller une cure d’amaigrissement parce que « perdre du poids » est une idée négative. Il ne s’agit pas de maigrir pour maigrir, mais de maigrir pour retrouver la santé. Cela étant, la méthode présente un sérieux inconvénient. Il se trouve que, depuis deux siècles, le « développement » économico-techno-industriel est le principal dispensateur de puissance. D’où le risque encouru par tout groupe humain qui s’engagerait dans la décroissance, pendant qu’autour de lui d’autres groupes persévéreraient sur la voie de ce qu’on appelle la croissance : le danger de se trouver dominé, asservi, écrasé par eux. Il n’est, pour mesurer l’ampleur de la menace, que de songer au sort des peuples qui, au XIXe siècle, vivaient tranquillement sur leurs territoires et selon leurs coutumes traditionnelles, et se trouvèrent brutalement colonisés, simplement parce que les moyens dont ils disposaient ne leur permettaient pas de contrer la puissance de leurs assaillants, armés par la technique moderne. L’industrialisation fulgurante du Japon, à partir de l’ère Meiji, fut la conséquence directe d’un constat : sans la puissance de la technique moderne, le Japon serait irrémédiablement asservi. Du côté chinois, voici ce qu’un lettré, en 1899, écrivait à un missionnaire jésuite : « Les superbes inventions des pays occidentaux nous sont, pour la plupart, inconnues et nous semblent incroyables… Mais, mon grand frère, peut-être allez-vous demander si toutes ces choses presque miraculeuses rendent les hommes plus heureux ? C’est une question très difficile à résoudre. Je ne sais pas ! Tout ce que je sais, c’est que ces machines travaillent cent fois plus vite que le manœuvre. Vous allez me demander si la vitesse est un bonheur… Je ne sais pas. Je suis seulement persuadé que sans ces inventions techniques et cette vitesse, on ne peut acquérir aucune puissance. Si on ne l’atteint pas, on reste plongé dans l’humiliation. Si l’on veut pouvoir se défendre, il faut absolument être en possession de cette science matérielle. Et c’est tout [2]. » Pour les Chinois, la période qui s’étend des années 1840, avec la première guerre de l’opium, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, est le siècle de l’humiliation. On ne peut pas comprendre la frénésie technologico-croissantiste qui s’est emparée de la Chine si on ne se rappelle pas de tels faits. Telle est notre situation : tout « retard » pris dans le processus de transformation du monde enclenché depuis deux siècles expose aux menées des plus « avancés », toute indifférence à l’égard de la croissance expose au danger d’être assujetti à ceux qui y vouent toutes leurs forces.
On voit donc la tenaille dans laquelle nous nous trouvons pris. D’un côté, l’obligation de poursuivre sur le chemin de la croissance, sous peine de se trouver vassalisé. De l’autre côté, la conviction grandissante que cette course est désastreuse. Désastreuse pour tous. Pour emprunter les termes de René Girard : « Chacun se croit victorieux dans un univers où tout le monde est en pleine défaite et déroute [3]. » De plus, à supposer même qu’une nation parvienne à s’imposer aux autres, à quoi bon, si ce qui faisait sa substance doit se perdre dans le déploiement des moyens propres à assurer son succès ? Ce n’est plus elle qui gagne, mais une entité quelconque qui simplement porte son nom. Imaginons des antilopes à qui on proposerait de se transformer en hippopotames, afin de ne plus être la proie des lions. Accepteraient-elles ? Dans sa Somme théologique, saint Thomas écrit : « L’âne ne désire pas devenir cheval, car il cesserait d’être lui-même [4]. » Alors on se dit : mieux vaut périr comme on est que d’essayer de se tirer d’affaire en abandonnant son être. Juste après, on se dit : impossible de se laisser éliminer sans combattre. Or, pour combattre efficacement, il faut posséder la puissance matérielle. Et, pour posséder la puissance matérielle, il faut se vouer à ce qu’on nomme la croissance. Donc, trêve de discussion, en avant ! Ensuite, l’interrogation revient : à quoi bon chercher à s’en sortir si, à supposer qu’on y parvienne, ce doit être dans un champ de ruines ? Et si, chemin faisant, on doit renoncer à l’être qui valait qu’on se batte pour lui ? On ne cesse d’osciller entre les deux termes de l’alternative, l’un et l’autre calamiteux.
On aimerait trouver une voie médiane. Continuer sur la voie présente, mais avec modération. Ce faisant on risque, malheureusement, de ne pas cumuler les avantages, mais les inconvénients. Confronté à des concurrents enragés, le coureur qui ménage ses forces se trouve vite irrémédiablement distancé, tout en s’étant malgré tout trop éloigné de son foyer pour y trouver encore abri. Un autre type de conciliation serait imaginable : non pas un moyen terme, mais la coexistence de deux attitudes contraires au sein d’une même nation. Pendant que certains continueraient la course technologique afin de conjurer le risque d’écrasement par des concurrents trop puissants, la possibilité serait ménagée à d’autres de vivre de façon plus « conviviale », au sens qu’Ivan Illich donnait à ce terme (par convivial, il faut ici entendre ce qui est proportionné aux facultés naturelles de l’homme, est à leur mesure, en contraste avec des dispositifs surpuissants qui humilient ces mêmes facultés). Au lieu d’une confrontation entre les « technologistes » et les « conviviaux », les « croissantistes » et les décroissants, une forme de coopération s’établirait entre les deux – les premiers étant les garants de la sécurité de tous tant que la dynamique actuelle se poursuit, les seconds constituant, du fait de l’autonomie supérieure de leurs modes de vie, un socle extrêmement précieux en cas de crise générale, sans compter la sauvegarde de facultés humaines fondamentales. Je suis conscient de ce qu’une telle proposition a d’utopique, pour toutes sortes de raisons. Reste que par rapport à l’utopie d’un salut par l’innovation à tous crins, ou celle d’un abandon général de la technologie, je trouve la mienne plus sensée.
Olivier Rey (Iliade, 24 juin 2021)
Notes :
[1] « Discours du président Emmanuel Macron aux acteurs du numérique », 14 sept. 2020, Palais de l’Élysée.
[2] Lettre de Hwuy-Hung (1899), citée par André Chih (prêtre chinois), L’Occident « chrétien » vu par les Chinois vers la fin du XIXe siècle (1870-1900), Paris, PUF, 1961.
[3] « Le sens de l’histoire », entretiens avec Benoît Chantre à l’occasion de l’exposition « Traces du sacré » au Centre Georges Pompidou (2008) (33’05”).
[4] Ia, quest. 63, art. 3.