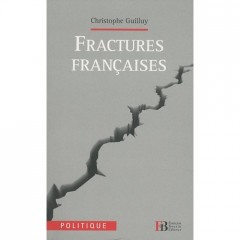Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de François Bousquet, cueilli sur le site de la revue Eléments et consacré au joyeux confinement des banlieues de l'immigration, bien différent de celui réservé aux citoyens lambdas ! Attention la bouteille de vitriol est ouverte !
Journaliste et essayiste, rédacteur en chef de la revue Éléments, François Bousquet a notamment publié Putain de saint Foucauld - Archéologie d'un fétiche (Pierre-Guillaume de Roux, 2015), La droite buissonnière (Rocher, 2017) et Courage ! - Manuel de guérilla culturelle (La Nouvelle Librairie, 2019).
Biopolitique du coronavirus (13). Au bon plaisir de l’immigration : nique ta mère et rodéos sauvages
Le confinement au faciès aura été la règle du gouvernement. Nous, citoyens de seconde classe, quand on voulait sortir, il nous fallait des autorisations, des attestations, des ausweis, des coups de tampon, des « Oui, Monsieur le gendarme, 135 euros, oui très bien… Que je ferme ma gueule, mais je la ferme, Monsieur l’agent. Je vous tends même mon cul. Oui, oui, oui, glissez-y le procès-verbal ! » Et de retour à la maison, il fallait se taper un autre gendarme, celui de Saint-Tropez, faute de pouvoir s’y rendre, héros colorisé de la France pompidolienne. Arrêtez d’emmerder les Français ! Ouais, ouais ! On n’a fait que ça un mois et demi durant.
Il faut dire que les chaînes de télévision et Christophe Castaner ont sorti le grand jeu. Louis de Funès en antidépresseur national et une noria d’hélicoptères lancés dans des courses-poursuites haletantes pour traquer de redoutables vététistes isolés dans le massif vosgien ou débusquer de dangereux réfractaires randonnant en forêt de Fontainebleau. C’est la guerre, hein ! Emmanuel Macron l’a répété, pendant que les postes de télévision et les drones au-dessus des villes crachaient des « Restez chez vous ».
Malheur aux contrevenants ! C’est à peine si la place Beauvau n’a pas dépêché un commando du RAID pour appréhender Madame Dugenou lorsqu’il est apparu que, distraite, elle avait griffonné son attestation de déplacement au crayon à papier, pas à l’encre indélébile. Non, c’est pas vrai !? Et Monsieur Duchmol ? Mis à l’amende pour avoir eu l’outrecuidance d’outrepasser de 500 mètres son périmètre de confinement pédestre. Et Madame Michu, qui, dans sa légèreté criminelle, a osé se procurer un bien non référencé dans la liste des produits de première nécessité, je veux parler du gâteau d’anniversaire qu’elle a acheté pour sa petite Michette. Verbalisée ! Comme Monsieur Tartempion, gonflé d’importance, réconforté de se savoir toujours un homme, au sens biblique du terme, interpellé pour l’achat d’un test de grossesse destiné à Madame Tartempion. Pas vital ! Non mais allô quoi ! Si la grossesse n’est pas vitale, qu’est-ce qui peut bien l’être ?
Castaner, « con comme un âne »
Résultat des courses : Castaner a pu triomphalement annoncer le 23 avril que 915 000 procès verbaux pour non-respect de confinement avaient été dressés. Ouah ! Depuis, on a dû allègrement dépasser le million. Belle moisson !
Ah Christophe Castaner, premier policier de France, sous-Clemenceau de sous-préfecture, le « kéké de la République », comme l’ont appelé Pauline Théveniaud et Jérémy Marot dans leur livre. Kéké, en provençal : un « crâneur ». L’inusable matamore du répertoire de la commedia dell’arte, mais recyclé en gigolo de casino exhibant une barbe tondue à ras comme un green de golf, le caddy devenue cador, avec sa voix de bellâtre pendue dans les graves et ses intonations martiales de joueur de castagnettes qui donnent des étourdissements aux majorettes d’Ollioules, dans le Var, où il est né. Les témoignages des proches sont concordants – et accablants : le type est odieux, pleurnichard, hypernarcissique. Faux dur et vrai con (« comme un âne », dit même son frère aîné).
L’Intifada en Vespa
Du haut de ces qualités qui font de nos jours l’homme d’État, Castaner nous a expliqué que, depuis l’adoption en 2018 de la loi réprimant les rodéos sauvages à moto, plus de 39 000 interpellations avaient eu lieu. Tu parles. On n’a rien vu de tel durant le confinement, sinon une application à géométrie variable de la loi. En banlieue, c’était ville ouverte. Des matches de foot géants le matin, des rodéos sauvages l’après-midi, des cocktails Molotov et des méchouis de bagnoles le soir. Mais pas d’interpellations ! Ça non, jamais ! La police de Castaner les réservait à Madame Dugenou et à Monsieur Duchmol. Pas à Ziyad, Yanis, Mehdi, Mamadou, Diallo, Sissoko, Wesley et autres sympathiques Presnel. Pas de couvre-feu ici – c’eût été discriminatoire –, rien que des incendies de voiture. Pas de masques, encore moins de casques. Pas d’applaudissements non plus le soir en famille au balcon. Le tapage nocturne se faisait dans la rue, aux pieds des barres d’immeuble, entre l’appel de la prière et l’appel au jet de pierre. L’islam spaghetti, le halal motocross, l’Intifada en Vespa. Le rodéo spaghettiquement correct, quoi ! Ne soyons pas injuste : l’évangélisme gangsta rap faisait lui aussi ses prières de rue à moto.
Bling-bling et vroum-vroum
Faute de l’habituel trafic de drogue, en cale sèche, confinement des clients oblige, l’économie souterraine s’est repliée sur le vol des scooters, une activité moins lucrative mais autrement festive. Ce commerce a alimenté un feuilleton dans le feuilleton de la gestion gouvernementale du Covid : les rodéos sauvages, une coproduction police-justice-caïds. À chaque jour son épisode, comme dans Fast and furious, déjà huit navets au compteur, en attendant le suivant programmé l’an prochain. Une nouveauté néanmoins que les scénaristes de Fast and furious et de Taxi avaient négligée faute de budget : du « kéké » isolé, on est passé à la bande organisée de 30 à 40 individus sillonnant les ronds-points et les centres-villes, jusqu’aux autoroutes. Foin de code de la route et de distanciation sociale. Le but du jeu consistait à percuter des jeunes filles, à rouler sur des policiers, à renverser des mères de famille, à rendre fou le voisinage, à lyncher des pères de famille – et à tuer (trop souvent) ou à se tuer (pas assez souvent). Après quoi, il est toujours temps de parler de bavure policière.
Tous ces gugusses à deux-roues rêvent d’un destin à la Tony Montana – du moins était-ce le cas de leurs aînés (ma génération) –, le grotesque balafré cubain, interprété par Al Pacino dans Scarface (1983). Le monde est à eux « et tout ce qu’il y a dedans ». Ils sont installés dans le brigandage mimétique comme d’autres sont installés dans le luxe ostentatoire. Ce sont des parvenus de l’espèce vautour dont les modes de vie relèvent du charognage, de la psychologie des foules et des bancs de sardines. Ils ne se révoltent pas, ils niquent. Ta race. Ta mère. Ta misère. En chœur.
Motherfucking, ta race !
Motherfucker, sisterfucker. Le motherfucking est universel. On en trouve trace en Chine ancienne, en Arabie, au Mexique, en Russie, en Afrique, en Europe. Insulter sa mère reste le meilleur moyen de gagner le paradis des voyous qui n’est jamais que l’enfer des honnêtes gens. Une pratique ancestrale dont la généalogie se perd dans la nuit des temps. Chez nous, l’injure « FDP » remonterait à Louis le Pieux, au IXe siècle, et aux premières naissances extraconjugales répertoriées dans les chroniques. En ce temps-là, on parlait de bâtardise, laquelle passera à l’état de juron. Mais tout cela n’est rien à côté de la littérature arabe et perse médiévale, trésor de scatologie, mais du moins alors était-ce des poètes qui injuriaient des rois et des rois qui molestaient des poètes.
Aujourd’hui ce sont des analphabètes qui donnent le la. Raison pour laquelle notre « nique ta mère » labellisé par le rap canal historique sort plus prosaïquement des caves du Bronx, dans les années 1970, où les joutes verbales – qui peuvent s’appuyer, elles, sur une longue tradition populaire – étaient un des sports favoris des Noirs déclassés, le « Yo, mama » épigrammatique et ordurier. La culture du ghetto, popularisée par le hip-hop, est devenue mainstream. Rien de nouveau sous le soleil de la domination : le mâle dominant c’est celui qui, toutes époques confondues, sait vanner et tataner.
Du Bronx à la nécropole royale du « 9-3 »
Si les journalistes connaissaient les banlieues autrement qu’à travers les concerts de NTM ou les tweets de Booba, ils oublieraient leurs illusions pour n’en conserver qu’une musique lancinante qui leur serrerait le cœur comme le souvenir d’une défaite humiliante. Rien de plus édifiant qu’un séjour dans le « neuf-trois », terminus de toutes les migrations, tombe des rois de France et cimetière des mythes républicains. Notre Paris-Dakar à nous, même s’il n’emprunte pas les mêmes chemins que le rallye-raid.
On n’y entre vraiment de plain-pied, Val-d’Oise inclus, que par les trains de la gare du Nord, en enfilant ces longs corridors sinistres que sont les voies ferrées de la région parisienne, couvertes d’inscriptions pariétales indéchiffrables et de graffitis agressifs comme des pitbulls déchaînés prêts à sauter à la gorge du voyageur. Saint-Denis, Stains, Aulnay-sous-Bois, Sarcelles, Montfermeil, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, Garges-les-Gonesse, autant de stations d’un enfer fluorescent.
Gare du Nord, villes du Sud
Le tri sélectif se fait à la gare du Nord entre les voyageurs grandes lignes et les trains de banlieues. Deux populations, que tout sépare, se croisent, parmi quelques chiens policiers et des vagabonds qu’on finit par ne plus voir, avant-garde minable de conquérants pouilleux. La France d’ailleurs, celle des touristes anglais et des immigrés subsahariens. C’est bien le vivier de l’équipe de France de football. « Black-black-black », comme dirait Alain Finkielkraut. Il y a là des Maghrébins, des Turcs, des Afghans, autant dire le monde entier, mais globalement ce sont les Noirs qui dominent, derniers vestiges de notre empire colonial.
S’enfoncer dans la banlieue, c’est s’éloigner des rêveries angéliques des bobos, du misérabilisme des sociologues de la ville, de la farce antiraciste vendue par les médias centraux. Pour comprendre l’écart qui sépare l’idéologie de la réalité, il suffit de sillonner une fois ces avenues Lénine, ces quartiers Paul-Vaillant Couturier, ces places Romain Rolland qui alternent leurs rangées de logements sociaux à l’alignement géométrique, délabrés ou rénovés, et leurs zones de non-droit, où l’on a transporté avec soi son Anatolie natale ou son Afrique, où l’on parle wolof, tamoul, arabe surtout, comme si les politiques d’arabisation avaient traversé la Méditerranée avec leurs locuteurs. Au rythme où vont les choses, l’arabe sera bientôt la deuxième langue de l’administration. En Seine-Saint-Denis, il l’est déjà dans les hôpitaux, où on travaille à la mise au point de logiciels d’accueil des patients dans la langue d’Abdelaziz Bouteflika. Si-si, mon bon sidi !
L’alliance des traders et des dealers
Tout marche par paire. La dialectique, que voulez-vous ! L’État de droit à Paris et les zones de non-droit dans les banlieues. Partout, le laissez-faire, le laissez-passer, le laissez-circuler, à l’Élysée comme à La Courneuve, où on se dispute deux monopoles : celui de la violence légitime et celui de la violence illégitime. Karl Marx a tout dit sur le sujet : l’alliance du lumpenprolétariat (le « prolétariat en haillons » en allemand) et de la haute banque – les voyous d’en bas et les voyous d’en haut, les dealers et les traders. Les uns font des rodéos sauvages, les autres, comme Jean-Jacques Bourdin, sont flashés à près de 190 km. Ibidem. Rien de tel que la photo bras dessus, bras dessous de Macron et d’un ex-braqueur torse nu à Saint-Martin, dans les Antilles, en 2018, pour illustrer cette alliance à front renversé. Et ne nous méprenons pas sur le sens du doigt d’honneur adressé par le voyou. Motherfucking : c’est à nous qu’il était destiné.
« Europe Mad Max », selon les mots de Bernard Wicht, spécialiste des questions de sécurité. Elle n’est pour l’heure visible que dans ces enclaves de non-droit. On en dénombre à peu près 1 500 en France, soit quasiment 10 % de la population. Un tiers d’entre elles sont d’ores et déjà hors de contrôle, au dire de Michel Aubouin, ancien préfet. C’est le résultat du regroupement familial et de la guerre des ventres qu’il a enclenchée. Non pas un Blitzkrieg, mais une nouvelle guerre de Cent Ans, trois à quatre générations, le temps qu’il faudra pour grand-remplacer la population indigène.
La charia de la caillera
« Désormais, les frontières de l’État passent à l’intérieur des villes », avait prédit un ancien maire de Philadelphie, il y a un demi-siècle, après plusieurs nuits d’émeute raciale dans sa ville. Il suffit parfois de traverser la rue pour se retrouver au milieu de la Zone, parmi des zombies. Ils ont choisi de transformer leur monde en prison, où, derrière des barreaux invisibles, ils cultivent leur rage comme une plante vénéneuse dans un monde qui n’est plus régi que par des règles carcérales : la violence et la solidarité clanique propres au lumpenprolétariat. Or, il se trouve que cette voyoucratie s’est adossée à une force pluriséculaire, le Coran, pour inventer quelque chose de nouveau : l’islam d’Occident, qui est un islam de prison – la charia de la caillera. On s’aveugle cependant à ne voir dans ce phénomène que l’implantation d’une Dar al-Islam de plus, comme le voudraient les « néo-cons » qui ne rêvent que d’importer en France le conflit israélo-palestinien. Ce n’est pas seulement cela qui est en jeu, c’est aussi la constitution d’une terre de démons qui, en tant que telle, récuse les règles de l’islam (quand bien même ces règles ne sont pas les nôtres, ce sont des règles).
L’ensauvagement, qu’on convoque à tort et à travers, appelle les mêmes réserves. N’oublions pas que le sauvage est beau, splendide, indomptable, il a sa propre existence, parallèle à celle du civilisé. L’ensauvagement n’est qu’une commodité langagière. De la même manière que nous parlons d’illettrisme, il faudrait plutôt parler d’un processus de déshumanisation ou, pour le dire crûment, de dédomestiquation. Regardez-les bien, ces jeunes gens, ils ressemblent à des meutes de chiens abandonnés, retournés à la lisière du sauvage et du civilisé, pareils aux chiens parias en Inde, à qui les Hindous appliquent leur propre système de castes. Il y a des chiens hors castes, des chiens intouchables, des chiens « tchândâla », comme eût pu dire l’auteur du Zarathoustra. On est d’ailleurs au cœur de la fabrique du ressentiment.
Nietzsche, René Girard et Dostoïevski
La sociologie n’est ici d’aucun secours. Mieux vaut lire les textes de Nietzsche sur le ressentiment, la grande passion des ratés. L’homme du ressentiment, c’est l’homme mal né, en proie à une haine intransitive, totale, hors de propos, même si elle est porteuse d’une vengeance séculaire dopée par les échecs répétés de l’islam et de la colonisation.
La vraie souffrance, c’est la comparaison. De la comparaison, naît la haine – d’autant plus tenace que la source de la comparaison fait l’objet d’un intense désir d’imitation. Le ressentiment étant ainsi fait qu’il désire ce qu’il déteste et déteste ce qu’il désire. C’est autour de cet écheveau d’injonctions contradictoires que s’articule la rivalité mimétique telle que René Girard l’a théorisée. Mais, sauf erreur, René Girard, qui a très largement élaboré sa thèse à partir des livres de Dostoïevski, ne s’est pas intéressé à un des plus grands romans du Russe, et des moins lus, L’Adolescent (1875), peut-être le plus girardien des textes dostoïevskiens. C’est l’histoire d’un jeune homme prisonnier de ses doubles, bâtard au statut indéterminé et précaire, fils illégitime d’un seigneur et de sa servante. Son rêve ? Être aussi riche, aussi fameux, qu’un Rothschild. « Je suis un misérable adolescent et j’ignore parfois ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous m’aviez montré la route un tant soit peu, j’aurais compris, et je me serais engagé aussitôt dans le droit chemin », confie-t-il à son père naturel.
L’Adolescent de Dostoïevski, c’est l’adolescent sans repère, enfermé dans un tunnel sans fin, sans point de fuite. Il ira toujours plus loin dans la provocation, jusqu’à ce qu’il rencontre une issue, une limite. Or, il n’y a plus de limite, sinon la mort brutale. À force de désertion, à force de démission, à force de dénégation, les adultes se retrouvent face à des fils à l’abandon qui défient une autorité fuyante, quand elle n’est pas vacante. Orphelins malheureux et agressifs, livrés au groupe, à la bande, à la relation violente, fusionnelle ou narcissique, prisonniers du souterrain, pour parler comme Dostoïevski, prophète incomparable en ces matières.
« Les champignons d’une gigantesque et dégueulasse erreur »
Il y a quelques années, le criminologue Xavier Raufer avait exhumé du Globo un entretien prodigieux donné par Marcola, le « leader suprême » du PCC, un des plus grands gangs du Brésil, véritable multinationale de la drogue, de son nom complet : le Premier commando de la capitale (Primeiro Comando da Capital). Marcola ? Une sorte de Lacenaire tropical mais pourvu du génie conjugué de Rimbaud et de Pasolini. Présentement, ce poète de la violence, parmi les plus grands assurément, purge une peine de 234 ans de prison à São Paulo. Au journaliste qui lui demandait s’il y avait une solution au problème de la violence, voici ce qu’il répondait :
« Une solution ? Mais il n’y a pas de solution, mon frère ! L’idée même d’une solution est une erreur. Nous sommes des hommes-bombes. Nous sommes au centre même de l’insoluble. Vous vous imaginez situés entre le bien et le mal, avec au milieu l’unique frontière : la mort. Nous, nous sommes une nouvelle espèce, nous sommes des créatures différentes de vous. Pour vous, la mort c’est un drame chrétien qui se joue dans un lit ou lors d’une attaque cardiaque. Pour nous, la mort c’est le pain quotidien, c’est la fosse commune. Vous, les intellectuels, vous nous parlez de luttes de classes, de marginalité, d’héroïsme. Et puis nous arrivons, nous. Ha ! Ha ! Ha ! Je lis beaucoup. J’ai lu 3 000 livres et j’ai lu Dante depuis que je suis en prison. Mes soldats à moi sont d’étranges anomalies du développement tordu de ce pays. Il n’y a plus de prolétaires, de malheureux, d’exploités. Il y a, en train de se développer dehors, une chose étrange qui prospère dans la boue, qui s’éduque dans l’analphabétisme le plus absolu, qui se diplôme dans les prisons, comme un monstre “Alien” caché dans les recoins de la ville. Déjà a surgi un nouveau langage. C’est une autre langue. Celle de la post-misère. Oui, c’est ça : la post-misère engendre une nouvelle culture assassine, relayée par la technique, les satellites, les portables, Internet, les armes modernes. C’est la merde avec chips et mégabits. Mes partisans sont une mutation de l’espèce sociale. Ce sont les champignons d’une gigantesque et dégueulasse erreur.
« Vous croyez que l’armée serait capable de lutter contre le Primeiro Comando da Capital (PCC) ? Je lis en ce moment De la guerre de Clausewitz. Il n’y a aucune perspective de succès contre nous. Pour en finir avec nous, il faudrait rien moins que larguer une bombe atomique sur les bidonvilles. Vous imaginez !
« Vous devez faire l’autocritique de votre propre incompétence. Mais soyons francs, sérieusement : quelle est la morale de tout ça ? Nous sommes au milieu de l’insoluble. Seulement nous, nous en vivons et vous, vous êtes dans l’impasse. Reste la merde. Or nous, nous savons travailler dans la merde. Écoute-moi bien, mon frère : il n’y a pas de solution. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu ne comprends rien à la dimension du problème. Comme l’a écrit le divin Dante : “Perdez toute espérance. Nous sommes tous en enfer !” »
Sociologie de la misère, misère de la sociologie
Quand elle ne voyage pas en classe affaires d’une capitale à l’autre, l’immigration est vouée à fabriquer du malheur social. Les racines sociologiques de ce malheur ne manquent pas : relégation sociale, pauvreté, etc. Elles ne suffisent cependant pas à justifier l’ampleur du désastre. Il y a des raisons plus inavouables. L’universalisme a échoué là où il devait échouer : la résistance des peuples. Il n’y a pas d’Homme majuscule, transposable d’un coin à l’autre du globe. Il n’y a que des Français, des Italiens, des Européens, des non-Européens. C’est le Savoyard Joseph de Maistre qui a raison contre le cosmopolitisme des Lumières. On a souvent comparé l’immigration à un phénomène de transfusion, pourquoi pas, mais encore faudrait-il que les donneurs soient compatibles.
Il n’a échappé à personne qu’on ne s’attarde guère sur le coût comptable de l’immigration, un fantasme de l’extrême droite, n’est-ce pas ! Mais que dire alors des coûts cachés, à commencer par le plus important d’entre eux : le délitement du lien social ? Lisez la vaste enquête du professeur Robert Putnam, une personnalité au-dessus de tout soupçon au regard du politiquement correct, sommité d’Harvard à qui Obama n’a pas manqué de rendre hommage. Publiée sous le titre « E Pluribus Unum : Diversity and Community in the Twenty-First Century » (2007), forte d’un échantillon de 30 000 personnes, cette enquête révèle un tableau largement dépressionnaire sur les effets pervers de la diversité raciale. La cohésion sociale n’y résiste pas.
La diversité raciale est antisociale
Les travaux de Putnam gravitent autour de la notion de « capital social », envisagé dans une perspective individuelle et collective. Le capital social est une notion ancienne, à laquelle Pierre Bourdieu a donné une orientation univoque et grossière dans le sens d’un marxisme de sacristie. Loin des images pieuses de la sociologie bourdieusienne, Putnam définit le « capital social » comme l’ensemble des relations qui, au sein d’une société, relie les hommes entre eux sur la base d’une confiance réciproque et d’une adhésion à un ensemble de normes reconnues. Ce que le jargon journalistique appelle le « vivre ensemble » en résume assez bien l’état d’esprit.
Or, que démontrent les travaux de Putnam ? Que la diversité raciale mine la confiance que les individus placent les uns dans les autres. Plus la diversité au sein d’une société est grande, moins règne la confiance, à telle enseigne qu’on peut affirmer sans se tromper que le niveau de confiance est inversement proportionnel à celui de diversité raciale. Non seulement la diversité sape la confiance entre les communautés, mais elle l’érode à l’intérieur desdites communautés. Bref, la diversité produit de l’anomie sociale, du chaos, de l’entropie. C’est une machine à séparer les hommes. Pas un domaine de la vie qui n’en soit affecté. On peut lui appliquer la théorie du ruissellement, mais ce qui circule ici, c’est l’amertume, la défiance, le ressentiment. On en vient à moins voter, à moins participer aux affaires publiques, à délaisser la vie associative, à oublier les œuvres de charité.
L’enfer, c’est les autres
Pour autant, Putnam exclut toute exacerbation des tensions raciales qui pourrait déboucher sur une guerre ethnique, la raison en étant que ce délitement du lien social est indifféremment inter-ethnique et intra-ethnique. Au final, la solidarité communautaire classique ne joue plus nulle part. Sur ce point, l’histoire contemporaine n’est pas avare de contre-exemples, mais qu’importe. Il y a plus d’un siècle et demi, le philosophe espagnol Donoso Cortès, dont Carl Schmitt faisait grand cas, décrivait ainsi la Babel moderne en cours d’édification : « une unité maudite, d’où ne sortira que l’unité de la confusion ». Le rêve d’abolir les frontières aboutit ainsi toujours à en créer de nouvelles. Celui d’abolir les races, à les exacerber. Celui de changer les hommes, à les anéantir. L’enfer est pavé de bonnes intentions, mais c’est l’enfer. Pas le paradis.
François Bousquet (Eléments, 2 juin 2020)