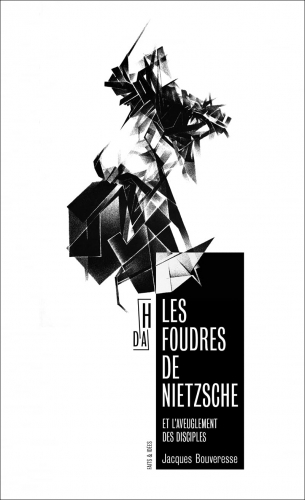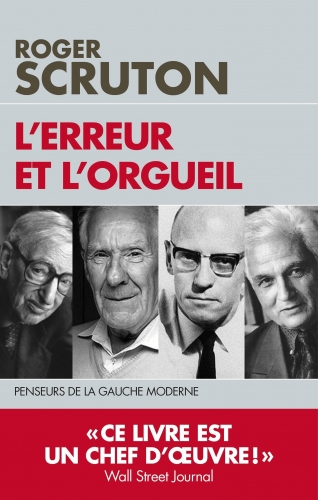Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Pierre Le Vigan, cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré au transhumanisme comme aboutissement du libéralisme.
Philosophe et urbaniste, Pierre Le Vigan est l'auteur de plusieurs essais comme Inventaire de la modernité avant liquidation (Avatar, 2007), Le Front du Cachalot (Dualpha, 2009), La banlieue contre la ville (La Barque d'Or, 2011), Nietzsche et l'Europe (Perspectives libres, 2022), Le coma français (Perspectives libres, 2023), Clausewitz, père de la théorie de la guerre moderne ou tout récemment Les démons de la déconstruction - Derrida, Lévinas, Sartre (La Barque d'Or, 2024).
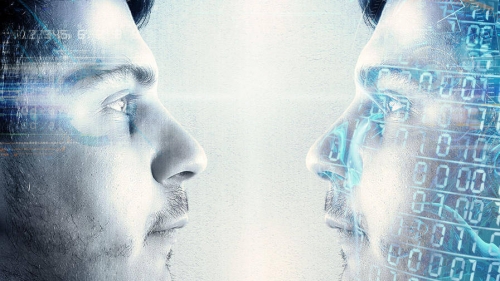
Le transhumanisme comme aboutissement du libéralisme ultime
Le transhumanisme est devenu un sujet central de notre époque. Que représente-t-il ? Que compte-t-il faire de nos vies si on le valide ? Pour comprendre la nouveauté du transhumanisme, il ne faut évidemment pas l’opposer à un prétendu immobilisme de l’homme des temps anciens. L’homme a toujours cherché à améliorer ses conditions de vie. Il a toujours cherché à acquérir plus de puissance, à multiplier son énergie, à inventer des outils pour habiter le monde à sa façon. Nous ne nous contentons jamais du monde tel que nous en avons hérité. Le simple fait de construire un pont est déjà une transformation du monde. Si le transhumanisme n’était que cela – l’intervention sur le monde en fonction de nos objectifs, la création d’outils pour que l’homme soit plus efficace dans ses entreprises, de la selle de cheval à l’automobile et à l’avion en passant par le gouvernail d’étambot – le transhumanisme ne serait pas une nouveauté. Le problème commence quand nous voulons, non pas seulement améliorer la condition de vie de l’homme, et donner plus d’ampleur à nos projets, mais changer la nature même de l’homme. Natacha Polony remarque que la recherche de création d’un homme nouveau caractérise les totalitarismes. « Les totalitarismes, par delà leurs innombrables différences, se caractérisent par une dimension eschatologique et la volonté de forger un homme nouveau. C’est exactement ce qui se passe avec le transhumanisme. Cette idéologie repose sur l’idée que l’homme est imparfait, et que le croisement des technologies numériques, génétiques, informatiques et cognitives va permettre de faire advenir une humanité débarrassée de ses scories. » (entretien, Usbek et Rica, 5 octobre 2018). Si les totalitarismes du XXe siècle ne disposaient pas (ou peu) de moyens permettant de changer réellement la nature humaine, un fait nouveau est intervenu. C’est l’intelligence artificielle et notamment la culture de l’algorithme. C’est ce qui est né avec l’informatique et dont la puissance a été multipliée par internet. C’est l’interconnectivité de tous les réseaux techniques. Le développement de la numérisation des hommes et du monde a coincidé avec le triomphe planétaire du libéralisme décomplexé, postérieur au compromis fordiste (un partage des revenus entre salaire et profit relativement favorable au monde du travail, et un Etat protecteur dit Etat providence). Or, le libéralisme, c’est la libération des énergies individuelles, de la puissance privée au détriment du commun. Le Hollandais Bernard Mandeville en résumait la vision : « Le travail des pauvres est la mine des riches » (La fable des abeilles ou les fripons devenus honnetes gens, 1714). Plus généralement, les vices privés font les vertus publiques. « Qui pourrait détailler toutes les fraudes qui se commettaient dans cette ruche ? Celui qui achetait des immondices pour engraisser son pré, les trouvait falsifiés d’un quart de pierres et de mortier inutiles et encore, quoique dupe, il n’aurait pas eu bonne grâce d’en murmurer, puisqu’à son tour il mêlait parmi son beurre une moitié de sel. » (…) Ainsi, « Chaque ordre était ainsi rempli de vices, mais la Nation même jouissait d’une heureuse prospérité. » Et l’Etat ? « Les fourberies de l’Etat conservaient le tout ». L’Etat doit donc être le garant des crapuleries privées. Conclusion de Mandeville : « Le vice est aussi nécessaire dans un Etat florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. » Ce n’est pas très différents de la théorie des « premiers de cordée » dont Macron fait son crédo, quand ceux-ci, loin de prendre des risques, se font garantir leurs profits par l’Etat ou par les institutions publiques. « Les béquilles du capital », avait dit Anicet Le Pors. Ce qui est à l’œuvre est ainsi la logique de Candide selon Voltaire. « Les malheurs particuliers font le bien général ; de sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien. » On lit là, bien sûr, une critique acerbe (et qui force le trait !) de Leibniz et de sa théorie du monde existant comme « le meilleur des mondes possibles ».
L’enterrrement du fordisme
Le « fordisme » a été enterré, au tournant des années 70, avec la désindustrialisation et l’ouverture des frontières aux produits et aux hommes venus de partout. C’est la France comme un hôtel, et trop souvent un hôtel de passe. « Tout pays doit se penser comme un hôtel » (J. Attali, Les crises, 30 octobre 2017). Après le fordisme, le Capital a gagné dans le rapport de force face au travail et dans le partage du revenu national. L’argent va à l’argent, et est de plus en plus déconnecté de la richesse réellement produite. Pour autant, le pays s’appauvrit, car il n’y a de vraie richesse que produite par le travail productif, et non par la recherche d’opportunités financières. Mais l’exploitation se présente de moins en moins dans sa brutalité foncière. Elle se protège d’un voile de bonnes intentions, et de la « moraline » dont parlait déjà Nietzsche. Elle adopte généralement la forme du contrat, celui-ci fut-il totalement inégalitaire. C’est pourquoi on ne peut donner raison à Michel Foucault quand il écrit : « Le marché et le contrat fonctionnent exactement à l’inverse l’un de l’autre » (Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979). Au contraire de ce que dit Michel Foucault, le marché et le contrat se complètent. Le marché prend la forme juridique du contrat. Il est « lavé « de sa dimension de rapport de force par la pseudo- « neutralité » juridique du contrat.
La fin d’un monde commun
Loin d’être contraire à la logique de l’économie libérale, l’extension du domaine du contrat (c’est un contrat écrit car plus grand-chose ne repose sur la parole donnée, qui renvoie à l’honneur) l’a complété. Tout ce qui est devient l’objet d’un contrat. Et cela ouvre la voie à la contractualisation des rapports avec soi-même. Une transition de genre, c’est décider, pendant un temps déterminé, et de manière réversible, et payée par la collectivité, de devenir ce que je ne suis pas, et d’obliger les autres à me considérer comme ce que je veux être. Que cela soit ou non une escroquerie anthropologique n’est pas le problème, l’Etat – l’Etat néo-totalitaire qui est le nôtre – est le garant de la réalité juridique qui m’oblige à la reconnaissance de cette réalité transitoire auto-décidée par le sujet concerné mais qui s’impose à moi, et à toute la société. Il n’y a, à l’horizon de cette auto-définition de soi, plus de monde commun. Le transhumanisme est ce qui surgit au bout de la logique contractualiste du libéralisme. Transhumanisme comme libéralisme reposent sur une religion de la science et de la technique. Ce ne sont plus les institutions qui doivent donner du sens à la société (comme chez Hegel pour qui les institutions sont des médiations que l’homme se donne à lui-même pour se réaliser, pour être plus lui-même, et plus hautement lui-même), c’est un mouvement permanent d’amplification des droits de l’homme. Tout ce qui est alerte sur les limites, attention portée à la nécessaire mesure, refus de l’hubris (démesure) est marginalisé, dénoncé, ringardisé. Les avertissements de Bertrand de Jouvenel, Jacques Ellul, de Nicholas Georgescu-Roegen sont ignorés. Face au rapport Meadows de 1972 (Dennis Meadows a alors 30 ans) Les limites de la croissance, l’économiste et philosophe libéral Friedrich Hayek refuse que l’optimisme tehnologique soit critiqué. « L'immense publicité donnée récemment par les médias à un rapport qui se prononçait, au nom de la science, sur les limites de la croissance, et le silence de ces mêmes médias sur la critique dévastatrice que ce rapport a reçue de la part des experts compétents, doivent forcément inspirer une certaine appréhension quant à l’exploitation dont le prestige de la science peut être l’objet. » (« La falsification de la science », The pretence of knowledge, 1974). Bien entendu, le droit d’inventaire sur un rapport d’étude est mille fois légitime. Mais ce qui est au cœur de la réaction des libéraux, c’est la démonie du culte du progrès scientifique. C’est la religion de la mondialisation heureuse, forcément heureuse. Car plus le monde est unifié, mieux il est censé se porter. Telle est la religion des ennemis de la différence. « Un siècle de barbarie commence, et les sciences seront à son service. », avait dit Nietzsche (La volonté de puissance, 154). De même que l’on dira plus tard qu’il n’y a « pas de choix démocratique contre les traités européens » (Jean-Claude Juncker), il n’y a pas pour Hayek de science qui puisse préconiser des limites à l’extension infinie du champ du libéralisme, de la croissance et du marché. La technologie, fille de la science, est mise au service de la « course au progrès », ce dernier conçu comme l’emprise de plus en plus grande de l’économie sur nos vies. Inutile d’insister sur la fait qu’il ne s’agit pas d’un progrès de la méditation, de la connaissance de nos racines, ou de notre goût pour le beau. Avec la construction d’un grand marché national puis mondial avec l’aide de l’Etat et non pas spontanément, une société de contrôle – une société de surveillance généralisée (Guillaume Travers) – est mise en place par l’Etat, appuyé sur de grandes groupes monopolistiques. Objectif : que nul n’échappe au filet de la normalisation et à son impératif de transparence.
Un totalitarisme rampant
Herbert Marcuse notait : « L’originalité de notre société réside dans l’utilisation de la technologie, plutôt que de la terreur, pour obtenir une cohésion des forces sociales dans un mouvement double, un fonctionnalisme écrasant et une amélioration croissante du standard de vie (...) Devant les aspects totalitaires de cette société, il n’est plus possible de parler de ‘'neutralité’' de la technologie. Il n’est plus possible d’isoler la technologie de l’usage auquel elle est destinée ; la société technologique est un système de domination qui fonctionne au niveau même des conceptions et des constructions des techniques.» (éd. américaine 1964, L’homme unidimensionnel, Minuit, 1968). Sauf que l’on ne constate plus du tout « l’amélioration constante du standard de vie ». A l‘exception des gérants des multinationales et des « cabinets de conseils » qui constituent un démembrement de l’Etat et permettent une externalisation apparente des décisions. Avec ses « conseils », chèrement payés, de sociétés extérieures au service public, c’est un système de management par agences qui s’est mis en place, sytème dont la paternité revient essentiellement au professeur et technocrate national-socialiste Reinhard Höhn, un système qui est à peu près le contraire de la conception de l’Etat qui était celle de Carl Schmitt.C’est une mise en réseau de l’insertion obligatoire dans le système qui se produit : « Par le truchement de la technologie, la culture, la politique et l’économie s’amalgament dans un système omniprésent qui dévore ou qui repousse toutes les alternatives. », dit encore Marcuse. C’est justement le caractère global de ce filet, de ce réseau d’entraves (appelons cela Le Grand Empêchement, tel que je l’ai évoqué dans le livre éponyme–éd. Perspectives Libres/Cercle Aristote, ou encore la « grande camisole de force du mondialisme ») qui caractérise ce nouveau totalitarisme.« Le totalitarisme, poursuit Herbert Marcuse, n’est pas seulement une uniformisation politique terroriste, c’est aussi une uniformisation économico-technique non terroriste qui fonctionne en manipulant les besoins au nom d’un faux intérêt général. Une opposition efficace au système ne peut pas se produire dans ces conditions. Le totalitarisme n’est pas seulement le fait d’une forme spécifique de gouvernement ou de parti, il découle plutôt d’un système spécifique de production et de distribution. » (op. cit.). Dans cette logique d’extension du domaine de l’économie marchande (qui prend la place de toute une économie de réciprocité, informelle), les Etats jouent un rôle premier : de même qu’ils ont imposé le marché national, ils imposent le grand marché mondial, ils poussent au mélange des peuples et à leur leur indifférenciation, à la déterritorialisation, à la transparence de vies de plus en plus pauvres en âme. Ils poussent encore à l’individualisme croissant, à la précarisation des liens, et au transhumanisme et aux identités à options qui ne sont qu’une forme de la marchandisation. Pierre Bergé disait à ce sujet : « Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que ce soit la PMA, la GPA (gestation pour autrui, NDLR) ou l'adoption. Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ? C'est faire un distinguo qui est choquant. » (17 décembre 2012). Le transhumanisme pour une société toujours plus liquide et plus contrôlable, tel est le projet de l’oligarchie mondialiste au pouvoir en Occident. Dans le même temps que les Etats sont de plus en plus intrusifs à l’intérieur des sociétés, ils sont, en Occident, de plus en plus concurrencés par d’autres structures au plan international. Ils cessent d’être les seuls acteurs du droit international, marquant ainsi la fin de l’ordre westphalien, né en 1648, à l’issue de la Guerre de Trente ans. Un double drame est le nôtre : nous assistons à la fin des Etats dignes de ce nom (toujours en Occident), et à la fin des possibilités de se parler et de négocier. En effet, si les traités de Westphalie mettaient fin aux guerres de religion, il nous faut savoir que nous sommes revenus aux guerres de religion, qui sont maintenant des guerres idéologiques, comme en témoigne l’actuelle hystérie anti-russe, partagée par la majorité de la « classe politique », c’est-à-dire des mercenaires du système. Etats vidés de ce qui devrait leur appartenir en propre, la souveraineté et l’identité, Etats faillis mis en coupe réglée par les oligarchies parasitaires anti-nationales et anti-européennes, tel la superstructure dite Union européenne qui est de plus en plus la même chose que l’OTAN, c’est-à-dire une organisation de destruction de l’Europe réelle qui nous fait agir systématiquement à l’encontre de nos intérêts, tel est le tableau de l’Europe. Un indice éclatant du démembrement de nos Etats est que pèsent souvent plus lourds que les Etats un certain nombre d’institutions : les ONG, les insititutions internationales, qu’elles soient directement financières (FMI, Banque mondiale, BERD …) ou ne le soient qu’indirectement (GIEC, OMC, OMS, …), les organismes mondialistes et immigrationnistes, multinationales, fonds de pension internationaux, collecteurs de fonds tels Blackrock, etc. Contrairement à nos Etats, toutes ces structures ne sont aucunement en faillite.
L’erreur de Michel Foucault
Loin d’être supprimé par le marché, comme le supposait Michel Foucault, le droit devient bel et bien un enjeu du marché. C’est un levier dans des rapports de force, et les EUA y jouent à merveille, comme de nombreuses entreprises françaises ont pu le constater à leurs dépens. Mais le droit exprime un rapport de force acceptable car officiellement « neutre » : telle est l’imposture. Intrusifs à l’intérieur, persécuteurs des patriotes mais gangrenés par la culture de l’excuse face aux gredins, les Etats sont de moins en forts au plan du régalien (sécurité, monnaie, défense, etc). Ils se sont même volontairement dessaisis de leurs outils. La raison en est simple : nos dirigeants ne sont que les fondés de pouvoir des sections locales de l’internationale du Capital. Le cas de la monnaie est particulièrement significatif. La fin de la convertibilité du dollar en or (1971), c’est-à-dire l’effondrement des accords de Bretton Woods de 1944 a fragilisé l’ensemble des pays tandis que les EUA entrent dans une ère de complète irresponsabilité monétaire et économique, c’est-à-dire le dollar comme liberté inconditionnée pour eux, comme contrainte exogène pour le reste du monde. Quant à l’euro fort, comme il le fut longtemps, il a, pour la France, favorisé les exportations de capitaux, les importations de marchandises et la désindustrialisation de notre pays. Quant à l’immigration, elle a ralenti la robotisation. Beau bilan. Il y a désormais dans l’économie mondiale les manipulateurs et les manipulés, et ce à une échelle bien supérieure à ce qui existait auparavant. Les banques vont prendre le pouvoir monétaire réel à la place des Etats (qui les renfloueront avec l’argent des contribuables en 2008). En France, la loi du 3 janvier 1973 (détaillée dans le livre de P-Y Rougeyron) est un tournant, et plus exactement un moment dans un tournant libéral mondialiste. L’Etat français ne peut plus se financer à court terme auprès de la Banque de France. Au moment où ses besoins de fiancement explosent. Comment va t–il se financer ? Par l’accès aux marchés financiers internationaux. C’est un changement de logique. Un changement que les libéraux du Parti « socialiste » alors au pouvoir vont accélérer à partir de 1983-84.
Avec le libéralisme, un Etat faible et dépendant des marchés financiers
Conséquence : une augmentation du poids de la dette, tandis qu’auparavant, les Bons du Trésor, c’est-à-dire des obligations d’Etat, étaient accessibles aux particuliers et à taux fixes, et permettaient à la fois de proposer des placements sûrs aux particuliers et de financer les besoins à long terme de l’économie. Si cette loi du 3 janvier 73 n’est pas à l’origine de la dette – celle-ci venant avant tout de la chute de notre dynamisme industriel, du développement de l’assistanat du à l’immigration familiale de masse, des autres coûts de cette immigration – elle marque néanmoins une inflexion nette vers la financiarisation, et le triomphe des théories monétaristes de Milton Friedman (Vincent Duchoussay, « L’Etat livré aux financiers ? », La vie des idées, 1er juillet 2014). Au final, l’Etat et sa banque centrale cessent d’avoir le monopole de la création monétaire (ceci ouvre du reste vers une question que l’on ne peut ici que signaler : faut-il « rendre le monopole de la création monétaire aux banques centrales ? » Cf. l’article éponyme, Revue Banque, 12 septembre 2012). En 1973, cette même année charnière (le premier choc pétrolier se produit, et pas du fait d’un simple mécanisme économique mais dans le cadre de grandes manoeuvres géopolitiques), le libéral Hayek prône la fin des monnaies nationales au profit de monnaies privées. Mais ce n’est pas le seul dégât que l’on constate. Le libéralisme induit un système économique de sélection naturelle qui favorise le mépris des conséquences environnementales des actions économiques et implique donc un court-termisme à la place de la prise en compte du long terme. Il s’opère ainsi une forme de sélection, mais une sélection des pires. Theodore John Kaczynski avait bien vu ce processus : « Cela s’explique par la théorie des systèmes autopropagateurs : les organisations (ou autres systèmes autopropagateurs) qui permettent le moins au respect de l’environnement d’interférer avec leur quête de pouvoir immédiat tendent à acquérir plus de pouvoir que celles qui limitent leur quête de pouvoir par souci des conséquences environnementales sur le long terme — 10 ans ou 50 ans, par exemple. Ainsi, à travers un processus de sélection naturelle, le monde subit la domination d’organisations qui utilisent au maximum les ressources disponibles afin d’augmenter leur propre pouvoir, sans se soucier des conséquences sur le long terme ». (Révolution anti-technologie : pourquoi et comment ? 2016, éditions Libre, 2021).
Le libéralisme contre la solidarité nationale et la justice sociale
En outre, en tant que le libéralisme est une forme du capitalisme, il prend comme critère l’intérêt des actionnaires et non l’intérêt de la nation. Il prend encore moins en compte ce qui pourrait être une préférence de civilisation, dont il faut affirmer la nécessité dans la mesure même où la mondialisation met en cause la diversité. Dans la logique du libéralisme, l’intérêt individuel prime toujours sur les intérêts collectifs, et sur les objectifs de justice sociale et de solidarité nationale. Ultras du libéralisme, « les libertariens défendent le libre marché et exigent la limitation de l'intervention de l’État en matière de politique sociale. C'est pourquoi ils s'opposent au recours à une fiscalité redistributive comme moyen de mettre en pratique les théories libérales de l'égalité. […] La fiscalité redistributive est intrinsèquement injuste et […] constitue une violation du droit des gens. », résume Will Kymlicka à propos des positions libertariennes (in Les théories de la justice. Une introduction, La Découverte, 2003). C’est aussi la thèse que défend Ayn Rand, célèbre libertarienne américaine. Dans cette perspective, au-delà de toute notion d’équité et de solidarité nationale, les libéraux ne cachent pas qu’il faut selon eux tourner la page des aspirations démocratiques. Peter Thiel affirme en 2009 : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. […] Je reste attaché, depuis mon adolescence, à l’idée que la liberté humaine authentique est une condition sine qua non du bien absolu. Je suis opposé aux taxes confiscatoires, aux collectifs totalitaires et à l’idéologie de l'inévitabilité de la mort » (« L’éducation d’un libertarien », 2009, cité in Le Monde, 1er juin 2015). Cela a le mérite d’être clair, tout comme il est clair que, depuis qu’a triomphé le libéralisme libertaire, les atteintes aux libertés n’ont jamsi été si violentes : identité numérique, interdiction d’hommages, de colloques, de manifestations pacifiques, etc. Avec ce libéralisme-libertaire, à la fois rigoriste pour ses adversaires et permissif pour tous les délires sociétalistes, on se retrouve dans le droit fil du libéralisme poussé dans sa logique, qui est le refus des limites de la condition humaine. Comme l’extension du domaine de la marchandisation n’est pas naturelle, l’Etat du monde libéral met en place, avec les GAFAM et avec les multinationales, des outils de contrôle visant à tracer tous les mouvements des hommes, les pratiques humaines, jusqu’à laisser une trace, par le scan des articles, de toutes les calories ingurgitées chaque jour par chacun. Le tout au nom d’une soi-disant bienveillante « écologie de l’alimentation ». Big brother se veut aussi big mother. Les « démons du bien » veillent, pour mieux régenter nos vies.
Le libéralisme trahit les libertés
Walter Lippmann, dans La cité libre (1937), ouvrage qui précéda le colloque Lippmann de 1938 (grand colloque libéral), plaidait pour les grandes organisations et la fin de « la vie de village ». C’était déjà l’apologie de la mégamachine. Nous y sommes en plein. Par la monnaie numérique et la suppression programmée de l’argent en espèces ‘’sonnantes et trébuchantes’’, la société de contrôle vise à rendre transparents tous les échanges inter-humains. Le libéralisme est ainsi à la fois l’antichambre du transhumanisme et le contraire des libertés individuelles, mais aussi collectives ou encore communautaires. Jean Vioulac remarque : « Le néolibéralisme est ainsi coupable d’avoir aliéné et asservi le concept même de liberté, en promouvant en son nom une doctrine de la soumission volontaire ». Ce néolibéralisme – ou libéralisme décomplexé et pleinement lui-même – est la forme actuelle du règne du Capital. Il ne conçoit la liberté que dans le registre de l’ordre marchand et sur un plan individuel. « Le libéralisme n’est pas l’idéologie de la liberté, mais l’idéologie qui met la liberté au service du seul individu. », note Alain de Benoist (Philitt, 28 mars 2019). Si le libéralisme est centré sur l’individu, il lui refuse en même temps le droit de s’ancrer dans des collectifs, et de s’assurer de continuités culturelles. Le libéralisme est bien l’idéologie et la pratique du déracinement. Il est temps de recourir à autre chose. On pense à l’enracinement dynamique tel qu’il a pu être pensé par Élisée Reclus. L’enracinement et la projection créatrice vers un futur. Il est tout simplement temps de cultiver l’art d’habiter la terre.
Pierre le Vigan (Euro-Synergies, 8 juin 2024)