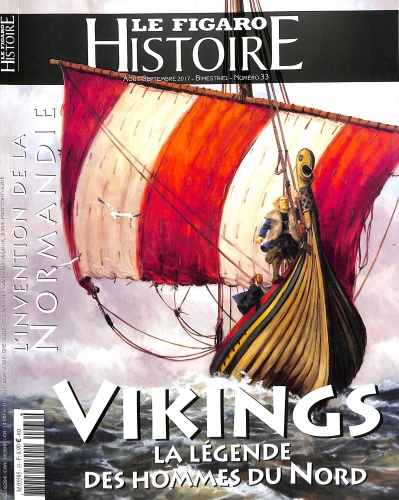Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Laurent Ozon, cueilli sur son blog Centurie News et consacré aux politiques d'immigration envisageables. Chef d'entreprise et essayiste, Laurent Ozon est l'auteur de France, années décisives (Bios, 2015), un ouvrage lucide et stimulant.
Immigration : les trois politiques
On n’empile pas des peuples issus du monde entier, dans un pays à la culture millénaire, sans fabriquer du conflit. Les sociétés multiculturelles sont instables, on pourrait même dire non viables, car lorsque des tensions historiques surviennent (guerres, épidémies, crises économiques), les différences de religion, de culture, de sensibilité, etc. deviennent des fossés et la société explose sous l’effet de son manque de cohésion, d’unité. Ce constat est celui de tous les réalistes politiques et ne souffre aucune exception dans l’histoire connue.
Ainsi, face aux tensions prévisibles dans notre avenir proche, les politiques devront résorber cette diversité anarchique, en reformant un corps social plus uni et stable. Tous les politiques qui réfléchissent savent que cette « homogénéité relative » est la condition de la stabilité de la société. Si cette question n’est pas traitée, notre société se fragmentera dans la violence dans les trente années à venir, incapable de faire face à son histoire. Notre pays s’embrasera et des foules se jetteront à l’assaut de tout ordre social, les unes contre les autres.
Il y a donc trois façons de résorber politiquement cette diversité sans complémentarité fabriquée par un laxisme suicidaire. La première de ces solutions est libérale et individualiste, la deuxième assimilationniste et républicaine, et la troisième localiste et « remigrationniste ».
La première solution consiste à rechercher une forme d’unité presque entropique par la dissolution de toutes les formes collectives d’appartenance en s’attaquant aux formes sociales non individualisées (famille, religion, etc.) afin de produire une population presque mixée, sans existence de sous-groupes légitimes. Le détricotage de la culture populaire et de ses normes, notamment via le « mariage homosexuel », s’inscrit bien par exemple dans cette logique.
La deuxième consistera à vouloir reformer une collectivité nationale souveraine et protectrice, structurée autour d’un État fort et laïc ayant relégué les religions dans la sphère individuelle. Ce modèle de société sera cimenté par une politique d’assimilation volontariste et par le rejet des communautés non assimilables hors de la communauté nationale. La principale difficulté de ce modèle, c’est sa compatibilité problématique avec les dépendances réciproques d’une société mondialisée dans laquelle les interactions sont nombreuses et les contraintes de co-gouvernance plus contraignantes (autonomie énergétique, monétaire, financière, sanitaire, etc.).
La dernière solution, construite sur le localisme et la « remigration », veut s’appuyer sur des souverainetés politiques retrouvées afin d’organiser la relocalisation des populations par une politique vigoureuse de retour au pays. Celle-ci s’inscrira dans le cadre de partenariats stratégiques ambitieux avec les pays du Maghreb. Elle présente l’avantage d’être compatible avec un exécutif plus « distribué » et des formes de pouvoir plus subsidiaires. Elle peut jeter les bases d’une diplomatie ouverte et dynamique compatible avec les besoins de nos voisins européens et ceux des populations arabo-berbères en situation d’êtres englouties sur leurs terres dans les quarante années à venir par la marée subsaharienne.
La quatrième, qui n’en est pas une, c’est la politique du chien crevé au fil de l’eau, qui débouchera sur l’effondrement et des souffrances que nous n’avons pas connues en Europe depuis la guerre de Trente Ans. Le temps s’écoule. Celui ou celle qui relèvera le défi de la puissance et du réalisme renouera avec le génie politique de la France.
Laurent Ozon (Centurie News, 25 août 2016)