Sur Tocsin, Nicolas Vidal recevait le 14 juin 2024 Jean-Pierre Colombiès, ex-officier de police, pour évoquer avec lui le risque d'installation d'un chaos sécuritaire en France dans les prochaines semaines...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Sur Tocsin, Nicolas Vidal recevait le 14 juin 2024 Jean-Pierre Colombiès, ex-officier de police, pour évoquer avec lui le risque d'installation d'un chaos sécuritaire en France dans les prochaines semaines...
Les éditions VA viennent de publier un essai de Christian Harbulot intitulé La guerre économique au XXIe siècle. Introducteur en France, au début des années 90, de l'intelligence économique et fondateur de l’École de Guerre Économique, Christian Harbulot a notamment publié Fabricants d'intox (Lemieux, 2016) et Le nationalisme économique américain (VA Press, 2017).
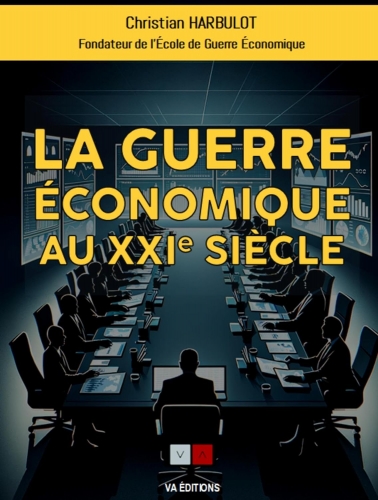
Guerre économique au XXIe siècle dévoile les dessous des affrontements économiques qui redéfinissent le paysage international. Il dépasse la notion traditionnelle de concurrence pour révéler un monde où entreprises, États et ONG entrent en jeu et mènent des stratégies d'influence, de guerre de l'information et de renseignement. Ce livre met en évidence la manière dont ces acteurs façonnent les dynamiques de pouvoir et les enjeux économiques globaux, impactant directement notre quotidien.
Christian Harbulot propose une perspective originale et éclairante sur ces conflits, soulignant l'urgence pour la France et ses acteurs de s'adapter en optant pour une posture proactive. En s'appuyant sur des analyses précises et des cas concrets, cet ouvrage équipe le lecteur d'une compréhension approfondie des stratégies en cours et de leur importance cruciale pour l'avenir économique et politique.
Ce livre est une invitation à plonger au cœur des enjeux économiques contemporains, offrant une grille de lecture indispensable pour décrypter les tactiques qui dessinent le monde de demain. Une lecture incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre et à influencer les courants de l'économie mondiale.
Les éditions Actes Sud de France viennent de publier un nouvel essai de Byung-Chul Han intitulé Vita contemplativa ou De l'inactivité.
Originaire de Corée, influencé notamment par l’œuvre de Heidegger, Byung-Chul Han est professeur de philosophie à l'Université des arts de Berlin. Plusieurs de ses ouvrages ont déjà été traduits en français dont Dans la nuée - Réflexions sur le numérique (Acte sud, 2015), Le parfum du temps (Circé, 2016), Psychopolitique (Circé, 2016), Sauvons le Beau - L'esthétique à l'ère numérique.(Actes sud, 2016), La société de transparence (PUF, 2017), Topologie de la violence (R&N, 2019), Thanatocapitalisme (PUF, 2021) et Infocratie - Numérique et crise de la démocratie (PUF, 2023).
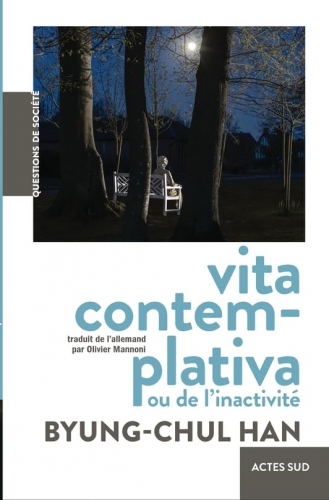
" « L'inactivité ne constitue pas une incapacité, un refus, une simple absence d'activité, mais une faculté à part entière - un patrimoine autonome. L'inactivité a sa propre logique, son propre langage, sa propre temporalité, sa propre architecture, sa propre magnificence, mieux, sa propre magie. Elle n'est ni une faiblesse ni un manque ; elle est au contraire une intensité qui n'est ni perçue ni reconnue dans notre société active et performante. Nous n'avons pas d'accès au royaume et à la richesse de l'inactivité. L'inactivité est une forme éclatante de l'existence humaine, mais elle s'est aujourd'hui fanée jusqu'à ne plus être qu'une forme vide de l'activité. »
Byung-Chul Han rend toute sa splendeur à l'inactivité en menant une analyse vigoureuse de notre rapport au temps, à l'activité et à la performance. Il esquisse par là même une nouvelle forme de vie. "
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Jean Montalte, cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré à la tentation faustienne de l'Europe...

Quête de l’Infini et inquiétude européenne
Anaxagore, au Ve siècle avant notre ère, a résolu en ces termes, et par avance, le principe de raison suffisante, énoncé par Leibniz (pourquoi y a-t-il de l’être plutôt que rien ?) : « Quel est le but qui vaudrait que l’on choisît de naître plutôt que de ne pas exister ? Spéculer sur le ciel et sur l’ordre du cosmos entier. » Être ou ne pas être, interrogeait Shakespeare. Anaxagore répond : être, pour contempler les astres, les étoiles, la voûte céleste, et s’en repaître comme d’un breuvage aussi succulent qu’intarissable. « Les esprits dignes de contempler les choses profondes conçoivent pour l’illimité une confiance sans limite », lui rétorque Goethe par-dessus les siècles, puisque l’univers s’est ouvert aux dimensions de l’Infini, révolution scientifique dont Alexandre Koyré avait tiré les conséquences dans un ouvrage de synthèse fameux.
J’ai la passion des chimères. Mon vœu le plus cher serait de vivre dans un château vaste comme le monde, à l’instar des Gormenghast. J’ai l’appétit cosmique propre à ma race. Inquiétude métaphysique, soif de dépassement, voilà les traits constitutifs de tout Européen bien né. Cette quête de l’ailleurs, je tente parfois d’en dompter la démesure, tant elle peut briser l’âme qui s’y livre sans retenue. Je me paie alors une cure de banalité. J’essaie de trouver dans la proximité des choses et des êtres la poésie invisible qui y est recelée, comme l’œuf de la colombe mystique dans sa coquille cernée de boue, en attente du troisième règne selon Joachim de Flore, celui du Saint-Esprit. Voyez l’ampleur de mes divagations… Chesterton, alors, se présente comme un antidote salvateur : « C’est une chose de raconter une entrevue avec une gorgone ou un griffon, une créature qui n’existe pas. C’en est une autre de découvrir que le rhinocéros existe bel et bien et de se réjouir de constater qu’il a l’air d’un animal qui n’existerait pas. » Si je peux me passer de ces créatures sorties de l’imaginaire européen, il m’est sans doute plus difficile de ne pas jeter un regard théorique sur l’Univers, de temps à autre, pour éprouver ce vertige du cosmos qui a le don de conjurer les forces entropiques menaçant mon cerveau du ratatinage.
La pulsion faustienne
David Engels, dans son dernier livre Défendre l’Europe civilisationnelle, sous-titré Petit traité d’hespérialisme (Salvator, 2024), qualifie l’esprit européen de faustien, dans la lignée de Spengler. Tantôt, ce trait idiosyncrasique se traduit dans une soif spirituelle portée vers la transcendance divine, tantôt cette même quête de dépassement s’abîme dans le règne du matérialisme, de la marchandise, de la croissance illimitée et de la technique. Selon David Engels, parmi toutes les explications qui tentent de rendre compte du déclin des grandes civilisations, la raison profonde qui mérite de retenir notre attention est la suivante : l’abandon graduel de la transcendance pour la matière.
David Engels écrit : « Pour moi, l’Europe proprement dite commence après la fin des grandes migrations avec la restitution impériale de Charlemagne, avec la recréation de l’Église chrétienne en Occident, avec ce grand projet de restitution impériale. C’est cela le véritable début d’une Europe que je définis dans son identité profonde surtout de manière psychologique. Pour moi, le mot-clef, c’est ce que l’on appelle la “pulsion faustienne”, c’est-à-dire cette volonté typiquement européenne de vouloir être en quête : en quête de quelque chose qui est derrière l’horizon ; en quête de quelque chose qu’on ne peut jamais vraiment atteindre ; en quête d’une transcendance, d’une vérité qui est juste derrière l’horizon. Et donc la quête d’une envergure assez monumentale, démesurée, je crois que la démesure, en bien comme en mal, est quelque chose d’assez typiquement européen. (…) La splendeur intérieure de la cathédrale gothique et la démesure inhumaine du gratte-ciel sont tous les deux des expressions d’un même archétype typiquement européen. » Jean-François Mattéi constatait, dans une veine similaire, que « l’Europe ne se comprend elle-même que dans un mouvement qui l’emporte irrésistiblement au-delà d’elle-même ». Mais ce mouvement, sur le modèle du périple odysséen n’exclut pas un retour à l’Île d’origine.
Cette articulation de la dimension spirituelle ou psychologique et de la dimension technicienne a le mérite de rappeler à une droite prométhéenne, dont je mesure les qualités au demeurant, que, sans un horizon de sens, nous sommes voués à nous enliser toujours plus profondément dans le nihilisme, nihilisme dont les dommages ne peuvent être résorbés par les prouesses techniques, aussi indispensables fussent-elles pour développer notre puissance sur la scène internationale.
Au Purgatoire ?
L’erreur symétrique de l’antimoderne ou de l’archéo-primitiviste n’est pas moins nocive pour autant. Certes, la science et ses dérives ne doivent être passées sous silence, encore moins les folies prométhéennes dont l’Européen doit en grande partie son déclin. Jean-François Mattéi écrit dans Le Sens de la démesure : « Le vingtième siècle aura été le siècle de la démesure. Aucune époque ne saurait lui être comparée, aussi loin que notre mémoire remonte. Démesure de la politique, tout d’abord, avec deux guerres mondiales et des conflits régionaux permanents, des déportations et des tortures de masse, des camps de la mort déclinés en allemand et en russe, et, pour culminer dans l’horreur, deux bombes atomiques larguées sur des populations civiles. Démesure de l’homme, ensuite, puisque tous ces crimes ont été commis en son nom, qu’il soit nazi, communiste ou démocrate, ou plutôt au nom d’idéologies abstraites qui, pour mieux sauver l’humanité, ont sacrifié sans remords les hommes réels. Démesure du monde, enfin, avec une science prométhéenne qui a voulu percer les secrets de l’univers, une technique déchaînée qui a cherché à asservir la nature, et une économie mondialisée, sous le double visage du capitalisme et du socialisme, dont les flux incessants d’échanges ont privilégié le prix des choses au détriment de la dignité des hommes. Telle est la démesure revendiquée du progrès, nouveau Moloch auquel il fallait à tout prix sacrifier. » Il semble qu’après la lecture de ces lignes, la messe soit dite. Et pourtant, se rallier aux thèses technophobes, en émules de Theodore Kaczynski – je cite ce nom parce qu’il n’est pas si rare de le voir pris comme exemple –, ce serait signer l’arrêt de mort de l’Europe puissance.
Une tentation anarcho-primitiviste, qui lorgnerait sur une barbarie originelle telle qu’elle fut fantasmée par un Robert E. Howard, par exemple, l’auteur de Conan le Barbare serait une catastrophe pour l’homme européen et diminuerait d’autant ses forces, tant intellectuelles que matérielles. Ce serait réduire l’homme européen hautement civilisé à l’ombre de lui-même, tout comme « les consécutions des bêtes ne sont que l’ombre d’un raisonnement », pour citer Leibniz.
Dans un entretien donné à Paris en 1997, un journaliste qui demande à Maurice G. Dantec si, devant la révolution numérique et internet, il serait du côté des utopistes un peu naïfs ou des catastrophistes anti-techno. « Il y a ceux qui y voient l’enfer et ceux qui y voient le paradis, où vous situez-vous ? » Maurice G. Dantec répond : « Au purgatoire. »
Mesure des Grecs, démesure de l’Europe
Au fond, l’erreur de l’antimoderne c’est d’avaliser l’équation de la philosophie des Lumières, qui consiste à établir une fausse corrélation entre progrès moral et progrès scientifique et technique. Croyant à cette corrélation et par rejet, répulsion, il récuse tout aussi bien les progrès techniques bien réels et ce qui tient lieu de progrès moraux, dans lesquels ils voient, souvent à juste titre, un pur camouflage de la décadence égalitariste. Contre cette équation, à rebours de cette identification, nous devrions repenser à nouveau frais la question de la technique sans lui associer tout le baratin progressiste qui l’a escortée jusqu’ici.
L’infini est parfois une notion qui a mauvaise presse, dans nos parages. Dominique Venner fustigeait la « métaphysique de l’illimité », ce qui n’est, certes, pas tout à fait la même chose. Maurras, plus sévère, dans sa préface du Chemin de Paradis de mai 1894, adressée à Frédéric Amouretti, écrit : « Il n’est point contestable qu’il existe sous le nom de pensée moderne un amas de doctrines si corrompues que leur odeur dégoûte presque de penser. […] J’ai surtout horreur ces derniers allemands. L’Infini ! Rien que ces sons absurdes et ces formes honteuses devraient induire à rétablir la belle notion du fini. Elle est bien la seule sensée. Quel Grec l’a dit ? La divinité est un nombre ; tout est nombré et terminé. » Et Boutang, de commenter dans son monumental Maurras, la destinée et l’œuvre : « En vain criait-il contre l’infini à l’allemande, le mauvais infini. L’infini l’habitait, lui jouerait des tours jusqu’à la fin – et la prière de la fin – (Maurras, mal rassasié, lui disait Mistral) calembour métaphysique qui répond à celui d’Eschyle sur son héros, Ulysse, Ulysse éponyme des douleurs. »
Et, pour finir, évoquons cette grande plume de la littérature française, Paul Claudel, qui dans sa Poétique, compose un poème en prose métaphysique, dans la lignée de Poe avec Eurêka, en congédiant la notion d’infini de sa cosmologie. Retour à l’antique, en somme, où l’infini devient synonyme d’indéfini, voire pire, de démesure. Ainsi, le premier à avoir tenté de penser l’être dans sa dimension métaphysique et cosmologique, Parménide d’Élée, concevait l’Être comme une sphère finie, « une balle ronde ». L’univers, en s’étendant sans limites, commettrait finalement une faute morale, au regard de la philosophie héritée des Grecs.
Cette distinction entre l’esprit grec et l’esprit européen, qui se développe sur le même axe que l’opposition entre le fini et l’infini, la limite et l’illimité, Albert Camus en donne un résumé saisissant dans son texte L’Exil d’Hélène : « La pensée grecque s’est toujours retranchée sur l’idée de limite. […] Notre Europe, au contraire, lancée à la conquête de la totalité, est fille de la démesure. »
Des crises et des révolutions
Nietzsche, dans L’Antéchrist, qualifie l’aboutissement du nihilisme européen de bouddhisme européen, une sorte de quiétisme aspirant à l’ataraxie, au nirvana. La société prospère et pépère des Trente Glorieuses, le plein emploi, le consumérisme, l’abandon de l’Algérie française et de l’Armée, dernier bastion des valeurs chevaleresques et aristocratiques, a bien failli accoucher de cette société en état de léthargie heureuse. Et il n’est pas rare de constater la présence d’un petit Bouddha en porcelaine dans le salon de monsieur Tout-le-monde. Tout indique, à rebours de ces espérances amniotiques, le retour du tragique dans l’Histoire, le retour des peuples européens, saisis par une inquiétude, une angoisse proprement existentielle.
Pour conclure, je me permets cette longue citation – il n’y a pas un mot à retrancher – de Jean-François Mattéi, qui écrit dans Le Regard vide : « Je considère l’Europe, cette figure unique de l’inquiétude dans le courant des civilisations, comme une âme à jamais insatisfaite dans la quête de son héritage et le besoin de dépassement. En dépit des renaissances, son rythme naturel est celui des crises et des révolutions, qu’elles soient religieuses, avec l’instauration du christianisme dans le monde romain, politiques, avec l’invention de l’État moderne, sociales, avec l’avènement de la démocratie, économiques, avec la domination du capitalisme, mais aussi philosophiques, avec la découverte de la rationalité, scientifiques, avec le règne de l’objectivité, techniques, avec la maîtrise de l’énergie, artistiques, avec le primat de la représentation, et finalement humaines, avec l’universalisation de la subjectivité. Ces ruptures qui forment la trame continue de son histoire, ces créations et ces destructions qui stérilisent son passé et fertilisent son avenir, ces conquêtes de soi et ces renoncements qui sont l’envers de l’oubli et de la domination de la nature, tous ces facteurs indissolublement liés ont contribué à faire de la crise, et donc de la critique, le principe moteur de l’Europe. On comprend que le choc de la Première Guerre mondiale, en rappelant à l’Europe le destin de mort des civilisations, lui ait enlevé l’espoir de ses vieilles certitudes et laissé le regret de ses anciens parapets. »
Les éditions du Drapeau blanc viennent de publier un essai historique de José Miguel Gambra intitulé La société traditionnelle et ses ennemis.
Né à Pampelune en 1950, José Miguel Gambra Gutiérrez a commencé sa carrière en tant que professeur de lycée, avant d’accéder à la chaire de logique de l’université Complutense de Madrid. Il a publié divers livres et articles, principalement sur l’histoire de la logique et pour défendre l’ordre politique chrétien. Il a également dirigé une organisation politique carliste.
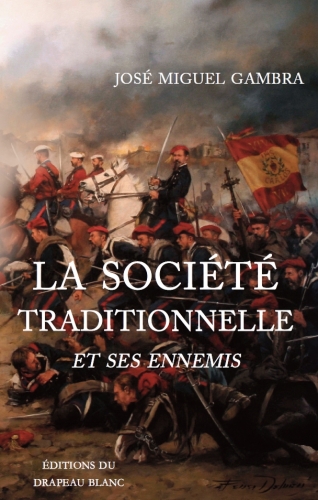
" Les temps modernes ont été le théâtre des guerres les plus sanglantes et les plus féroces de l’Histoire. Quoique revêtus de masques différents, leurs acteurs ont toujours été les mêmes, le libéralisme et le totalitarisme, s’affrontant impitoyablement sur la base de préjugés philosophiques communs que tous deux partagent. L’un et l’autre, en plus d’éclabousser de sang l’Histoire, réduisent l’existence humaine – individuelle aussi bien que collective – à la plus malheureuse des servitudes : par principe dans le cas du totalitarisme, par conséquence de facto inévitable dans celui du libéralisme. Voilà, en quelques mots, le diagnostic traditionaliste au sujet de la modernité. Les pages de ce livre démêlent les prémisses communes de ce qui n’est en réalité qu’une gigantesque guerre intestine entre deux frères redevables de la même idéologie. Son approche ne relève cependant pas de la critique formelle, abstraite, externe du style moderne… Dans La Société traditionnelle et ses ennemis, José Miguel Gambra expose dans toute leur plénitude les traits caractéristiques de l’héritage carliste et les éléments de la seule tradition, d’origine divine, à laquelle, d’après ses principes, l’homme doive se soumettre. C’est à partir de la mise en lumière de cette tradition, qui n’est autre que celle des Espagnes, que l’auteur montre toute l’ampleur de la monstruosité des prémisses de la modernité.
Pour cette nouvelle édition de Cette année-là, sur TV Libertés, Patrick Lusinchi, avec François Bousquet, rédacteur en chef d’Éléments et Christophe A. Maxime, remonte au printemps 1982, quand l’Europe se demandait s’il fallait secourir la Pologne, comme elle se demande aujourd’hui s’il faut envoyer des soldats au sol en Ukraine. Fallait-il mourir pour Gdansk dans les années 1980 ? Assurément non ! Faut-il aujourd’hui mourir Kiev ? Macron semble prêt à courir le risque, multipliant les déclarations bellicistes à l’encontre de la Russie, au risque d’une déflagration mondiale...