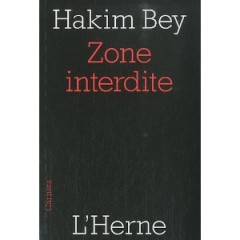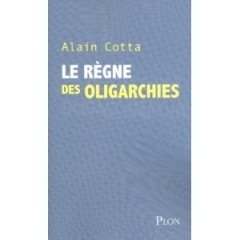Le XXe siècle a été marqué par la victoire intellectuelle et politique de la gauche, mais aussi par la chute du communisme en Europe. Le XXIe siècle a commencé par la prise du pouvoir par la super-classe mondiale en Occident, sous domination anglo-saxonne, au nom de la révolution néolibérale.
Mais au train où va le monde le XXIe siècle risque d’être marqué également par la fin de l'idéologie libérale en Occident. Car comme le marxisme, le libéralisme se heurte à son tour au mur des réalités.
Dans l'histoire européenne, le libéralisme a d'abord rimé avec la démocratie. Les libéraux s'opposaient aux traditionalistes et prônaient la libération du commerce et de l'industrie comme moyen de réaliser le bonheur sur terre, voire de conduire les Etats vers la paix par le « doux commerce ». Mais ils prônaient aussi la liberté du commerce des idées et la liberté politique.
Libéralisme et démocratie : la fin d’une convergence
Il y avait donc convergence entre la théorie économique (l'intelligence du marché et de l'échange libres : plus ils sont libres et transparents, plus ils prennent de bonnes décisions car les acteurs économiques sont mieux informés) et la théorie politique (la loi de la majorité débouche sur de meilleures décisions que tout autre régime politique).
A l'origine, le libéralisme n'est pas une idéologie d'importation et il y a une école libérale française ancienne qui tire son origine de la Fronde et de la lutte contre l'absolutisme. Mais le spectacle des débordements de la Révolution de 1789 va ancrer chez certains le principe de la supériorité absolue du modèle politique et économique anglais et bientôt américain (voir notamment à ce sujet le livre Les révolutions de France et d'Amérique, de Georges Gusdorf) sur celui de l'Europe continentale. A fortiori face aux effets désastreux de la mise en œuvre du communisme et de la social-démocratie dans la seconde moitié du XXe siècle, le libéralisme incarnait encore la défense de la propriété privée et la libération de toutes les contraintes étatiques.
Le messianisme anglo-saxon a fait perdre la raison au libéralisme
Le problème majeur tient justement au fait que le libéralisme a perdu la raison quand il a rencontré le messianisme anglo-saxon au XXe siècle et qu'il a hérité de sa prétention ridicule à incarner le bien absolu dans tous les domaines, quand le communisme s'est effondré. C'est alors « la fin de l'histoire » diagnostiquée un peu vite par Francis Fukuyama.
Le libéralisme est alors devenu le discours des maîtres : il est passé du stade de la théorie – économique voire sociale – à celui de l'idéologie, c'est-à-dire un discours qui sert des fins politiques. C'est pourquoi aujourd'hui l'idéologie libérale s'est mise au service de l'oligarchie, de la super-classe mondiale, et se détache de plus en plus de la démocratie. Les néolibéraux considèrent les peuples comme des obstacles sur la route du gouvernement mondial, c'est-à-dire du leur, bien sûr. Tocqueville doit se retourner dans sa tombe…
C'est justement cela qui est en passe d'être soumis au jugement de l'histoire.
Comme le communisme a tenté de monopoliser à son profit la question sociale qui émergeait au XIXe siècle, l'idéologie libérale instrumente des principes de bonne économie, mais au service d'un projet politique de pure domination.
Oui, il vaut mieux des prix libres que des prix administrés. Oui, la concurrence doit être recherchée de préférence aux monopoles. Oui, les déficits publics doivent être combattus. Oui, l'intervention publique dans l'économie peut déboucher sur des effets pervers. Oui, la bureaucratie est étouffante. Mais ce qui est en cause ce ne sont pas ces principes – dont beaucoup renvoient à la sagesse des nations – mais le fait que l'idéologie libérale soit frappée d'hybris et de cécité.
Or les idéologues libéraux n'acceptent aucune contradiction, car leur libéralisme est désormais un système intellectuel fermé sur lui-même.
L’idéologie libérale : un raisonnement de défense circulaire à l’image de celui du communisme
L'idéologie libérale reste très prolixe, en effet, lorsqu'il s'agit de critiquer l'économie dirigée sous toutes ses formes. Parce qu'elle est un discours très efficace pour mettre en accusation les institutions ou les politiques, quelles qu'elles soient, en particulier les politiques redistributives. Elle est au sens propre une idéologie révolutionnaire, que les socialistes saluaient d'ailleurs en leur temps comme préparant la route à la révolution communiste. Il suffit de relire le Manifeste du parti communiste !
Les intellectuels libéraux sont aussi très forts pour expliquer le passé : ils trouvent toujours des racines étatiques aux crises du marché ! On l'a vu lors de la dernière crise financière : c'était la faute aux subprimes, donc aux politiques publiques conduites en faveur de l'accès préférentiel des « minorités » au crédit. Pas au marché qui a pourtant donné massivement la préférence aux actifs toxiques.
En bons idéologues, les intellectuels libéraux retombent toujours sur leurs pieds, comme les chats. Si ça marche, c'est grâce à la libération du marché. Si ça ne marche pas, c'est parce que le fonctionnement du marché a été perturbé par l'intervention publique. A ce jeu intellectuel, la réalité se trouve vite écartée.
Il faut dire que, comme dans les pays occidentaux l'Etat – même aux Etats Unis – intervient toujours plus ou moins dans l'économie et le social, il n'est pas difficile de trouver des arguments en faveur de la thèse.
Si les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances ce n'est pas que les principes soient mauvais, c'est, au contraire, qu'on ne les a pas assez mis en œuvre : le genre de raisonnement circulaire – propre à tous les doctrinaires – de ceux qui expliquent que l'URSS ne représentait pas le vrai communisme…
Les effets du libre-échange : chômage, désindustrialisation, immigration
L'idéologie libérale reste aveugle au réel d'aujourd'hui. Nous sommes assurés avec elle de mourir en bonne santé économique et morale…
Comment ne pas s'interroger, en effet, devant les effets du libre-échange adopté par l'Union européenne : chômage, désindustrialisation, immigration ? Qui peut sérieusement prétendre que cette ouverture, mise en application concrète de l'idéologie du libre-échange, produit les effets bénéfiques escomptés par la théorie des avantages économiques comparatifs ? L'économiste Maurice Allais a pourtant clairement établi la connexion entre le chômage en Europe et ce choix du libre-échange mondial – sous l'influence anglo-saxonne d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on l'a réduit au silence à partir de ce moment là. « Maurice Allais : la mort d’un dissident »
L’Asie et les Etats-Unis, eux, se protègent
Comme il est curieux que les pays qu'on nous présente comme des parangons de la révolution libérale, soient en réalité ceux qui se protègent le plus – par des dispositifs les plus variés ou tout simplement par la distance culturelle – de la concurrence mondiale et notamment européenne : Etats-Unis, Asie. Est-ce à dire que la concurrence ne produirait pas toujours les effets bénéfiques escomptés quand les termes de l'échange sont par trop inégaux ? Ou que le protectionnisme pourrait produire des effets positifs ?
Il est quand même remarquable qu'aucun pays ne mette vraiment en œuvre de politique économique reposant totalement sur le principe « laisser faire, laisser passer ». Et pour cause : tout ordre politique suppose de réaliser le contraire de ce fameux principe : il suppose notamment des frontières et d'édicter des droits et des obligations spécifiques en faveur de certaines catégories de personnes, autant d'obstacles à la transparence ou à la non-discrimination.
La « société ouverte » n’existe nulle part
Le débat réel ne porte donc que sur le degré de libération de l'économie que l'on préconise. Il faut alors se rendre à l'évidence : la « société ouverte » défendue par les théoriciens libéraux, paradigme qu'ils opposent toujours à l'enfer de la société fermée, n'existe nulle part. Ce qui devrait quand même conduire à nous interroger. Si on ne la rencontre pas, ne serait-ce pas parce que ce modèle est justement inhumain ?
Que dire des effets réels des mesures de déréglementation et de réduction des charges pesant sur les entreprises initiées à partir des années 1990, quand le chômage de masse a commencé de progresser en Europe ? Ces mesures, inspirées du mot d'ordre libéral « Trop d'impôt tue l'impôt », étaient censées « libérer l'énergie des créateurs de richesses » – car l'idéologie libérale a aussi sa langue de bois ! – et permettre à nos entreprises de mieux affronter la concurrence mondiale et de sauver l'emploi.
L’idéologie libérale trouve ses plus chauds partisans au sein de la super-classe mondiale
Mais quel est le résultat réel de ces politiques ? L’augmentation de la profitabilité des entreprises et, en même temps, des déficits publics. Car les entreprises se sont restructurées, elles ont réduit leurs effectifs et délocalisé leur production mais l'Etat doit payer les plans sociaux. Comme il doit assumer les coûts de l'immigration qui a servi à limiter les coûts salariaux de ces mêmes entreprises. Pendant ce temps l'écart des salaires, lui, a explosé partout en Occident.
Il faut en vérité une certaine dose d'optimisme – un optimisme déjà raillé par Voltaire dans son Zadig, d'ailleurs – pour qualifier « d'échange moral » un système économique où les profits sont privatisés et les pertes systématiquement transférées aux Etats !
Mais on comprend que l'idéologie libérale trouve de chauds partisans parmi les dirigeants des entreprises transnationales, membres actifs de la super-classe mondiale, toujours prompts à fustiger le conservatisme des Etats et, bien sûr, des autochtones bornés et pas assez mobiles !
Les désastres du « paradis » britannique
Que dire des paradis anglo-saxons toujours vantés par les idéologues libéraux ? La Grande-Bretagne, quel paradis en effet ! : Ce pays n'a plus d'industrie et est devenu une économie de services, financiers principalement ; il n'a plus d'armée, et son modèle social implose sous les coups du communautarisme et de l'islamisme, fruit du dogme de l'ouverture des frontières. Après la révolution thatchérienne, les services publics anglais sont devenus un sujet d'hilarité à l'étranger. Que sont devenus les « miracles » irlandais ou espagnol qu'on nous vantait au début du siècle ? Qui nous parle de la progression de la pauvreté aux Etats-Unis, dont l'affaire des subprimes ne constitue que la face émergée ?
Que dire des effets de la « destruction créatrice » tant vantée par Schumpeter comme ressort de la supériorité du capitalisme ? Les Européens voient bien les destructions mais ne voient pas les créations, si ce n'est la mise en place d'une vague économie de services, dont les emplois sont d'ailleurs de plus en plus occupés par les immigrés de première ou seconde génération.
Le rouleau compresseur de l’esprit mercantile
Que dire d'une société dont les valeurs sont passées au rouleau compresseur de l'esprit mercantile et dont toutes les structures, toutes les traditions ont été « dérégulées » pour les soumettre au modèle états-unien : la fin de l'histoire assurément, mais en poussant son caddy comme dans le terrible roman de fiction de Cormack Mac Carthy, La Route.
Les libéraux expliquaient toujours que les erreurs publiques sont plus graves que les erreurs privées. Mais à l'heure des entreprises transnationales, qui ont des surfaces financières supérieures à certains Etats – sans parler de leur pouvoir d'influence politique – qui peut encore sérieusement soutenir cela ? Qui n'a vu les multinationales menacer les Irlandais de représailles si d'aventure ils maintenaient leur vote négatif lors du second référendum sur l'Europe ? Si le marché est toujours plus intelligent que les Etats, comment se fait-il que les Etats – c'est-à-dire les contribuables – soient appelés au secours des banques à chaque crise financière ?
Une idéologie qui date du XVIIIe siècle
A vrai dire le roi est nu : l'idéologie libérale – conçue pour l'essentiel au XVIIIe siècle – a beaucoup de mal à concevoir le monde du XXIe siècle, qui est devenu un monde de masses, d'oligopoles et de mise en concurrence non des simples acteurs économiques, mais des civilisations elles-mêmes.
Le libéralisme – conçu à une époque où l'Europe était dominante, rurale, où le summum du transport était la marine à voile et où la monnaie était convertible en or ou en argent – a du mal à s'appliquer à un monde globalisé qui fonctionne avec Internet à la vitesse de la lumière et où les « traders » vendent de l'immatériel avant de l'avoir payé. A l'évidence nous ne sommes plus au temps d'Adam Smith.
Déjà du temps de Marx on pouvait nourrir des doutes sérieux quant à la liberté réelle du travailleur « échangeant » sa force de travail contre un salaire. Que dirait-il aujourd’hui, alors que les médias – possédés par les puissances d'argent, c'est-à-dire les banques et les entreprises transnationales – façonnent par la publicité l'esprit public et sont dotés de pouvoirs de sidération sans précédent dans l'histoire : qui peut croire vraiment que le consommateur est libre de ses choix, que l'échange est équitable et que le commerce est « doux » ?
Une théorie et une praxis adaptées à la situation de l’Europe restent à inventer
Comment sérieusement croire que l'Europe va pouvoir « s'adapter », pour faire face à la concurrence des pays émergents qui pratiquent sur une grande échelle à la fois le dumping social et l'espionnage économique, en appliquant les potions libérales ? Pays émergents qui ne se bornent pas, au surplus, à fabriquer des T-shirts mais qui fabriquent aussi des ordinateurs et des fusées et qui regroupent la majorité de la population mondiale et qui constituent à eux seuls des marchés. En faisant en sorte que les Européens acceptent des salaires indiens ou des conditions de travail chinoises ? Qui peut sérieusement se réjouir d'une telle perspective ? Qui peut s'étonner que ce discours ait du mal à passer auprès des autochtones ?
Nous sommes en réalité, nous autres Européens, déjà sortis du circuit économique tel qu'il était conçu par les libéraux. Nous sommes en train de découvrir que la « main invisible » nous pousse sans ménagements excessifs vers la sortie de l'histoire.
Une théorie et une praxis – comme diraient les marxistes – adaptées à notre situation économique réelle restent à inventer !
Michel Geoffroy (Polémia, 27 janvier 2011)