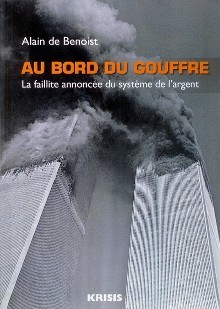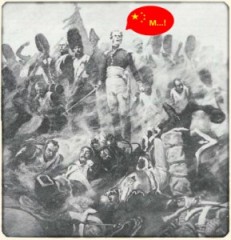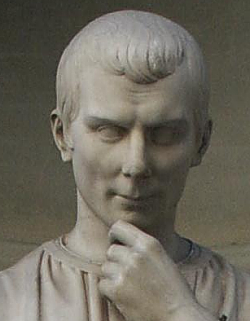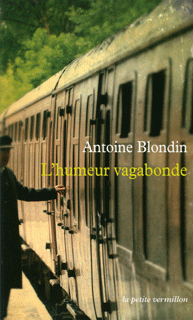Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Andrea Massari cueilli sur Polémia et consacré à la trahison de l'europe par l'Union européenne...

L'Union européenne contre L'Europe
La confusion entre l’Union européenne (institution politico-bureaucratique politiquement correcte) et l’Europe (héritage culturel et mythologique) est un mensonge qui fait beaucoup de mal. Car ce qui va de travers est attribué à l’Europe alors que ce qui est en cause, c’est l’Union européenne et son idéologie néfaste.
Destruction des frontières et conflits de frontières
En fait, la destruction des frontières et la volonté générale de normalisation et de centralisation dressent les Européens les uns contre les autres :
- ce sont l’Irlande et la Pologne qui s’opposent à propos des immigrés polonais en Irlande ; ou la Roumanie qui entre en conflit avec les autres pays à propos des Roms ;
- ce sont l’Italie et la France qui se chamaillent à propos des migrants clandestins de Lampedusa ;
- c’est le Danemark qui se fait gourmander quand il rétablit des contrôles à ses frontières ;
- ce sont les pays du nord qui ne veulent pas payer pour les pays du sud, appelés avec mépris les pays de « Club Méd » ;
- ce sont les pays du sud qui se sentent humiliés par les pays du nord qui veulent racheter leurs îles et leurs côtes ;
- ce sont les petits pays qui regimbent devant les diktats des plus grands.« L’Europe c’est la paix » est un slogan qui parle encore aux générations qui ont connu la guerre. Mais dans la réalité d’aujourd’hui, c’est de la novlangue, car l’Union européenne – qui n’est pas l’Europe – est un multiplicateur de conflits entre Européens.
L’euro et le retour de la germanophobie
L’euro a imposé une monnaie unique à des pays qui ne constituaient pas une zone monétaire optimale. L’euro a imposé le même carcan monétaire à des pays de culture économique et monétaire différente. La monnaie commune était une idée heureuse, la monnaie unique une idée dangereuse.
Aujourd’hui les craquements de l’euro – sorte de Mark continental – développent l’acrimonie entre Européens. Les Allemands se plaignent de l’irresponsabilité et de la nonchalance de leurs voisins. La France et les pays du sud répondent que le modèle allemand n’est pas généralisable : pour une raison simple, l’Allemagne réalise ses excédents commerciaux non sur le reste du monde (elle a eu, en 2009, 19 milliards de déficit commercial sur la Chine) mais sur les autres pays européens. Si les voisins de l’Allemagne s’alignaient sur le modèle allemand, l’Allemagne plongerait dans la déflation.
Cette analyse objective s’accompagne souvent de commentaires germanophobes : sur le site Atlantico, l’essayiste Jean-Luc Schaffauser, qui se présente comme « Alsacien, Germain et Français », écrit : « Il revient à la France, avec l’appui de l’Espagne et l’Italie, et d’autres pays de l’Europe du Sud, de contenir le démon allemand. A défaut, l’Europe n’aura aucune chance de survie. Nous sommes, en effet, en train d’aller vers une Europe allemande, c’est-à-dire vers plus d’Europe du tout ! L’Allemagne, après avoir détruit deux fois l’Europe, risque fort de la détruire une troisième fois par la guerre des temps modernes, la guerre économique. L’Allemagne a besoin d’une correction ; sa correction, c’est la vérité sur sa politique ! ». « Europe allemande », « démon », « correction » : derrière une analyse économique rationnelle, c’est le retour d’un vocabulaire stigmatisant, culpabilisant et diabolisant, peu propice à l’amitié entre les peuples.
Dans le même esprit un auteur des Echos avait sérieusement envisagé que l’Allemagne prenne en charge la dette grecque au titre de « réparations » dues pour la Seconde Guerre mondiale pourtant officiellement terminée il y a… deux tiers de siècle.
La faute de l’Union européenne : ne pas s’être (op)posée face au reste du monde
L’Union européenne a un marché unique et une monnaie unique mais elle n’a pas de politique commerciale face au reste du monde. L’Union européenne est la zone économique la plus ouverte du monde ; son déficit commercial n’est pas dû à ses faiblesses économiques mais à ses faiblesses politiques. Son tort est d’accepter le dumping social et environnemental des pays émergents ; son tort est d’accepter les pratiques commerciales déloyales de ses principaux concurrents ; son tort est d’accepter sans réagir la politique mercantiliste de la Chine qui impose un yuan sous-évalué tout en exigeant des exportateurs européens qu’ils transfèrent leur technologie et abandonnent, de facto, leurs droits de propriété intellectuelle.
L’Union européenne a une monnaie unique mais elle n’a pas de politique financière commune. Elle se trouve donc exposée aux pratiques prédatrices de la finance anglo-saxonne. Les déficits budgétaires américains et britanniques sont supérieurs à ceux de l’Italie et de la France ; leur endettement public et privé est aussi supérieur : pourtant la spéculation (« les marchés ») s’attaque à l’Italie et à la France, non, pour le moment du moins, aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne. La raison en est simple : les banques centrales anglo-saxonnes rachètent la dette des Etats anglo-saxons ; la Banque centrale européenne ne rachète pas (elle n’en a d’ailleurs pas le droit) les dettes des Etats européens. Résultat : la masse monétaire créée par les Anglo-Saxons est disponible pour spéculer sur les dettes européennes. Inspiré par l’Allemagne, le modèle monétaire de la BCE est sans doute vertueux mais il n’est pas tenable dans un monde complètement ouvert. L’Union européenne devra choisir : réglementer et protéger son marché financier ou faire, comme les autres, fonctionner la planche à billets.
L’Union européenne cherche à construire un gouvernement économique commun mais les personnalités mises en avant appartiennent toutes à la superclasse mondiale : le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, est un homme du Bilderberg et de la Trilatérale ; comme l’est Mario Monti, le nouveau premier ministre italien, par ailleurs ancien de Goldman Sachs ; tout comme Mario Draghi, le nouveau président de la BCE. Ce qu’on appelle la « gouvernance européenne » est de fait au service de la finance mondialisée.
L’Europe, une figure singulière face aux trois impérialismes : américain, musulman, chinois
Les peuples et les nations européennes sont en train de reprendre leurs chicaneries.
Pour deux raisons :- l’Union européenne veut leur imposer des règles communes qui ne leur conviennent pas ;
- et dans le même temps l’Union européenne les livre pieds et poings liés à trois impérialismes :
- l’impérialisme financier des Etats-Unis et de la superclasse mondiale ;
- l’impérialisme commercial des Chinois ;
- l’impérialisme migratoire et civilisationnel des musulmans.
En face de cela, l’Europe ne peut survivre qu’en retrouvant le sens de son identité, de ses frontières et de ses intérêts. L’Europe a des concurrents, des adversaires, des prédateurs et même des ennemis. Son problème c’est que l’Union européenne ne veut pas en tenir compte.
Andrea Massari (Polémia, 24 novembre 2011)