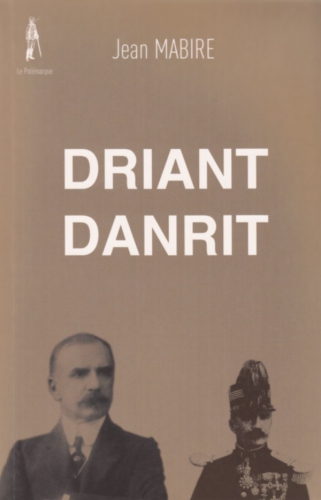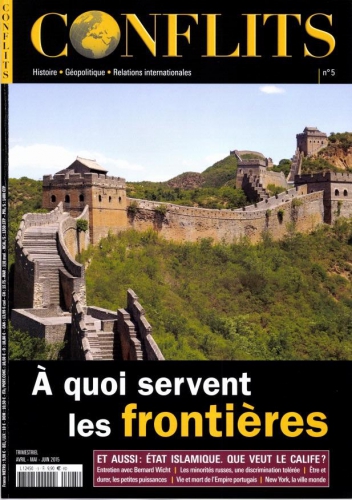La fête de Pâques et du Printemps
Pâques est en quelque sorte la fête de l’équinoxe de printemps. C’est le retour du soleil, le soleil fécondant sans lequel rien ne naîtrait. L’hiver meurt, les neiges fondent, les rivières sont en crue, la nature retrouve sa verdure, les plantes leurs boutons, les arbres leurs bourgeons, le soleil est redevenu suffisamment puissant pour réchauffer la terre et lui apporter la vie. Jonquilles, primevères, jacinthes fleurissent dans les jardins et les jachères.
A l’avènement du christianisme la fête de Pâques – qui est la célébration de la résurrection du Christ (rappelons que la fête de Pâques a longtemps été la plus importante de la tradition chrétienne et qu’elle marquait le début de l’année, et cela jusqu’en 1563) – remplaça la fête d’Ostara ou fête du printemps, qui est la fête du renouveau, de la fécondité et de la fertilité dont les origines sont très anciennes. Cette fête porte le nom d’une déesse lunaire, Ostara, qu’un héros solaire aurait délivrée de la captivité au moment de l’équinoxe de printemps. On retrouve là un mythe très présent dans les mythologies européennes et même dans les contes (qui ne sont qu’une retranscription de ces mythes) auxquels Dominique Venner faisait souvent référence (*voir en encart : texte inédit). C’est Ariane délivrée par Thésée, Andromède délivrée par Persée, Brunhilde délivrée par Siegfried ou la Belle au bois dormant et Cendrillon de Charles Perrault, Blanche Neige et Raiponce des frères Grimm…
Pâques est un mot d’origine hébraïque qui se dit en allemand Ostern et en anglais Easter.
A Pâques c’est l’œuf qui symbolise la renaissance de la nature, la fécondité, la vie qui s’apprête à éclore. Symboliquement, l’aube du jour et l’aube de la renaissance de la vie sont intimement liées à Ostara, comme le blanc et le jaune de l’œuf qui vont donner la vie.
Il est une vieille tradition qui nous vient des pays germaniques et slaves qui consiste à décorer des œufs, de les offrir ou de les cacher pour qu’ils soient trouvés. La symbolique en est très forte. En effet, trouver un œuf peint c’est trouvé une image de ce que nous sommes : une forme abstraite, une apparence. C’est l’apparence du monde, son décor, dont nous faisons partie. Derrière il y a une coquille. Il faut briser la coquille, aller au-delà de cette apparence. Et on trouve à l’intérieur de l’œuf la couleur blanche, la couleur des origines, du commencement, de la pureté. Puis le globe d’or, symbole du cœur primordial qui contient l’essence d’un peuple, d’une race, d’une civilisation. Le printemps, symbolisé par l’œuf nous renvoie aux temps de l’Age d’Or et de l’Age d’Argent, les temps primordiaux qu’il s’agit de renouveler.
Sont associés à ces œufs des jeux comme par exemple : lancer un œuf en l’air qui doit être rattrapé par une personne et relancé de nouveau par une autre personne. Celui qui le laisse tomber ou qui l’écrase reçoit un gage. Ou « la toquée », un jeu d’origine grecque où chaque joueur tient fermement un œuf (cuit et dur) dans son poing fermé et l’emploi comme arme pour « toquer » les œufs des autres joueurs. L’objectif étant d’arriver à casser les œufs des adversaires sans casser le sien. A gagné celui qui a cassé le plus d’œufs. Que les brutes s’abstiennent car il faut doser ses coups… Ou encore, « la roulée » pratiquée en France, en Ecosse, dans le nord de l’Angleterre, en Ulster, en Autriche et en Suisse. Le jeu consiste tout simplement à faire rouler des œufs durs peints de couleurs vives, sur un plan incliné naturel jusqu’à ce qu’ils soient cassés. Le vainqueur est celui dont l’œuf reste intact le plus longtemps. Dans le même esprit, la course aux œufs portés à l’aide d’une cuillère serrée entre les dents. Un parcours à embuches est préparé pour faire en sorte que les œufs tombent et se cassent.
En Ukraine comme en Pologne, l’œuf de Pâques rituellement associé à la venue du printemps s’appelle le Pyssanka, “l’œuf écrit” car, coloré ou peint. Il est en effet chargé de symboles : étoiles, soleils, roues solaires, cercles et spirales qui font partie d’un répertoire au même titre que la croix, le triangle ou la ligne. En Russie, c’est justement l’œuf de Pâques qui est à l’origine des célèbres œufs impériaux russes que l’on doit à l’imagination de Peter Carl Fabergé, orfèvre du Tsar.
Mais, dans tout cela, n’oublions pas de cacher des œufs décorés ou en chocolat dans le jardin ou la maison, la chasse à ces trésors ravira les enfants. Une tradition très française appréciée en son temps par Louis XIV qui faisait bénir solennellement le jour de Pâques de grandes corbeilles d’œufs dorés qu’il remettait en cérémonie à ses proches.
Si l’œuf est lié à la poule il l’est aussi avec le lièvre, l’animal sacré de la déesse Ostara, animal lunaire (il dort le jour et gambade la nuit), animal de passage qui assure la transition entre le monde des hommes et le monde merveilleux des esprits, des génies et des dieux. Il symbolise l’abondance de biens et la prospérité, c’est lui justement qui cache les œufs. Dans les pays germaniques, on trouve l’Oster Hase, « le lièvre de Pâques ». C’est l’animal qui entend de très loin. Dans les contes populaires il est souvent présenté habitant les mondes souterrains, les profondeurs de la Terre, grande réserve où sont entassées les inépuisables richesses. Il représente les richesses cachées du monde, la fécondité du sol, appelant à casser la coquille de l’œuf.
Si le Moyen Age ignore le lièvre distributeur de cadeaux et de friandises, il connaît d’autres figures tout aussi merveilleuses. La biche blanche ou le cerf blanc des récits arthuriens hantent ces périodes de transition entre les quarantaines de l’année. Dans le roman de Chrétien de Troyes intitulé Erec et Enide, la chasse au Blanc Cerf a lieu le lundi de Pâques, comme s’il fallait rappeler le lien de cet animal avec la lune d’équinoxe. Ces animaux conducteurs d’âmes servent de médiateurs entre le monde humain et l’Autre Monde.
Dans le folklore moderne, les traditionnels œufs de Pâques sont censés être apportés aux enfants par les cloches qui reviennent de Rome ou par le lièvre de Pâques lui-même. Toutefois, dans les régions germaniques, l’animal féerique change d’apparence : en Westphalie, c’est un renard, en Thuringe une cigogne, au Tyrol une poule blanche, en Suisse un coucou et en Saxe un coq. La présence d’animaux de basse-cour semble plus vraisemblable à côté de ces œufs rituels. Cependant, il est évident que les œufs de Pâques sont investis d’une valeur mythique qui n’a rien à voir avec leur usage proprement alimentaire.
Charles Ledoux (Iliade, 3 avril 2015)