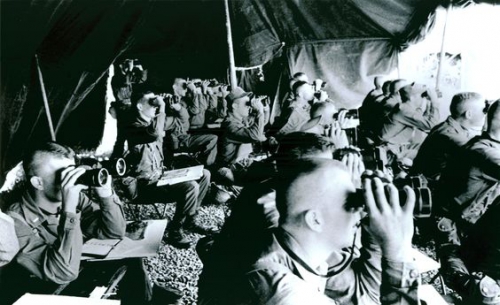L'Empire contre-attaque !
Donald Trump sera donc le 45ème président des États-Unis. Un revers cinglant pour l'Establishment mondial, les médias et les instituts de sondages occidentaux, qui ont, une fois encore, pratiqué la méthode Coué et refusé de prendre la mesure de la colère d'un peuple qui rejette sa marginalisation politique, culturelle et économique. Une auto-intoxication médiatique qui en France, menace d'atteindre aussi la primaire de la droite et du centre, celle de gauche et l'ensemble de la compréhension des enjeux du scrutin présidentiel…
Ce qui est surprenant, c'est en fait que les grands «leaders» et analystes soient si surpris de cette victoire. Surprenant et inquiétant, pour ce que cela révèle du divorce des perceptions et des attentes entre cette superstructure composée des élites mondialisées occidentales et les «populations» qu'elles prétendent diriger ou informer, leur déniant le statut de peuples comme leur profond besoin de cohérence et de protection identitaire. Un besoin en somme, d'être des «Nations» plutôt que des agrégats d'atomes projetés nus dans la violence économique et sociale du monde.
Le divorce est donc consommé. L'expression se libère. Les peuples se rebiffent. On objectera que c'est la victoire d'un populisme nauséabond, rétrograde et vulgaire. Celle d'une population blanche sous-diplômée, raciste, xénophobe, homophobe. Celle des «deplorables», celle de citoyens américains pitoyables selon Hillary Clinton. L'ancienne secrétaire d'État du Président Obama a ce jour-là dévoilé son mépris profond du peuple (pas uniquement blanc d'ailleurs) dont elle quêtait les suffrages, et elle a perdu une belle occasion de se taire. Alors, la victoire «du Donald» est-elle l'expression d'un populisme rance ou d'un sursaut démocratique? Je penche pour cette seconde possibilité et la tiens pour un cri d'angoisse d'une (grande) partie de l'Amérique - blanche, noire, hispanique - qui, lasse d'être ignorée, a saisi sa chance, ici incarnée en cet homme si représentatif du fighting spirit américain, de dire sa colère et son sentiment d'abandon.
Besoin de frontières, besoin d'identité, ces thèmes ne sont pas très «hype» ni «bobos», on en conviendra. Mais ces crispations sont celles d'une société américaine qui réalise que son avenir est sombre. Non pas, comme chez nous, parce que l'État-providence est en faillite et ne peut plus payer pour tout… puisqu'on ne lui demande quasiment rien là-bas. Mais parce que la liquidité du monde, sa virtualisation galopante, ont mis à mal le rêve américain lui-même, et rompu la chaîne de l'espoir en un avenir meilleur pour ses enfants - non par l'opération du Saint-Esprit ou les largesses de l'État-providence - mais par l'effort et le travail acharnés.
C'est là probablement la vraie rupture qui a noué la victoire de Trump. Le gouffre toujours plus grand des inégalités liées à la financiarisation de l'économie, le surendettement de la jeunesse étudiante, la précarisation structurelle de couches entières de la population a transformé le rêve américain en mythe de Sisyphe désespérant. Un rêve américain qui n'est pas un slogan outre-Atlantique, mais une conviction très profondément ancrée en chacun de la valeur du travail et du courage pour améliorer sa condition initiale, quelle qu'elle soit, ou pour y échapper spectaculairement.
Alors, plutôt que de déclarer légèrement que cette élection «ouvre une ère d'incertitude», comme l'a fait notre président, qui n'a manifestement toujours pas compris ce que la fonction présidentielle exigeait de hauteur de vue et d'intelligence de situation en matière internationale, nous devrions féliciter le nouveau président américain et l'assurer de la disponibilité de la France, au-delà de toute alternance politique, à consolider une relation bilatérale essentielle pour nos deux pays. Nous devons aussi sans attendre, tirer les conséquences de cette bascule géopolitique probable et majeure avec lucidité, et nous atteler à restaurer notre image abîmée d'allié secondaire trop docile. Peut-être en fait la réaction française s'explique-t-elle par un «vertige» (exprimé de manière intempestive par notre ambassadeur à Washington), non pas devant la victoire de Trump, mais devant le désaveu massif de la «politique» moyen-orientale de Paris depuis bientôt cinq ans que cette victoire augure. Nous avons «eu tout faux» depuis 2011 en Libye, mais bien plus encore en Syrie. L'heure est venue soit de changer radicalement d'approche, soit, si nous nous entêtons, d'en payer le prix par un isolement gravissime et une décrédibilisation durable dans toute la région et au-delà.
Même les États-Unis en effet, ont besoin d'alliés forts et intellectuellement autonomes. Leur nouveau président, bien plus que son prédécesseur, croit manifestement dans le rapport de force comme vecteur de structuration de toutes les relations, d'affaires, internationales et interpersonnelles. Il s'accommodera parfaitement d'une France qui assume son indépendance d'esprit et de comportement et défend ses intérêts sans trahir ses alliances. Il sera très probablement bien entouré. On parle de Newt Gingrinch comme secrétaire d'État et du Général Michael Flynn - ancien directeur du renseignement américain -, connu pour son réalisme et sa clairvoyance sur la marche réelle du monde et des grands équilibres à préserver ou à restaurer notamment au Moyen-Orient et vis-à-vis de la Russie. Son conseiller pour la politique étrangère, le libanais Whalid Phares, paraît être aussi un facteur sinon de pondération, tout au moins de créativité pragmatique. Or, le monde à un urgent besoin d'innover pour s'apaiser. Par ailleurs, les fondamentaux géopolitiques de l'Amérique ne vont pas disparaître avec l'arrivée de Donald Trump et ils sont largement trans-partisans. Le style va changer, les méthodes sans doute aussi, mais le nouveau président sera très vite «bordé» et de fait contrôlé par un entourage sérieux mais probablement plus réaliste que celui d'Hillary Clinton, qui augurait d'un interventionnisme classique dogmatique et moralisateur. Le monde n'en veut plus et n'y croit plus.
Néanmoins, on peut sans doute attendre - et espérer - quelques inflexions notables dans la façon qu'aura la nouvelle Administration de projeter la puissance américaine sur une scène internationale qui a considérablement évolué depuis 2008. Tout va donc dépendre de la confiance et du respect initial portés par les acteurs internationaux au nouveau leadership américain, mais aussi de la capacité de l'Europe à prendre son destin en main. Car le nouveau président, dont les discours de campagne ont souvent été contradictoires, a toutefois exprimé quelques convictions fortes: la Chine étant le peer competitor ultime de l'Amérique, le temps est venu pour l'Europe de se prendre davantage en charge pour sa sécurité, y compris au sein de l'OTAN, qui pourrait être appelée à évoluer vers une structure de lutte contre le terrorisme international plutôt que demeurer une alliance lourde préparant à grands frais des guerres … qui ne se mèneront pas.
Un homme d'État au pouvoir en France saisirait cette occasion historique pour impulser enfin, autour d'un petit noyau structurant, une vaste initiative de défense et de sécurité européenne, sans naturellement nier l'OTAN, mais en prenant en compte les intérêts propres de notre continent, et en y associant activement Moscou. Cela nécessiterait peut-être d'oser parler de notre sortie éventuelle du commandement militaire intégré de l'Alliance. En effet, notre «réintégration» en 2009, si elle nous associe désormais à la planification des opérations auxquelles nous participons, n'a en vérité pas vu notre poids décisionnel augmenter sensiblement. Or, la France doit retrouver une voix libre, totalement indépendante et forte. Il existe un «besoin de France» qui s'exprime toujours aux quatre coins de la planète et que nous ne pouvons ni ne devons plus ignorer.
Donald Trump a aussi dit vouloir en finir avec l'Accord sur le nucléaire iranien, essentiellement pour complaire à tel Aviv sans doute. Ce pourrait être une très forte source de tensions régionales…mais aussi une opportunité pour une nation telle que la France, dont le rôle doit être celui d'une puissance médiatrice et équilibrante. De mon point de vue, dans une politique étrangère nationale refondée, il faudrait au contraire savoir s'appuyer sur l'Iran et l'Inde pour promouvoir une stabilisation progressive de la région. La Russie l'a compris. La France devrait l'imiter, plus encore d'ailleurs, si l'Amérique ne le juge pas ou plus souhaitable, pour des raisons propres à sa relation particulière avec Israël. Nous avons ici aussi une belle carte à jouer.
Donald Trump veut encore en finir avec l'État islamique, et pour cela agir en convergence avec Moscou. On ne peut que s'en réjouir. Vladimir Poutine appelle à une coordination occidentale contre le terrorisme international depuis 2001, et plus encore depuis son implication militaire en Syrie à l'automne 2015. Mais le nouveau président américain a-t-il bien pris la mesure des implications considérables d'une telle détermination? Cela signifie en effet d'en finir avec une politique du chaos et de la déstabilisation des grands États laïcs, menée depuis le milieu des années 2000 par l'Amérique, la Turquie et le Qatar notamment, au profit du courant Frères musulmans ; de cesser immédiatement le soutien aux groupes islamistes prétendument modérés (par contraste avec la sauvagerie spectaculaire de l'EI) qui déchirent le corps de la malheureuse Syrie depuis 5ans pour s'en attribuer le pouvoir et les richesses. Il faut donc décider de sauver l'État syrien et préparer une transition politique crédible et viable au régime d'Assad. Cela veut dire, parallèlement, une politique de grande fermeté vis-à-vis du Qatar, de l'Arabie saoudite et de la Turquie, qui pourrait aller jusqu'à les contraindre à constituer une coalition arabe sunnite véritablement modérée et à cesser leurs doubles jeux délétères. Cela suppose enfin de mener au plus tôt une action diplomatique sincèrement convergente entre Washington et Moscou, pour imaginer et aménager une place politique aux sunnites irakiens mais aussi syriens sans laisser s'y immiscer Al-Qaïda et ses succédanés mêlés à des «reconvertis» de Daech, qui gardent pour cible la déstabilisation des monarchies pétrolières, mais aussi à terme, la fragilisation des nations européennes et de la civilisation occidentale en général.
Pour Paris, s'arrimer à une telle offensive en claire rupture avec l'actuelle politique occidentale au Moyen-Orient, lui permettrait de sortir d'une impasse et d'un piège aux implications sécuritaires majeures. Nous soutenons en effet de facto en Syrie un islamisme combattant qui nourrit la haine d'une frange de notre propre jeunesse sur notre territoire national et qui ourdit des attentats qui frappent nos concitoyens et minent notre résilience nationale. Nous devons là aussi faire un choix politique et identitaire, l'assumer sans états d'âme et le faire respecter en mettant notre action militaire extérieure enfin en cohérence avec cet objectif politique et sociétal intérieur.
On compare ici ou là, l'élection de Donald Trump au Brexit. C'est effectivement un second coup de semonce qui affecte l'Europe et la met au pied du mur de ses trop longues inconséquences. Soit l'Europe se reprend et saisit sa chance historique de refonder sa légitimité et de trouver sa place dans un monde qui est en train de se réarticuler sans elle, soit la vague de fond populiste, protectionniste et xénophobe, nourrie par le ralentissement de la croissance mondiale et ses conséquences en termes d'emploi et de creusement des inégalités risque, en France, en Italie, en Autriche, aux Pays Bas et ailleurs, de faire imploser un édifice européen fragilisé qui ne survivra pas longtemps s'il persiste à refuser de répondre aux enjeux identitaires, d'immigration et de frontières qui fragilisent sa légitimité profonde.
L'économisme béat a ses limites, le quantitative easing aussi. La croissance chinoise marque le pas, ce qui fait craindre une nouvelle crise financière et économique internationale, dont l'EU ne se relèvera pas en ordre dispersé et sans gouvernance politique forte. L'heure est donc au courage et à l'ambition.
Finalement, au lieu de geindre et de pousser des cris d'orfraie, il faut sans doute se réjouir. Le verdict du peuple américain est rafraîchissant et même rassurant. «L'empire» n'est pas mort. Il renaît de ses cendres et veut exister face à son challenger chinois. Dans ce vaste mouvement géostratégique, la position russe et la manière dont l'Amérique de Trump mais aussi l'Europe vont être capables d'en finir avec leurs vieux cauchemars de Guerre froide pour y associer la Russie, sont rien moins que cardinales. Nul doute que des pressions immenses - à Washington mais aussi en Europe de l'est - vont s'exercer pour poursuivre l'ostracisation de Moscou et la «construction d'un ennemi» qui fait la fortune de l'Alliance atlantique et celle du complexe militaro-industriel américain.
Pourtant le défi est bien plus grand. C'est l'Occident entier qui devrait faire taire des querelles dépassées pour conjuguer ses forces et stopper l'expansion d'un islamisme conquérant qui a décidé de déstabiliser le ventre mou européen, mais aussi la civilisation occidentale dans son ensemble dont l'Amérique se veut encore la championne. Or, n'en déplaise aux russophobes compulsifs à courte vue, la Russie est un bout d'Occident, et un bout d'Europe évidemment.
Se tromper d'ennemi par paresse intellectuelle, intérêt immédiat ou dogmatisme est criminel. La France et l'Europe sont sous le feu. Il faut oser une rupture cognitive, intellectuelle et même morale pour réintégrer la Russie dans notre camp, au lieu de la pousser dans les bras chinois qui pourraient l'asphyxier. La Chine est en embuscade en effet. Avec son pharaonique projet de «Nouvelle Route de la Soie», qui vise la création d'un marché asiatique gigantesque unique, l'accaparement des ressources économiques et énergétiques des pays traversés, le désenclavement du Pakistan et de l'Afghanistan, mais aussi, au bout de la mire, l'endiguement des puissances américaine et russe et le contournement de l'Inde, la Chine change de modèle de puissance. Elle passe d'une croissance intérieure à un déploiement de puissance et d'influence vers l'extérieur. Elle prend ses points d'appui en Asie centrale et au Moyen-Orient (mais aussi en Afrique et en Amérique latine) pour atteindre les marchés européens, via un maillage d'infrastructures terrestres et maritimes sans précédent, adossé à une renaissance militaire considérable et à des structures bancaires aux moyens colossaux. Nos technocrates européens s'en rendent-ils compte? Comment comptent-ils réagir, se défendre et/ou saisir les opportunités liées à ce projet? Silence radio. À terme, c'est une alternative financière et normative complète au FMI et à la Banque mondiale qui s'ébauche, avec le rêve d'une nouvelle monnaie de référence -chinoise- des échanges internationaux qui détrônera le dollar. Un «système de Bretton Woods-bis» en somme, mais qui ne dit pas encore son nom et avance à petits pas. Pékin est en train, à bas bruit, de mettre en place un véritable «contre-monde» global.
Alors? Et si l'on changeait enfin notre logiciel mental, et que l'on considérait ce nouveau président américain - après la «phase Obama» souhaitable pour faire oublier l'aventurisme militaire de Bush fils - comme une divine surprise, le héraut involontaire d'un «kairos» (moment opportun) stratégique inespéré pour l'Europe en pleine déconfiture? Cet homme est certes un peu «rough», rustique, emporté, mais aussi très humain, comme l'a montré son tout premier discours après la confirmation des résultats. C'est surtout un pragmatique. Il n'a pas peur du rapport de force et sans doute peut comprendre qu'un bon deal n'est pas forcément celui qui humilie le concurrent ou le détruit et que l'Amérique sera d'autant plus grande, admirée et suivie qu'elle saura nouer des relations plus équilibrées avec ses grands challengers et ses alliés. Dialoguer avec tout le monde est une marque de force et de confiance en soi, pas de faiblesse. Quant à «l'imprévisibilité» du nouveau Président, dont on veut croire qu'elle va rendre le monde plus instable, c'est sans doute l'une des marques même d'une personnalité de leader.
Nous sommes bien dans «la fin de la fin de l'Histoire». La question est: veut-on écrire une nouvelle Histoire, plus intelligente et humaine, ou nier l'évidence et se scléroser dans des schémas de pensée dépassés que la réalité du monde dément quotidiennement?
L'Amérique a en fait aujourd'hui l'occasion inédite de restaurer son crédit moral et politique mondial si entamé depuis 2001 et plus encore depuis 2003, et de retrouver un leadership basé sur une politique stabilisatrice plutôt que sur celle de l'organisation permanente du chaos au Moyen-Orient comme en Europe. Il faut s'en réjouir.
Ironie du sort, c'est peut-être le nouveau possible «reset» de la politique américaine vis-à-vis de la Russie qui conduira l'Europe à devoir elle-même reconsidérer son ostracisation entêtée de Moscou. Le prochain président français devra tenir compte de cette bascule géostratégique majeure, et, il faut le souhaiter, avoir l'intelligence d'initier et de nourrir une relation constructive et de dialogue respectueux avec notre grand voisin qui n'est pas notre ennemi, mais le pôle asiatique naturel d'une Europe des Nations qui compte enfin dans les nouveaux équilibres mondiaux.
«Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent» disait l'empereur Caligula. Peut-être Donald Trump est-il tombé un jour sur cette citation.
Caligula disait aussi: «j'aime le pouvoir car il donne ses chances à l'impossible». C'est plus engageant.
Caroline Galactéros (Bouger les lignes, 11 novembre 2016)