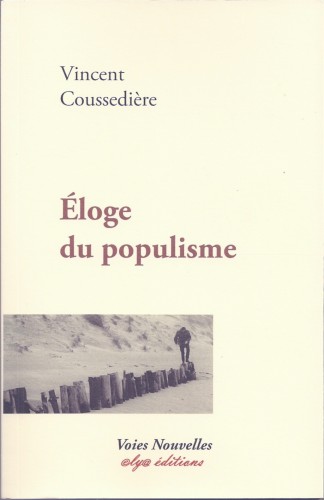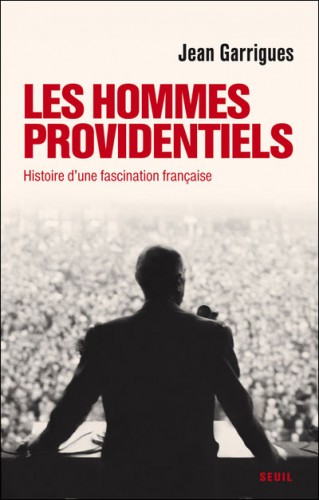Le peuple et "la France moisie"
Cette campagne présidentielle a montré de nouveau le mépris de certaines élites médiatiques vis-à-vis des classes populaires, en raison du score élevé du Front national, reprenant à leur compte le postulat de Philippe Sollers quant à l’existence d’une supposée « France moisie »1. Toutefois, évidemment, la réalité est plus subtile. À l’époque, ce texte avait fait scandale, mais l’idée persista et s’enracina chez certaines élites. Elle réapparut régulièrement depuis, tel un serpent de mer, chez des « faiseurs d’opinions » et chez certains intellectuels. Nous retrouvons dans leur bouche le même mépris du peuple que celui des bourgeois de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle : un mépris de classe, les expressions « peuple » et « classes populaires » ayant dans leur discours une même connotation fortement péjorative (les « classes dangereuses »). Cela montre surtout une chose : cette élite, à l’instar de la bourgeoisie arrogante du XIXe siècle, fait preuve à la fois d’une méconnaissance du « peuple » et, paradoxalement, d’une idéalisation de celui-ci ; il doit être comme ils l’imaginent et non pas tel qu’il est. Petit retour en arrière.
Rappel(s) historique(s)
L’idéalisation et la méconnaissance du peuple sont anciennes : elles sont parallèles à l’apprentissage de la démocratie en France, c’est-à-dire depuis le XIXe siècle2, voire dès l’Ancien Régime, avec le soulèvement de la Ligue et des Parlements. Les différents représentants de cette gauche du XIXe, en gros des républicains libéraux, en avaient peur et se demandaient s’il était assez mature pour participer à la vie politique. Les représentants des formations radicales, tels les blanquistes, le jugeaient apathique, voire inféodés à certains élus conservateurs. Ils se proposaient donc de le guider vers la bonne voie, via leurs chefs, ancêtres du révolutionnaire professionnel marxiste-léniniste. L’histoire de la gauche et du peuple dura jusqu’à la chute du communisme en 1989. Cependant, le divorce entre le parti communiste et les classes populaires commença dès la fin des années 1970, à une époque où ce parti surfait sur un national-communisme aux accents xénophobes, cherchant à arrêter l’immigration.
En effet, au cours de cette période, dans les bassins industriels, qui furent longtemps des bastions communiste, socialiste ou cégétiste, les votes ouvriers ont changé. Depuis le milieu des années 1980, ces régions connaissent une forte augmentation du vote Front national. Ce parti a commencé à séduire le monde ouvrier à partir de 1986, avant de l’attirer massivement à compter de 19953. Les classes populaires, ne sentant pas leurs revendications sociales prises en compte par les politiques, ont alors investi le champ idéologique identitaire comme une thématique de compensation, voire comme une volonté de réduire l’accès au travail, l’emploi se raréfiant. Ces deux points ont été cernés tôt et avec acuités par l’extrême droite. Ces thématiques ont été largement encouragées à cette époque par des stratèges d’extrême droite comme Jean-Yves Le Gallou, à l’origine avec Yvan Blot du concept de « préférence nationale ». Jean-Yves Le Gallou a joué un rôle théorique, une influence intellectuelle importante mais discrète à compter des années 1980. Dès le début des années 1970, alors membre à la fois du GRECE, du Club de l’Horloge (dont il est le cofondateur en 1974 avec Yvan Blot) et du Parti républicain, il condamna l’immigration de masse, destructrice de peuples. La décennie suivante, Le Gallou est l’un des premiers à théoriser cette « préférence nationale »4 et la combiner aux discours mixophobes issus de la Nouvelle Droite des années 1970. Dès lors, il va anticiper les positions identitaires et soutenir l’idée d’une immigration zéro, solution selon lui face à l’« invasion » que serait l’immigration.
Parallèlement à ces formulations, les références ouvrières furent abandonnées par les partis de gauche, au profit des classes moyennes, une stratégie encore à l’œuvre dans des think tank de gauche comme Terra Nova. L’origine de cette évolution de la gauche est à chercher, dans les acquis de Mai 68, et surtout dans les évolutions des sciences sociales qui en ont découlé. Cette évolution est flagrante, par exemple chez Henri Lefebvre dès le début des années soixante-dix. Celui-ci passa à cette époque du marxisme-léninisme à la défense de la « différence » : « S’il n’y a pas de peuple ou de “culture” privilégiés, il n’y a pas davantage identité ou analogie foncière entre les cultures, les façons de vivre. Chacune à sa raison d’exister, c’est-à-dire une raison de non-identité et de non-ressemblance. L’hypothèse d’une structure intellectuelle identique était encore réductrice. Il n’est dès lors plus question de substituer à la tyrannie des privilégiés celle des modèles prétendument généraux et toujours piégés. Que chacun découvre pour la prendre en charge, en usant de ses moyens (la langue, les œuvres, le style) sa différence. Qu’il l’a situe et l’accentue. À ses risques et périls. Ce qui peut se dire de vastes unités – “L’Afrique”, les “Jaunes”, l’Islam – peut aussi s’affirmer d’unités moindre : les Basques, les Bretons, les Occitans, les Canadiens français, etc. »5.
En outre, comme le remarque Slavoi Zizek, l’Autre, dans ce type de discours, est parfois « privé de son Altérité (cet autre idéalisé qui danse de façon fascinante, nourrit une approche écologique, saine et holiste de la réalité, dans lequel un phénomène comme celui des femmes battues n’a plus cours…) »6, ou, dans le cas inverse, enfermé dans une altérité extrême, dans une mise « sous cloche ». Dès lors, l’engouement postmoderniste pour le multiculturalisme et le différentialisme culturel devient compréhensible. Ce qui provoquera les évolutions que nous connaissons actuellement, et conduira en retour à la réaffirmation d’une forme d’ethnocentrisme.
Cette évolution a donc permis au Front national d’investir le rôle de « porte-parole » des « français d’en bas », substituant le marqueur identitaire de classe à celui de race : « La conjoncture économique et sociale, caractérisée par un niveau de chômage élevé, une désindustrialisation rapide et une forte dépendance des sociétés privées les plus performantes par rapport aux capitaux étrangers, produit, surtout parmi les classes moyennes et populaires, un mécontentement réel par rapport à la mondialisation libérale et au désengagement de l’État, caractérisé notamment par les coupes dans le service public et les privatisations.7 » Peut-on dire dès lors que les classes populaires ont basculées massivement vers l’extrême droite ? Cela est plus compliqué.
Une anthropologie du peuple
S’il est vrai que le vote frontiste est élevé chez les ouvriers, nous ne pouvons pas dire qu’ils votent tous pour le Front national. En revanche, d’un point de vue anthropologique, les milieux analysés développent un discours fortement structuré : ils condamnent la mondialisation, mais cette condamnation se double d’un refus des sociétés ouvertes, magistralement analysé en 1945 par Karl Popper8, c’est-à-dire démocratiques libérales en opposition aux « sociétés fermées » d’où est évacué l’« Autre ». Nous sommes en présence d’une sous-culture, à prendre dans le sens d’une subculture9, populaire, d’une sous-culture ouvrière10, d’une « culture du pauvre », comme pouvait la décrire Hoggart11 qui s’exprime par un sentiment d’appartenance sans conscience de classe, par une valorisation du « nous » et par conséquent par un rejet des « autres » qui ne sont pas comme « nous », sans autre forme d’idéologisation. Ce sentiment communautaire/affinitaire, pouvait être contenu, jusqu’au milieu des années 1980, par les partis et syndicats ouvriers et transcendé par un discours politique. Depuis cette époque, ce n’est plus le cas, et le « sens commun » partagé par ces classes populaires en crise d’identité, du fait de l’effacement de ses repères traditionnels, notamment produits par le monde du travail, fait que la qualité de « français » s’est substitué à l’ancienne qualification « d’ouvrier ».
En retour, ceux-ci font l’éloge des communautés enracinées. De fait, ces milieux, à défaut d’avoir en face de soi un « Autre » lointain et exotique, s’emploient « à mettre en distance le proche (individu ou groupe) pour mieux en faire émerger ce qui constitue “son” identité »12. Bref, « Le lieu de l’altérité s’est déplacé et en quelque sorte intériorisé »13. En outre, Claude Lévi-Strauss, que nous pouvons guère suspecter de racisme, a montré dans Race et culture, une conférence prononcée en 1971, que l’esprit de fermeture et l’hostilité envers l’étranger sont des propriétés inhérentes à l’espèce humaine, donc sur une forme de xénophobie, qui protégerait les sociétés de l’uniformisation, et assurerait donc leur pérennité. D’autres anthropologues ont montré que l’altérophobie est le versant péjoratif du sentiment d’appartenance communautaire ; tandis que l’ethnocentrisme entretient pour sa part des liens étroits avec ces deux éléments. Selon Jean-Pierre Warnier, « sous peine de se marginaliser, tout individu est, et doit être à quelque degré, atteint d’ethnocentrisme »14. Cet ethnocentrisme fait obstacle aux contacts entre les cultures. Il est donc distinct du racisme, mais peut être, parfois, l’expression d’un racisme mixophobique, en particulier dans les milieux d’extrême droite. Tout particulièrement, cet ethnocentrisme, sous ses différentes variantes (extrême ou subtil), se retrouve, au début des années 2000, dans les discours des mouvements dits « identitaires ». Globalement, depuis la fin du XIXe siècle, c’est dans notre système politique « l’extrême droite » qui occupe le créneau principal de ce « nationalisme politique ». On ne saurait cependant réduire les problématiques autophiles et altérophobes à ce champ idéologique15. Ne le nions pas, « l’ethnocentrisme peut prendre des formes extrême d’intolérance culturelle, religieuse, voire politique. Il peut aussi prendre des formes subtiles et rationnelles »16.
Ces discours correspondent aussi à ce que Pierre-André Taguieff a appelé
« […] la quatrième vague du nationalisme, celle que nos contemporains vivent dans la fausse conscience, la crainte et la culpabilité diffuse depuis quelques années, pourrait simplement se définir comme l’ensemble des réactions identitaires contre les effets ambigus, à la fois déstructurant et uniformisant, du “turbo-capitalisme”, réactions ethno-nationalistes et séparatistes suscitées par l’achèvement du marché planétaire stigmatisé en tant que “mondialisation sauvage”. Le néo-nationalisme, ou la quatrième vague du nationalisme, renvoie à des formes de mobilisation diversifiées (de l’ethnicité au fondamentalisme religieux), à différents modes de rébellion identitaire, ou plus précisément de résistance des “communautés” ou des identités collectives (dotées ou non d’une conscience nationale) aux effets désagrégateurs, voire désintégrateurs, de la globalisation économique et de la mondialisation de l’information et de la communication, dont les conséquences les plus visibles sont le chômage structurel, la fragilisation de la condition salariale et l’imposition d’une culture de masse planétaire, porteuse d’uniformisation appauvrissante, et plus ou moins violente, des valeurs et des formes de vie.17 »
Il s’agit donc d’une volonté de repli « entre soi », entre « mêmes » et en rejetant l’« Autre » par peur de l’« insécurité culturelle » provoquée par la mondialisation néolibérale. Nous sommes loin des discours de nos élites mondialisées dans lesquelles Jonathan Friedman voit l’expression d’un ethos cosmopolitique18 « propres aux nouvelles élites transnationales qui détiennent le pouvoir économique et exaltent les vertus de l’ouverture et du voyage »19, tel Jacques Attali. Marc Abélès, voit en outre, dans cette attitude, « un dénigrement de tout attachement au local, à l’État-nation, au collectif. Les “petits”, les rednecks, sont stigmatisés, eux qui se cramponnent à ces repères et qui demeurent “enracinés” »20, c’est-à-dire qui restent attachés à leur commune, à leur région, à leurs pratiques festives populaires, à leur lieu de travail.
Une communauté populaire antiprogressiste
En outre, il faut prendre en compte que le monde ouvrier n’est pas forcément intéressé par le progressisme. C’est la grande leçon de Jean-Claude Michéa. Selon, lui, le « peuple » et l’idée de « progrès », à prendre dans son sens sociétal, sont antinomiques : le peuple et ceux qui s’en inspirent s’oppose à l’idée de progrès, qui elle, est défendue par la gauche dite progressiste, faisant l’éloge du déracinement. Si cette dernière, issue des Lumières, fustige depuis les années 1980 l’enracinement, les coutumes et la tradition, les « gens ordinaires », pour reprendre l’une de ses expressions, s’y réfèrent et défendent des solidarités traditionnelles : c’est la « France moisie » de Sollers. Ainsi, Michéa écrit que « Tous ceux – ontologiquement incapables d’admettre que les temps changent – qui manifesteront, dans quelques domaines que ce soit, un quelconque attachement (ou une quelconque nostalgie) pour ce qui existait encore hier trahiront ainsi un inquiétant “conservatisme” ou même, pour les plus impies d’entre eux, une nature irrémédiablement “réactionnaire”.21 » Chez cette gauche, l’idée de progrès est directement associée au libéralisme. N’oublions pas que Georges Sorel voyait dans le progrès « une doctrine bourgeoise ». De fait, Michéa affirme que « le socialisme, à l’origine, n’était ni de gauche, ni de droite »22. En effet, dans les années 1830, lorsque le terme « socialisme » apparaît la gauche était incarnée par les libéraux, qui ne souhaitaient que réformer la société. Ce point a été très bien montré par Christopher Lasch : il a mis en évidence l’absence de « progressisme » dans les mouvements ouvriers et socialistes de cette époque23. Toutefois, cela peut mener soit vers un barrésisme en France, soit vers un socialisme lassalien en Allemagne.
Pour ces premiers militants, il ne faut pas l’oublier, la révolution industrielle met à mal les « communautés naturelles », c’est-à-dire villageoise. En ce sens, ils se placent dans la continuité de la « société naturelle traditionnelle », théorisée en 1887 par Ferdinand Tönnies. Celui-ci distinguait la Gesellschaft (« société ») de la Gemeinschaft (« communauté ») : la première était selon lui dirigée vers un objectif abstrait, la société, où les relations sont impersonnelles et les obligations morales à l’égard des autres personnes quasiment absentes et la seconde, au contraire, étant un lien social de type naturel et organique, la communauté24. Cette préoccupation communautaire se retrouvait aussi chez un Émile Durkheim, influencée en cela par des penseurs contre-révolutionnaires comme Joseph de Maistre et Louis de Bonald. De fait, la sociologie naissante se pencha sur les maux qui frappaient la communauté. Émile Durkheim, le premier titulaire de la chaire de sociologie, considérait en effet que la société moderne était frappée d’« anomie », c’est-à-dire une dérive sans but de gens sans liens sociaux. Il s’interrogea sur les raisons de cette anomie. Il se pencha tout particulièrement sur le remplacement de la solidarité « organique », c’est-à-dire sur les liens formés dans le contexte naturel des communautés villageoises, des familles et des paroisses, par la solidarité « mécanique », autrement dit sur les liens formés artificiellement par la propagande moderne et les médias. Cette réflexion doit être replacée dans son contexte historique : les premières révoltes socialistes, prémarxistes, visaient non seulement l’égoïsme libéral, mais aussi l’atomisation croissante de la société25. Nous sommes dans un contexte qui donne raison aux thèses de l’économiste socialiste hongrois Karl Polanyi, en particulier dans la continuité des thèses développées en 1944 dans La Grande transformation26 sur l’inexistence dans l’histoire d’un marché libre.
Toutefois, des auteurs comme Michéa ont tendance à oublier que l’idée de « préférence nationale », parfois rebaptisée « patriotisme social » par Marine Le Pen, n’est pas une innovation idéologique. La « protection du travail national » contre l’immigration de travail était un thème déjà bien connu en France depuis les dernières décennies du XIXe siècle, le socialiste Jules Guesde estimant ainsi que la main d’œuvre immigrée était une modalité patronale de casse des salaires et de la conscience prolétarienne. Les années 1880-1890 avaient vu diverses nouvelles dispositions juridiques limiter les possibilités d’emploi des étrangers en France, réservant certaines professions aux nationaux, tandis que la pratique judiciaire avait utilisé les dispositions prises à l’encontre du terrorisme anarchiste contre des réfugiés ipso facto amalgamés avec ce terrorisme sans raison empiriquement fondée27. Cette idée fut analysée en profondeur en 1997 par Marc Crapez dans sa Gauche réactionnaire28.
Par ailleurs, dans notre contexte de mondialisation29 et de démondialisation, la solidarité populaire, « communautaire » doit être vue comme une action positive. En effet, la communauté pourrait devenir donc l’une des formes possiblesde dépassement d’une modernité finissante. Le communautarisme permettrait aussi d’arrêter la dissolution du lien social, caractéristique, selon les théoriciens communautaristes anglo-saxons, de notre époque individualiste30. Cependant, nous devons préciser que certains de ces théoriciens communautariens, comme Charles Taylor ou Michael Walzer, ne sont pas fermés à la modernité, mais sont, avant tout, des observateurs attentifs des traits singuliers de certaines « sphères de justice », selon l’expression de ce dernier31. Cette notion de « communauté » renvoie aussi à des pratiques sociales disparues : la réciprocité, l’entraide, la solidarité, les valeurs partagées, etc. De ce point de vue, le mythe communautaire institue, crée du social. Il porte en lui une forte contestation de la réalité, foncièrement néolibérale et destructrice32. Il donne en retour du sens aux déceptions et aux frustrations, permet l’élaboration des projets de régénération de l’ordre social, et enfin, nourrit l’attente d’un bouleversement radical, qui peut être vu dans le vote pour un parti comme le Front national.
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que les bourgeois votent aussi pour le Front national, mais en une optique complètement différente, voire opposée : par antisocialisme, et par habitus culturels. Également, il ne faut pas oublier que la critique du « bobo » conspuant l’électeur frontiste issu des classes populaire masque fréquemment une autre forme du mépris de classe, issu d’une bourgeoisie réactionnaire et cherchant à légitimer en retour un discours que nous pourrions qualifier de « lepénisant ». En effet, par une pirouette conceptuelle, ces personnes, comme Éric Zemmour, ou ces médias, tel Causeur, qui, en condamnant la « boboïtude », tente à la fois de légitimer un discours altérophobe ( avec la critique omniprésente des individus d’origine arabo-musulmanes), proche de celui du Front national et de déligitimer la gauche, forcément « bobo » et mondialiste, auprès des classes populaires et moyennes paupérisées, tout en cherchant à préserver le néolibéralisme.
Φ
L’étude de ces milieux sociaux, populaires, montre un net scepticisme à l’égard de l’expertocratie médiatique, vue comme le lieu de l’émission de la « pensée unique », voire un lieu d’émission d’une « science officielle ». En ce sens, les couches populaires suivent Nietzsche qui écrivait : « Maintenant, pour atteindre la connaissance, il faut trébucher sur des mots devenus éternels et durs comme de la pierre, et la jambe se cassera plus facilement que le mot »33… Ce qui n’est pas forcément un mal. Toutefois, les personnes étudiées ici ont un trait psychologique marqué, commun avec les milieux conservateurs : ils refusent de faire confiance aux hommes et au temps. Or, cette méfiance est l’une des caractéristiques du discours de droite. Et ce point déplaît aux belles âmes qui y voient l’expression d’une « idéologie française »34, quand ils ne considèrent pas les électeurs du Front national comme de grands enfants caractériels qui ont besoin d’une leçon, comme le firent Caroline Fourest et Fiammenta Venner35. Mais, il est vrai que dans cette vision du monde, le présent est odieux en ce qu’il est une étape de la dégradation d’un modèle d’origine valorisé comme un temps béni, un paradis, perdu sous les coups de la modernité36. Pourtant, certains, tel l’écologiste Jean-Paul Besset, essaient ne plus être « progressiste sans devenir réactionnaire »37 : il s’agit, selon nous, de la voie à suivre pour récupérer de nouveau les voix des classes populaires, l’objectif étant de défendre une démondialisation et les emplois industriels. En outre, un intellectuel comme Christopher Lasch, a réhabilité une forme de populisme dans son ouvrage La Révolte des élites, paru en 1995 et traduit en français dès l’année suivante38. Il s’agit aussi d’un exemple à suivre, les classes populaires n’ayant plus confiance dans l’« expertocratie » médiatique, expression, avant tout, de la pensée unique qui a fait tant de ravage. En effet, pendant longtemps nous avons cru en Occident à la révolte des masses. Or, de nos jours, la menace viendrait plutôt de la pensée unique émanant de nos « élites politico-médiatiques ». Il est temps de relire Lasch et de mener un combat pour la liberté et l’égalité au nom des vertus populaires.
Stéphane François (Fragments sur les temps présents, 7 mai 2012)
Notes
1 Philippe Sollers, Le Monde, 28 janvier 1999.
2 Laurent Bouvet, Le Sens du peuple. La gauche, la démocratie, le populisme, Paris, Gallimard, 2012.
3 Nonna Mayer, Ces Français qui votent Le Pen, Paris, Flammarion, 2002, pp. 35-36. Voir aussi Jean-Yves Camus, Le Front national, histoire et analyse, Paris, Éditions Olivier Laurens, 1996 et Erwan Lecoeur, Un Néo-populisme à la française. 30 ans de Front national, Paris, La Découverte, 2003.
4 Jean-Yves Le Gallou, La Préférence nationale. Réponse à l’immigration, Paris, Albin Michel, 1985.
5 Henri Lefebvre, « Le Manifeste différentialiste », inStéphane Courtois, Jean-Pierre Deschodt et Yolène Dilas-Rocherieux (dir.), Démocratie et révolution. 1789-2011. 100 textes fondateurs, Paris, Éditions du Cerf, 2012,p. 1033.
6 Slavoi Zizek, Bienvenue dans le désert du réel, Paris, Flammarion, 2005, p. 31.
7 Jean-Yves Camus, « Le Front national : état des forces en perspective », Les Cahiers du CRIF, n°5, novembre 2004, p. 8.
8 Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis, Paris, Seuil 1979, p. 20.
9 Nous employons le terme « subculture », à « sous-culture », car cette dernière expression « contre-culture » a une connotation négative, dommageable pour la compréhension de l’idée sous-jacente.
10 Cf. Michel Wieviorka, La France raciste, Paris, Seuil, 1992.
11 Richard Hoggart, La Culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970.
12 Marc Abélès, Anthropologie de la globalisation, Paris, Payot, 2012, p. 79.
13 Marc Augé, « Qui est l’autre ? Un itinéraire anthropologique », L’Homme, n° 103, 1987, pp. 7-26.
14 Jean-Pierre Warnier, La Mondialisation de la culture, La Découverte, Paris, 2003, p. 29.
15 Cf. Nicolas Lebourg, « La diffusion des péjorations communautaires après 1945. Les nouvelles altérophobies », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 267, 2011, p. 35-58.
16 Denys Cuche, La Notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, Paris, 2010, p. 23.
17 Pierre-André Taguieff L’Effacement de l’avenir, Paris, Galilée, 2000, p. 157.
18 Jonathan Friedman, « Globalization », in M. Edelman & A. Haugerud (dir.), The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism, Malden, Blackwells, 2005, pp. 179-197.
19 Marc Abélès, Anthropologie de la globalisation, op. cit., p. 34.
20 Ibid., p. 34.
21 Jean-Claude Michéa, Le Complexe d’Orphée. La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, Paris, Climats, 2011, p. 14.
22 Ibid., p. 22.
23 Christopher Lasch, Le Seul et vrai paradis. Une histoire de l’idéologie du progrès et de ses critiques, Paris, Climats, 2002.
24 Cf. Ferdinand Tönnies, Communauté et société, Paris, Presses Universitaires de France, 1946.
25 Sur le premier socialisme français, voir Tony Judt, Le Marxisme et la gauche française 1830-1981, Paris, Hachette, 1987, en particulier les pages 37-123.
26 Karl Polanyi, La Grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983.
27 Léon Gani, « Jules Guesde, Paul Lafargue et les problèmes de population », Population, n°6, 1979, pp. 1023-1044 ; Pierre Guillen, « L’Evolution du statut des migrants en France aux XIXe-XXe siècles », L’Emigration politique en Europe aux XIXe et XXe siècles. Actes du colloque de Rome (3-5 mars 1988), École Française de Rome, Rome, 1991. pp. 35-55 ; Laurent Dornel, La France hostile. Socio-histoire de la xénophobie en France (1870-1914), Hachette Littératures, Paris, 2004.
28 Marc Crapez, La Gauche réactionnaire. Mythes de la plèbe et de la race, Paris, Berg International, 1997.
29 Cf. Marc Abélès, Anthropologie de la globalisation, Paris, Payot, 2012.
30 Cf. Laurent Bouvet, Le Communautarisme: Mythe et réalité, Paris, Lignes de repères Éditions, 2007.
31 Cf. Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Aubier, 1994 ; Michael Walzer, Pluralisme et démocratie, Paris, Esprit, 1997.
32 Serge Audier, Néo-libéralisme(s). Une archéologie intellectuelle, Paris, Grasset, 2012
33 Friedrich Nietzsche, Aurore, inŒuvres complètes, t. 1, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1993, p. 998.
34 Bernard-Henri Lévy, L’idéologie française, Paris, Grasset, 1981.
35 Caroline Fourest & Fiammenta Venner, Marine Le Pen, Paris, Grasset, 2011.
36 Michel Winock, « L’éternelle décadence », Lignes, nº 4, octobre 1988, p. 62.
37 Jean-Paul Besset, Comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire, Paris, Fayard, 2005.
38 Christopher Lasch, La Révolte des élites, Paris, Climats, 1996.