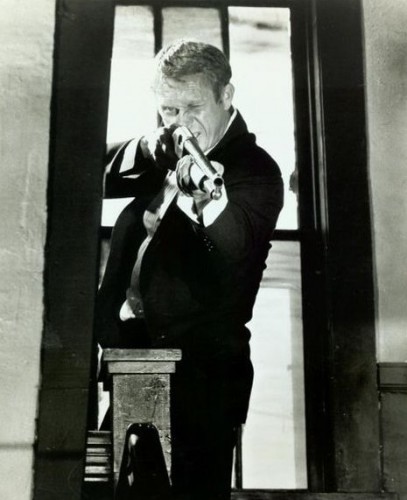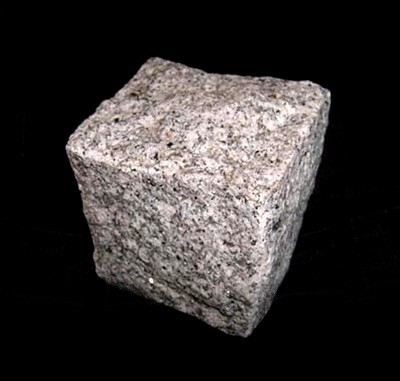Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Jacques Sapir, cueilli sur son carnet RussEurope et consacré aux résultats des élections italiennes...

Sur les élections italiennes
Les résultats des élections italiennes à peine connus, les commentaires allaient bon train. Le gouvernement français s’est empressé, lui aussi, de faire un communiqué pour minimiser l’importance de ces résultats. Il eût mieux valu qu’il s’affronte directement à la réalité, ne serait-ce que pour en tirer les leçons. Mais on préfère s’enfermer dans une attitude de déni, cette fois avec l’appui d’une partie de la presse française. Que n’avait-on chanté les louanges du dirigeant du Parti Démocrate, Luigi Bersani ou du technocrate tourné politicien Mario Monti. Il suffisait pourtant de sortir de la bulle parisienne, de regarder la presse italienne, britannique ou américaine pour avoir une petite idée de ce qui allait se passer. Mais il est dit qu’il n’y a pas de réalité en dehors de ce que certains cénacles veulent bien dire… Alors, regardons un peu ces élections, et leurs résultats, et cherchons à en extraire les points importants.
Le premier point qui émerge de ces résultats est à l’évidence l’ampleur du désaveu des politiques inspirées par Bruxelles et Berlin, mais aussi, il faut s’en souvenir, par Paris. Les partis défendant ces politiques n’ont représenté que 40% des électeurs (le PD de gauche de Bersani 29,5% et l’alliance du centre-droit de Mario Monti 10,5%). Les partis refusant ces politiques, et refusant en réalité la logique de l’Euro, ont remporté plus de 54% des suffrages (le PDL de Silvio Berlusconi 29% et le M5S de Beppe Grillo 25,4%). On ne saurait imaginer plus cinglant démenti apporté à ceux qui présentaient le gouvernement Monti comme un « sauveur » de l’Italie. La multiplication d’impôts, souvent vécus comme injustes, les coupes sauvages dans le budget dont ont été victimes les hôpitaux, les écoles, mais aussi le système de retraite, les retards scandaleux de paiements de la part l’État, expliquent largement cette situation. La presse française peut gloser sur la « machine » Berlusconi, elle ne saurait éternellement cacher le fait que si un homme politique chassé sous les huées revient quasiment en triomphateur, c’est bien parce qu’il y a un rejet massif de la politique mise en place par ses successeurs. De plus, ce discours convenu ne saurait expliquer le succès du Mouvement 5 Étoiles (M5S) de Beppe Grillo.
Ceci conduit alors au deuxième point important : l’erreur manifeste des sondeurs et des estimations de « sortie des urnes ». Deux partis ont été les « victimes » de ces erreurs, le PD, crédité de plus de 33% et se situant finalement à 29,5% (environ 4 points d’écart) et l’alliance de centre droit de Mario Monti crédité par les estimations de 12% et n’en faisant en réalité que 10,5%. Le PDL de Silvio Berlusconi apparaît comme relativement stable. C’est donc le M5S qui a bénéficié de ces erreurs, étant crédité de 18% à 20% et faisant en réalité plus de 25% des suffrages. Il convient immédiatement de dire que ces élections étaient les premières élections générales auxquelles se présentait le M5S. La tache des sondeurs et des prévisionnistes était donc des plus difficiles. Mais, si l’on considère les chiffres, et si l’on admet qu’un certain nombre d’électeurs du M5S (1 sur 5) n’ont pas souhaité faire état de leur vote dans les sondages de « sortie des urnes », cela signifie que des anciens électeurs tant de gauche que du centre droit ont basculé vers le mouvement de Bepe Grillo. Cette hypothèse est confortée par la remarquable stabilité entre prévisions et résultats réels pour le PDL, qui confirme le fait que Silvio Berlusconi est bien reconnu comme le chef de sa formation et que son discours est largement assumé par ses électeurs. Le vote pour le PDL n’a pas été un vote « honteux », bien au contraire, mais clairement assumé. La signification de ceci est qu’il faut chercher essentiellement à gauche (et secondairement au centre droit) le véritable réservoir des forces du M5S.
Ceci conduit alors au troisième point : les électeurs italiens voulaient envoyer un message et ils ont utilisé à cette fin les moyens qui étaient à leur disposition. On peut gloser sur le système électoral italien, certes plus « byzantin » que romain ; on peut faire tous les commentaires possibles et imaginables sur la rhétorique tant de Berlusconi, couvert de scandales et rescapé du « bunga-bunga », que de Bepe Grillo. À défaut de partis plus présentables, les Italiens ont voté pour ceux qui leur paraissaient les moins nocifs, autrement dit les moins engagés dans la politique mortifère d’austérité et les moins soumis aux ordres de Bruxelles et aux diktats de Berlin. On est en présence d’une protestation structurée bien plus que d’un simple vote « protestataire ». Le fait que le M5S ait gagné certaines villes lors des dernières élections municipales aurait dû alerter les observateurs. On assiste en fait au début d’un processus d’enracinement du M5S.
Les conséquences pour la coalition de gauche que représente le Parti Démocrate sont importantes. L’érosion de ce parti dans les derniers sondages, puis dans les résultats, est particulièrement importante. Crédité de 35% à moins d’un mois du vote, il se retrouve finalement avec 29,5%. Le problème réside dans la position intenable qu’il adopta : celle de défendre une « austérité à visage humain ». Les Italiens ont intuitivement compris que de visage humain, il n’y en aurait guère et que seule resterait l’austérité. Mais cela pose un redoutable problème aux forces dites « social-démocrates » en Europe du Sud. Leurs discours n’ont plus aucune crédibilité dans le cadre économique qui est celui de la zone Euro. Il faut soit adopter un discours traditionnel de droite, soit rompre avec les chimères d’une Europe fédérale ; il n’y a plus de demi-mesures possibles.
Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
C’est bien à une rébellion légitime que nous avons assisté lors de ces élections. Il convient d’en prendre conscience.
Jacques Sapir (RussEurope, 26 février 2013)
Les résultats des élections italiennes à peine connus, les commentaires allaient bon train. Le gouvernement français s’est empressé, lui aussi, de faire un communiqué pour minimiser l’importance de ces résultats. Il eût mieux valu qu’il s’affronte directement à la réalité, ne serait-ce que pour en tirer les leçons. Mais on préfère s’enfermer dans une attitude de déni, cette fois avec l’appui d’une partie de la presse française. Que n’avait-on chanté les louanges du dirigeant du Parti Démocrate, Luigi Bersani ou du technocrate tourné politicien Mario Monti. Il suffisait pourtant de sortir de la bulle parisienne, de regarder la presse italienne, britannique ou américaine pour avoir une petite idée de ce qui allait se passer. Mais il est dit qu’il n’y a pas de réalité en dehors de ce que certains cénacles veulent bien dire… Alors, regardons un peu ces élections, et leurs résultats, et cherchons à en extraire les points importants.
Le premier point qui émerge de ces résultats est à l’évidence l’ampleur du désaveu des politiques inspirées par Bruxelles et Berlin, mais aussi, il faut s’en souvenir, par Paris. Les partis défendant ces politiques n’ont représenté que 40% des électeurs (le PD de gauche de Bersani 29,5% et l’alliance du centre-droit de Mario Monti 10,5%). Les partis refusant ces politiques, et refusant en réalité la logique de l’Euro, ont remporté plus de 54% des suffrages (le PDL de Silvio Berlusconi 29% et le M5S de Beppe Grillo 25,4%). On ne saurait imaginer plus cinglant démenti apporté à ceux qui présentaient le gouvernement Monti comme un « sauveur » de l’Italie. La multiplication d’impôts, souvent vécus comme injustes, les coupes sauvages dans le budget dont ont été victimes les hôpitaux, les écoles, mais aussi le système de retraite, les retards scandaleux de paiements de la part l’État, expliquent largement cette situation. La presse française peut gloser sur la « machine » Berlusconi, elle ne saurait éternellement cacher le fait que si un homme politique chassé sous les huées revient quasiment en triomphateur, c’est bien parce qu’il y a un rejet massif de la politique mise en place par ses successeurs. De plus, ce discours convenu ne saurait expliquer le succès du Mouvement 5 Étoiles (M5S) de Beppe Grillo.
Ceci conduit alors au deuxième point important : l’erreur manifeste des sondeurs et des estimations de « sortie des urnes ». Deux partis ont été les « victimes » de ces erreurs, le PD, crédité de plus de 33% et se situant finalement à 29,5% (environ 4 points d’écart) et l’alliance de centre droit de Mario Monti crédité par les estimations de 12% et n’en faisant en réalité que 10,5%. Le PDL de Silvio Berlusconi apparaît comme relativement stable. C’est donc le M5S qui a bénéficié de ces erreurs, étant crédité de 18% à 20% et faisant en réalité plus de 25% des suffrages. Il convient immédiatement de dire que ces élections étaient les premières élections générales auxquelles se présentait le M5S. La tache des sondeurs et des prévisionnistes était donc des plus difficiles. Mais, si l’on considère les chiffres, et si l’on admet qu’un certain nombre d’électeurs du M5S (1 sur 5) n’ont pas souhaité faire état de leur vote dans les sondages de « sortie des urnes », cela signifie que des anciens électeurs tant de gauche que du centre droit ont basculé vers le mouvement de Bepe Grillo. Cette hypothèse est confortée par la remarquable stabilité entre prévisions et résultats réels pour le PDL, qui confirme le fait que Silvio Berlusconi est bien reconnu comme le chef de sa formation et que son discours est largement assumé par ses électeurs. Le vote pour le PDL n’a pas été un vote « honteux », bien au contraire, mais clairement assumé. La signification de ceci est qu’il faut chercher essentiellement à gauche (et secondairement au centre droit) le véritable réservoir des forces du M5S.
Ceci conduit alors au troisième point : les électeurs italiens voulaient envoyer un message et ils ont utilisé à cette fin les moyens qui étaient à leur disposition. On peut gloser sur le système électoral italien, certes plus « byzantin » que romain ; on peut faire tous les commentaires possibles et imaginables sur la rhétorique tant de Berlusconi, couvert de scandales et rescapé du « bunga-bunga », que de Bepe Grillo. À défaut de partis plus présentables, les Italiens ont voté pour ceux qui leur paraissaient les moins nocifs, autrement dit les moins engagés dans la politique mortifère d’austérité et les moins soumis aux ordres de Bruxelles et aux diktats de Berlin. On est en présence d’une protestation structurée bien plus que d’un simple vote « protestataire ». Le fait que le M5S ait gagné certaines villes lors des dernières élections municipales aurait dû alerter les observateurs. On assiste en fait au début d’un processus d’enracinement du M5S.
Les conséquences pour la coalition de gauche que représente le Parti Démocrate sont importantes. L’érosion de ce parti dans les derniers sondages, puis dans les résultats, est particulièrement importante. Crédité de 35% à moins d’un mois du vote, il se retrouve finalement avec 29,5%. Le problème réside dans la position intenable qu’il adopta : celle de défendre une « austérité à visage humain ». Les Italiens ont intuitivement compris que de visage humain, il n’y en aurait guère et que seule resterait l’austérité. Mais cela pose un redoutable problème aux forces dites « social-démocrates » en Europe du Sud. Leurs discours n’ont plus aucune crédibilité dans le cadre économique qui est celui de la zone Euro. Il faut soit adopter un discours traditionnel de droite, soit rompre avec les chimères d’une Europe fédérale ; il n’y a plus de demi-mesures possibles.
 Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
C’est bien à une rébellion légitime que nous avons assisté lors de ces élections. Il convient d’en prendre conscience.
- See more at: http://russeurope.hypotheses.org/936#sthash.XCl0iaEQ.dpufLes résultats des élections italiennes à peine connus, les commentaires allaient bon train. Le gouvernement français s’est empressé, lui aussi, de faire un communiqué pour minimiser l’importance de ces résultats. Il eût mieux valu qu’il s’affronte directement à la réalité, ne serait-ce que pour en tirer les leçons. Mais on préfère s’enfermer dans une attitude de déni, cette fois avec l’appui d’une partie de la presse française. Que n’avait-on chanté les louanges du dirigeant du Parti Démocrate, Luigi Bersani ou du technocrate tourné politicien Mario Monti. Il suffisait pourtant de sortir de la bulle parisienne, de regarder la presse italienne, britannique ou américaine pour avoir une petite idée de ce qui allait se passer. Mais il est dit qu’il n’y a pas de réalité en dehors de ce que certains cénacles veulent bien dire… Alors, regardons un peu ces élections, et leurs résultats, et cherchons à en extraire les points importants.
Le premier point qui émerge de ces résultats est à l’évidence l’ampleur du désaveu des politiques inspirées par Bruxelles et Berlin, mais aussi, il faut s’en souvenir, par Paris. Les partis défendant ces politiques n’ont représenté que 40% des électeurs (le PD de gauche de Bersani 29,5% et l’alliance du centre-droit de Mario Monti 10,5%). Les partis refusant ces politiques, et refusant en réalité la logique de l’Euro, ont remporté plus de 54% des suffrages (le PDL de Silvio Berlusconi 29% et le M5S de Beppe Grillo 25,4%). On ne saurait imaginer plus cinglant démenti apporté à ceux qui présentaient le gouvernement Monti comme un « sauveur » de l’Italie. La multiplication d’impôts, souvent vécus comme injustes, les coupes sauvages dans le budget dont ont été victimes les hôpitaux, les écoles, mais aussi le système de retraite, les retards scandaleux de paiements de la part l’État, expliquent largement cette situation. La presse française peut gloser sur la « machine » Berlusconi, elle ne saurait éternellement cacher le fait que si un homme politique chassé sous les huées revient quasiment en triomphateur, c’est bien parce qu’il y a un rejet massif de la politique mise en place par ses successeurs. De plus, ce discours convenu ne saurait expliquer le succès du Mouvement 5 Étoiles (M5S) de Beppe Grillo.
Ceci conduit alors au deuxième point important : l’erreur manifeste des sondeurs et des estimations de « sortie des urnes ». Deux partis ont été les « victimes » de ces erreurs, le PD, crédité de plus de 33% et se situant finalement à 29,5% (environ 4 points d’écart) et l’alliance de centre droit de Mario Monti crédité par les estimations de 12% et n’en faisant en réalité que 10,5%. Le PDL de Silvio Berlusconi apparaît comme relativement stable. C’est donc le M5S qui a bénéficié de ces erreurs, étant crédité de 18% à 20% et faisant en réalité plus de 25% des suffrages. Il convient immédiatement de dire que ces élections étaient les premières élections générales auxquelles se présentait le M5S. La tache des sondeurs et des prévisionnistes était donc des plus difficiles. Mais, si l’on considère les chiffres, et si l’on admet qu’un certain nombre d’électeurs du M5S (1 sur 5) n’ont pas souhaité faire état de leur vote dans les sondages de « sortie des urnes », cela signifie que des anciens électeurs tant de gauche que du centre droit ont basculé vers le mouvement de Bepe Grillo. Cette hypothèse est confortée par la remarquable stabilité entre prévisions et résultats réels pour le PDL, qui confirme le fait que Silvio Berlusconi est bien reconnu comme le chef de sa formation et que son discours est largement assumé par ses électeurs. Le vote pour le PDL n’a pas été un vote « honteux », bien au contraire, mais clairement assumé. La signification de ceci est qu’il faut chercher essentiellement à gauche (et secondairement au centre droit) le véritable réservoir des forces du M5S.
Ceci conduit alors au troisième point : les électeurs italiens voulaient envoyer un message et ils ont utilisé à cette fin les moyens qui étaient à leur disposition. On peut gloser sur le système électoral italien, certes plus « byzantin » que romain ; on peut faire tous les commentaires possibles et imaginables sur la rhétorique tant de Berlusconi, couvert de scandales et rescapé du « bunga-bunga », que de Bepe Grillo. À défaut de partis plus présentables, les Italiens ont voté pour ceux qui leur paraissaient les moins nocifs, autrement dit les moins engagés dans la politique mortifère d’austérité et les moins soumis aux ordres de Bruxelles et aux diktats de Berlin. On est en présence d’une protestation structurée bien plus que d’un simple vote « protestataire ». Le fait que le M5S ait gagné certaines villes lors des dernières élections municipales aurait dû alerter les observateurs. On assiste en fait au début d’un processus d’enracinement du M5S.
Les conséquences pour la coalition de gauche que représente le Parti Démocrate sont importantes. L’érosion de ce parti dans les derniers sondages, puis dans les résultats, est particulièrement importante. Crédité de 35% à moins d’un mois du vote, il se retrouve finalement avec 29,5%. Le problème réside dans la position intenable qu’il adopta : celle de défendre une « austérité à visage humain ». Les Italiens ont intuitivement compris que de visage humain, il n’y en aurait guère et que seule resterait l’austérité. Mais cela pose un redoutable problème aux forces dites « social-démocrates » en Europe du Sud. Leurs discours n’ont plus aucune crédibilité dans le cadre économique qui est celui de la zone Euro. Il faut soit adopter un discours traditionnel de droite, soit rompre avec les chimères d’une Europe fédérale ; il n’y a plus de demi-mesures possibles.
 Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
C’est bien à une rébellion légitime que nous avons assisté lors de ces élections. Il convient d’en prendre conscience.
- See more at: http://russeurope.hypotheses.org/936#sthash.XCl0iaEQ.dpufLes résultats des élections italiennes à peine connus, les commentaires allaient bon train. Le gouvernement français s’est empressé, lui aussi, de faire un communiqué pour minimiser l’importance de ces résultats. Il eût mieux valu qu’il s’affronte directement à la réalité, ne serait-ce que pour en tirer les leçons. Mais on préfère s’enfermer dans une attitude de déni, cette fois avec l’appui d’une partie de la presse française. Que n’avait-on chanté les louanges du dirigeant du Parti Démocrate, Luigi Bersani ou du technocrate tourné politicien Mario Monti. Il suffisait pourtant de sortir de la bulle parisienne, de regarder la presse italienne, britannique ou américaine pour avoir une petite idée de ce qui allait se passer. Mais il est dit qu’il n’y a pas de réalité en dehors de ce que certains cénacles veulent bien dire… Alors, regardons un peu ces élections, et leurs résultats, et cherchons à en extraire les points importants.
Le premier point qui émerge de ces résultats est à l’évidence l’ampleur du désaveu des politiques inspirées par Bruxelles et Berlin, mais aussi, il faut s’en souvenir, par Paris. Les partis défendant ces politiques n’ont représenté que 40% des électeurs (le PD de gauche de Bersani 29,5% et l’alliance du centre-droit de Mario Monti 10,5%). Les partis refusant ces politiques, et refusant en réalité la logique de l’Euro, ont remporté plus de 54% des suffrages (le PDL de Silvio Berlusconi 29% et le M5S de Beppe Grillo 25,4%). On ne saurait imaginer plus cinglant démenti apporté à ceux qui présentaient le gouvernement Monti comme un « sauveur » de l’Italie. La multiplication d’impôts, souvent vécus comme injustes, les coupes sauvages dans le budget dont ont été victimes les hôpitaux, les écoles, mais aussi le système de retraite, les retards scandaleux de paiements de la part l’État, expliquent largement cette situation. La presse française peut gloser sur la « machine » Berlusconi, elle ne saurait éternellement cacher le fait que si un homme politique chassé sous les huées revient quasiment en triomphateur, c’est bien parce qu’il y a un rejet massif de la politique mise en place par ses successeurs. De plus, ce discours convenu ne saurait expliquer le succès du Mouvement 5 Étoiles (M5S) de Beppe Grillo.
Ceci conduit alors au deuxième point important : l’erreur manifeste des sondeurs et des estimations de « sortie des urnes ». Deux partis ont été les « victimes » de ces erreurs, le PD, crédité de plus de 33% et se situant finalement à 29,5% (environ 4 points d’écart) et l’alliance de centre droit de Mario Monti crédité par les estimations de 12% et n’en faisant en réalité que 10,5%. Le PDL de Silvio Berlusconi apparaît comme relativement stable. C’est donc le M5S qui a bénéficié de ces erreurs, étant crédité de 18% à 20% et faisant en réalité plus de 25% des suffrages. Il convient immédiatement de dire que ces élections étaient les premières élections générales auxquelles se présentait le M5S. La tache des sondeurs et des prévisionnistes était donc des plus difficiles. Mais, si l’on considère les chiffres, et si l’on admet qu’un certain nombre d’électeurs du M5S (1 sur 5) n’ont pas souhaité faire état de leur vote dans les sondages de « sortie des urnes », cela signifie que des anciens électeurs tant de gauche que du centre droit ont basculé vers le mouvement de Bepe Grillo. Cette hypothèse est confortée par la remarquable stabilité entre prévisions et résultats réels pour le PDL, qui confirme le fait que Silvio Berlusconi est bien reconnu comme le chef de sa formation et que son discours est largement assumé par ses électeurs. Le vote pour le PDL n’a pas été un vote « honteux », bien au contraire, mais clairement assumé. La signification de ceci est qu’il faut chercher essentiellement à gauche (et secondairement au centre droit) le véritable réservoir des forces du M5S.
Ceci conduit alors au troisième point : les électeurs italiens voulaient envoyer un message et ils ont utilisé à cette fin les moyens qui étaient à leur disposition. On peut gloser sur le système électoral italien, certes plus « byzantin » que romain ; on peut faire tous les commentaires possibles et imaginables sur la rhétorique tant de Berlusconi, couvert de scandales et rescapé du « bunga-bunga », que de Bepe Grillo. À défaut de partis plus présentables, les Italiens ont voté pour ceux qui leur paraissaient les moins nocifs, autrement dit les moins engagés dans la politique mortifère d’austérité et les moins soumis aux ordres de Bruxelles et aux diktats de Berlin. On est en présence d’une protestation structurée bien plus que d’un simple vote « protestataire ». Le fait que le M5S ait gagné certaines villes lors des dernières élections municipales aurait dû alerter les observateurs. On assiste en fait au début d’un processus d’enracinement du M5S.
Les conséquences pour la coalition de gauche que représente le Parti Démocrate sont importantes. L’érosion de ce parti dans les derniers sondages, puis dans les résultats, est particulièrement importante. Crédité de 35% à moins d’un mois du vote, il se retrouve finalement avec 29,5%. Le problème réside dans la position intenable qu’il adopta : celle de défendre une « austérité à visage humain ». Les Italiens ont intuitivement compris que de visage humain, il n’y en aurait guère et que seule resterait l’austérité. Mais cela pose un redoutable problème aux forces dites « social-démocrates » en Europe du Sud. Leurs discours n’ont plus aucune crédibilité dans le cadre économique qui est celui de la zone Euro. Il faut soit adopter un discours traditionnel de droite, soit rompre avec les chimères d’une Europe fédérale ; il n’y a plus de demi-mesures possibles.
 Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
C’est bien à une rébellion légitime que nous avons assisté lors de ces élections. Il convient d’en prendre conscience.
- See more at: http://russeurope.hypotheses.org/936#sthash.XCl0iaEQ.dpufLes résultats des élections italiennes à peine connus, les commentaires allaient bon train. Le gouvernement français s’est empressé, lui aussi, de faire un communiqué pour minimiser l’importance de ces résultats. Il eût mieux valu qu’il s’affronte directement à la réalité, ne serait-ce que pour en tirer les leçons. Mais on préfère s’enfermer dans une attitude de déni, cette fois avec l’appui d’une partie de la presse française. Que n’avait-on chanté les louanges du dirigeant du Parti Démocrate, Luigi Bersani ou du technocrate tourné politicien Mario Monti. Il suffisait pourtant de sortir de la bulle parisienne, de regarder la presse italienne, britannique ou américaine pour avoir une petite idée de ce qui allait se passer. Mais il est dit qu’il n’y a pas de réalité en dehors de ce que certains cénacles veulent bien dire… Alors, regardons un peu ces élections, et leurs résultats, et cherchons à en extraire les points importants.
Le premier point qui émerge de ces résultats est à l’évidence l’ampleur du désaveu des politiques inspirées par Bruxelles et Berlin, mais aussi, il faut s’en souvenir, par Paris. Les partis défendant ces politiques n’ont représenté que 40% des électeurs (le PD de gauche de Bersani 29,5% et l’alliance du centre-droit de Mario Monti 10,5%). Les partis refusant ces politiques, et refusant en réalité la logique de l’Euro, ont remporté plus de 54% des suffrages (le PDL de Silvio Berlusconi 29% et le M5S de Beppe Grillo 25,4%). On ne saurait imaginer plus cinglant démenti apporté à ceux qui présentaient le gouvernement Monti comme un « sauveur » de l’Italie. La multiplication d’impôts, souvent vécus comme injustes, les coupes sauvages dans le budget dont ont été victimes les hôpitaux, les écoles, mais aussi le système de retraite, les retards scandaleux de paiements de la part l’État, expliquent largement cette situation. La presse française peut gloser sur la « machine » Berlusconi, elle ne saurait éternellement cacher le fait que si un homme politique chassé sous les huées revient quasiment en triomphateur, c’est bien parce qu’il y a un rejet massif de la politique mise en place par ses successeurs. De plus, ce discours convenu ne saurait expliquer le succès du Mouvement 5 Étoiles (M5S) de Beppe Grillo.
Ceci conduit alors au deuxième point important : l’erreur manifeste des sondeurs et des estimations de « sortie des urnes ». Deux partis ont été les « victimes » de ces erreurs, le PD, crédité de plus de 33% et se situant finalement à 29,5% (environ 4 points d’écart) et l’alliance de centre droit de Mario Monti crédité par les estimations de 12% et n’en faisant en réalité que 10,5%. Le PDL de Silvio Berlusconi apparaît comme relativement stable. C’est donc le M5S qui a bénéficié de ces erreurs, étant crédité de 18% à 20% et faisant en réalité plus de 25% des suffrages. Il convient immédiatement de dire que ces élections étaient les premières élections générales auxquelles se présentait le M5S. La tache des sondeurs et des prévisionnistes était donc des plus difficiles. Mais, si l’on considère les chiffres, et si l’on admet qu’un certain nombre d’électeurs du M5S (1 sur 5) n’ont pas souhaité faire état de leur vote dans les sondages de « sortie des urnes », cela signifie que des anciens électeurs tant de gauche que du centre droit ont basculé vers le mouvement de Bepe Grillo. Cette hypothèse est confortée par la remarquable stabilité entre prévisions et résultats réels pour le PDL, qui confirme le fait que Silvio Berlusconi est bien reconnu comme le chef de sa formation et que son discours est largement assumé par ses électeurs. Le vote pour le PDL n’a pas été un vote « honteux », bien au contraire, mais clairement assumé. La signification de ceci est qu’il faut chercher essentiellement à gauche (et secondairement au centre droit) le véritable réservoir des forces du M5S.
Ceci conduit alors au troisième point : les électeurs italiens voulaient envoyer un message et ils ont utilisé à cette fin les moyens qui étaient à leur disposition. On peut gloser sur le système électoral italien, certes plus « byzantin » que romain ; on peut faire tous les commentaires possibles et imaginables sur la rhétorique tant de Berlusconi, couvert de scandales et rescapé du « bunga-bunga », que de Bepe Grillo. À défaut de partis plus présentables, les Italiens ont voté pour ceux qui leur paraissaient les moins nocifs, autrement dit les moins engagés dans la politique mortifère d’austérité et les moins soumis aux ordres de Bruxelles et aux diktats de Berlin. On est en présence d’une protestation structurée bien plus que d’un simple vote « protestataire ». Le fait que le M5S ait gagné certaines villes lors des dernières élections municipales aurait dû alerter les observateurs. On assiste en fait au début d’un processus d’enracinement du M5S.
Les conséquences pour la coalition de gauche que représente le Parti Démocrate sont importantes. L’érosion de ce parti dans les derniers sondages, puis dans les résultats, est particulièrement importante. Crédité de 35% à moins d’un mois du vote, il se retrouve finalement avec 29,5%. Le problème réside dans la position intenable qu’il adopta : celle de défendre une « austérité à visage humain ». Les Italiens ont intuitivement compris que de visage humain, il n’y en aurait guère et que seule resterait l’austérité. Mais cela pose un redoutable problème aux forces dites « social-démocrates » en Europe du Sud. Leurs discours n’ont plus aucune crédibilité dans le cadre économique qui est celui de la zone Euro. Il faut soit adopter un discours traditionnel de droite, soit rompre avec les chimères d’une Europe fédérale ; il n’y a plus de demi-mesures possibles.
 Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
C’est bien à une rébellion légitime que nous avons assisté lors de ces élections. Il convient d’en prendre conscience.
- See more at: http://russeurope.hypotheses.org/936#sthash.XCl0iaEQ.dpufLes résultats des élections italiennes à peine connus, les commentaires allaient bon train. Le gouvernement français s’est empressé, lui aussi, de faire un communiqué pour minimiser l’importance de ces résultats. Il eût mieux valu qu’il s’affronte directement à la réalité, ne serait-ce que pour en tirer les leçons. Mais on préfère s’enfermer dans une attitude de déni, cette fois avec l’appui d’une partie de la presse française. Que n’avait-on chanté les louanges du dirigeant du Parti Démocrate, Luigi Bersani ou du technocrate tourné politicien Mario Monti. Il suffisait pourtant de sortir de la bulle parisienne, de regarder la presse italienne, britannique ou américaine pour avoir une petite idée de ce qui allait se passer. Mais il est dit qu’il n’y a pas de réalité en dehors de ce que certains cénacles veulent bien dire… Alors, regardons un peu ces élections, et leurs résultats, et cherchons à en extraire les points importants.
Le premier point qui émerge de ces résultats est à l’évidence l’ampleur du désaveu des politiques inspirées par Bruxelles et Berlin, mais aussi, il faut s’en souvenir, par Paris. Les partis défendant ces politiques n’ont représenté que 40% des électeurs (le PD de gauche de Bersani 29,5% et l’alliance du centre-droit de Mario Monti 10,5%). Les partis refusant ces politiques, et refusant en réalité la logique de l’Euro, ont remporté plus de 54% des suffrages (le PDL de Silvio Berlusconi 29% et le M5S de Beppe Grillo 25,4%). On ne saurait imaginer plus cinglant démenti apporté à ceux qui présentaient le gouvernement Monti comme un « sauveur » de l’Italie. La multiplication d’impôts, souvent vécus comme injustes, les coupes sauvages dans le budget dont ont été victimes les hôpitaux, les écoles, mais aussi le système de retraite, les retards scandaleux de paiements de la part l’État, expliquent largement cette situation. La presse française peut gloser sur la « machine » Berlusconi, elle ne saurait éternellement cacher le fait que si un homme politique chassé sous les huées revient quasiment en triomphateur, c’est bien parce qu’il y a un rejet massif de la politique mise en place par ses successeurs. De plus, ce discours convenu ne saurait expliquer le succès du Mouvement 5 Étoiles (M5S) de Beppe Grillo.
Ceci conduit alors au deuxième point important : l’erreur manifeste des sondeurs et des estimations de « sortie des urnes ». Deux partis ont été les « victimes » de ces erreurs, le PD, crédité de plus de 33% et se situant finalement à 29,5% (environ 4 points d’écart) et l’alliance de centre droit de Mario Monti crédité par les estimations de 12% et n’en faisant en réalité que 10,5%. Le PDL de Silvio Berlusconi apparaît comme relativement stable. C’est donc le M5S qui a bénéficié de ces erreurs, étant crédité de 18% à 20% et faisant en réalité plus de 25% des suffrages. Il convient immédiatement de dire que ces élections étaient les premières élections générales auxquelles se présentait le M5S. La tache des sondeurs et des prévisionnistes était donc des plus difficiles. Mais, si l’on considère les chiffres, et si l’on admet qu’un certain nombre d’électeurs du M5S (1 sur 5) n’ont pas souhaité faire état de leur vote dans les sondages de « sortie des urnes », cela signifie que des anciens électeurs tant de gauche que du centre droit ont basculé vers le mouvement de Bepe Grillo. Cette hypothèse est confortée par la remarquable stabilité entre prévisions et résultats réels pour le PDL, qui confirme le fait que Silvio Berlusconi est bien reconnu comme le chef de sa formation et que son discours est largement assumé par ses électeurs. Le vote pour le PDL n’a pas été un vote « honteux », bien au contraire, mais clairement assumé. La signification de ceci est qu’il faut chercher essentiellement à gauche (et secondairement au centre droit) le véritable réservoir des forces du M5S.
Ceci conduit alors au troisième point : les électeurs italiens voulaient envoyer un message et ils ont utilisé à cette fin les moyens qui étaient à leur disposition. On peut gloser sur le système électoral italien, certes plus « byzantin » que romain ; on peut faire tous les commentaires possibles et imaginables sur la rhétorique tant de Berlusconi, couvert de scandales et rescapé du « bunga-bunga », que de Bepe Grillo. À défaut de partis plus présentables, les Italiens ont voté pour ceux qui leur paraissaient les moins nocifs, autrement dit les moins engagés dans la politique mortifère d’austérité et les moins soumis aux ordres de Bruxelles et aux diktats de Berlin. On est en présence d’une protestation structurée bien plus que d’un simple vote « protestataire ». Le fait que le M5S ait gagné certaines villes lors des dernières élections municipales aurait dû alerter les observateurs. On assiste en fait au début d’un processus d’enracinement du M5S.
Les conséquences pour la coalition de gauche que représente le Parti Démocrate sont importantes. L’érosion de ce parti dans les derniers sondages, puis dans les résultats, est particulièrement importante. Crédité de 35% à moins d’un mois du vote, il se retrouve finalement avec 29,5%. Le problème réside dans la position intenable qu’il adopta : celle de défendre une « austérité à visage humain ». Les Italiens ont intuitivement compris que de visage humain, il n’y en aurait guère et que seule resterait l’austérité. Mais cela pose un redoutable problème aux forces dites « social-démocrates » en Europe du Sud. Leurs discours n’ont plus aucune crédibilité dans le cadre économique qui est celui de la zone Euro. Il faut soit adopter un discours traditionnel de droite, soit rompre avec les chimères d’une Europe fédérale ; il n’y a plus de demi-mesures possibles.
 Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
Nous en arrivons alors au quatrième point. Ces élections ont été, on l’a dit, une cinglante défaite de la technocratie. À cet égard, on rappelle ce que l’on disait dans une note consacrée à la question de « l’ordre démocratique » mais aussi de la Dictature et de la Tyrannie : « L’ordre démocratique permet de penser les formes nouvelles de la tyrannie (les agences indépendantes), de leur donner un nom précis (le BCE, la « Troïka », la dévolution des principes de l’État à l’Union Européenne sans respect pour les règles de dévolution), mais aussi de montrer ce que pourraient être des cheminements différents qui n’aboutissent pas à des usurpations de souveraineté. L’ordre démocratique permet ainsi de réfuter les illusions d’une technicisation des choix politiques et de redonner toute son importance à la politique elle-même. Il nous permet de penser la Tyrannie et par conséquence la rébellion légitime. »
C’est bien à une rébellion légitime que nous avons assisté lors de ces élections. Il convient d’en prendre conscience.
- See more at: http://russeurope.hypotheses.org/936#sthash.XCl0iaEQ.dpuf