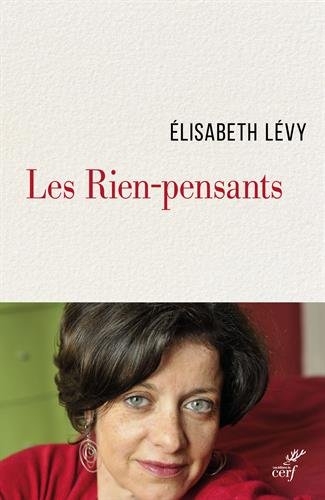Réflexions sur la psychiatrisation du terrorisme
Depuis la vague d'attentats qui touche l'ensemble de l'Europe, des politiques, des experts s'interrogent sur la santé mentale de leurs auteurs et affirment parfois qu'ils souffrent de désordres mentaux. L'effroi causé par les actes terroristes, la froideur avec lesquels ils sont commis sont tels qu'ils ne pourraient être commis que par des fous.
La psychiatrie et la psychologie se trouvent encore une fois convoquées, alors qu'elles ne disaient rien à expliquer cette folie et à la guérir. Michel Foucault dans son ouvrage majeur La folie à l'âge classique affirmait que: l'âme des fous n'est pas folle. Y a-t-il dans les actes commis par les djihadistes une trace de folie qui permet de les renvoyer vers un «psy» plutôt qu'un magistrat?
Je suis psychiatre et je ne crois pas que le terrorisme soit une folie au sens psychopathologique du terme.
Folie et violence
La folie ça n'existe pas, en tout cas au singulier. Nous autres psychiatres ou psychologues nous nous permettons parfois d'utiliser ce mot pour signifier le caractère exceptionnel de la clinique de certains de nos patients. Il faudrait parler des folies et encore cela n'est pas très satisfaisant car la folie c'est comme le cancer: les profanes y voient une maladie unique alors que pour les spécialistes il s'agit d'un concept valise qui permet de résumer une réalité bien plus complexe.
Certains délireront toute leur vie, persuadés des plus extraordinaires théories et sans jamais consulter un psychiatre alors qu'un patient phobique, le plus rationnel qui soit et reconnaissant lui-même le caractère absurde de ses symptômes sera terriblement handicapé. Le domaine de la psychiatrie recouvre des réalités complexes et les patients vivent tous différemment leurs symptômes, certains en souffrent et d'autres pas du tout.
Les malades mentaux sont-ils plus violents? Des faits divers ont ému l'opinion par la violence du geste commis par certains d'entre eux. Ainsi en 2004, des infirmières d'un centre hospitalier spécialisé furent décapitées. Un homme souffrant d'hallucinations a poussé quelqu'un sous les rails du métro. On pourrait multiplier les exemples et finalement donner l'impression que l'essentiel des crimes est commis par des sujets souffrant de troubles mentaux.
Une étude menée dans les années 90 a montré que la probabilité d'être agressé par un individu ayant consulté un psychiatre est dix fois moins élevée que de l'être par quelqu'un sans antécédent. Les services de psychiatrie peuvent être bruyants mais rarement violent.
J'ai exercé pendant 12 ans dans des services de psychiatrie dans divers hôpitaux, certes ouverts, mais je n'ai jamais attaché un patient.
J'ai été agressé une seule fois par une patiente de 90 ans démente.
L'unique fois où des personnels de l'équipe ont été agressés physiquement a été par un patient que nous connaissions peut-être trop bien et chez qui nous n'avions pas su reconnaître les signaux de dangerosité, la surprise majorant la violence du geste.
Il ne faut pas dénier le caractère parfois imprévisible d'éruption de la violence chez certains patients mais cela reste rare.
Un argument d'apparence plus raisonnable est d'affirmer que les malades mentaux seraient plus vulnérables aux conditionnements idéologiques. Il serait plus facile d'embrigader un fou qu'une personne saine. On surestime sans doute la raison. Des personnes très raisonnables font confiance à leur horoscope et trouveront toutes les raisons pour y croire et d'agir en fonction d'une prédiction.
Certains individus trouveront une cause qui donnera du sens à leur délire ou à leur psychopathie, c'est un fait mais combien? Il ne faut pas craindre une épidémie de terroristes potentiels dans les services de psychiatrie. La folie est difficile à embrigader.
Les armées ont toujours écarté les candidats à l'engagement souffrant de troubles mentaux les jugeant incontrôlables. Les Anglais quand ils ont fondé les premiers commandos ont imaginé recruter des sociopathes pour leur absence de résistance à tuer. Ce fut un échec. Ils sont alors allés chercher des hommes, diplômés et souvent issus de la bonne société anglaise, ne présentant pas de troubles psychiatriques mais au profil atypique.
Il faut se méfier de la tendance à vouloir «naturaliser» les comportements c'est-à-dire à leur chercher une vérité biologique ou scientifique. A notre époque affirmer qu'un produit, un comportement est naturel lui donne d'emblée une légitimité. Les débats autour du mariage pour tous en sont une bonne illustration. Les opposants au projet de loi se sont servis d'arguments biologiques pour montrer la primauté de l'hétérosexualité dans la reproduction, quand les pour ont utilisé des exemples du monde animal pour affirmer l'universalité de l'homosexualité. Mais l'être humain n'est ni un bonobo, ni un macaque même en invoquant un lointain cousinage.
En naturalisant le problème du terrorisme, on évacue sa dimension politique. On ne peut être en guerre contre des fous, le progrès finira bien par absorber ces fauteurs de troubles grâce à la toute-puissance de la Science! Mais c'est penser la Science comme une forme de maîtrise plutôt qu'un mode particulier de connaissance du monde. Dans ce processus de naturalisation la Science (qui n'existe pas au même titre que la folie) doit non seulement expliquer (ce qui est sa fonction première) mais aussi agir (ce qui est la fonction des ingénieurs).
Un crime dans la tête
Le lavage de cerveau permettrait de modifier le comportement d'un individu même à son insu. Très populaire dans les années 50 et 60, cette explication permettrait d'expliquer comment des groupes, des organisations peuvent influencer des individus.
La psychiatrie soviétique est allée plus loin dans cette logique. Pas besoin d'une action de l'adversaire pour expliquer que certains citoyens puissent s'opposer activement au gouvernement. L'Union soviétique est une société parfaite. Si on s'y oppose ce ne peut être que du fait de la folie. Le syllogisme est imparable et conduisit de nombreux dissidents à être hospitalisé .
Ce qui compte en désignant les terroristes soit comme des victimes soit comme des fous, n'est pas l'explication de leurs actes mais la conséquence de ces conclusions: on peut les guérir de leur égarement. Somme toute, si on peut convaincre une victime de secte d'abandonner celle-ci, alors la même opération est possible avec un terroriste.
On pourrait donc «déradicaliser» des candidats terroristes par des techniques psychologiques, en inversant en quelque sorte le processus de conditionnement, et ainsi les transformer en bon citoyen. C'est en tout cas ce qu'on promit en 2015 certaines associations…
Soit.
Peut-on pour autant comparer la préparation idéologique par la propagande dont l'EI est passé maître à un conditionnement mental? Al Qaïda a toujours combattu l'idée que ces hommes étaient irresponsables ou l'objet d'un complot.
Mais au-delà de ces questions du conditionnement, c'est faire aussi peu de cas de ce qui semble motiver ces jeunes hommes: la foi. Car à vouloir absolument ne pas stigmatiser une religion, on oublie ce moteur, puissant des fanatiques de tous bords (religieux ou non). Cela ne veut pas dire que tous les croyants sont des fanatiques mais tous les fanatiques ont une foi tel qu'elle leur permet de diviser le monde en deux: ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas.
La foi n'est pas un objet de la psychiatrie. Elle peut intéresser le psychologue ou l'anthropologue mais assez peu le psychiatre. Elle l'intéresse par rapport au délire. Comment faire la différence entre la foi et un délire d'autant plus que certains thèmes délirants ont toutes les apparences du mysticisme.
Jaspers apporte une réponse, à mon sens pas totalement satisfaisante qui est celle de l'incorrigibilité. Le délire n'est pas corrigible et il ne relèverait pas d'un processus de construction et d'élaboration au contraire de la foi. Il est vrai que le délire, chez certains relève d'une illumination, d'une évidence qui éclaire d'un coup le monde.
La différence entre la foi et une idée délirante est donc ténue et nous devons faire appel dans certains diagnostics à d'autres critères (symptômes associés, biographie). Georges Devereux a par ailleurs montré de façon magistrale comment considéré ce qui est de l'ordre du psychique et du culturel dans La psychanalyse des Indiens de la plaine. Pour lui, le pathologique apparaît dans le recours à la culture de l'homme blanc c'est-à-dire la psychiatrie.
Admettons que l'on puisse déconditionner quelqu'un de sa foi, de ces convictions profondes. L'abîme qui s'ouvre est à la fois vertigineux et terrifiant.
Si nous avons la possibilité de modifier les convictions profondes d'un individu au nom de la sûreté de la société pourquoi ne pas le faire au nom de la norme? Aux USA des programmes de reconditionnement prétendent modifier l'orientation sexuelle en «transformant» des homosexuels en hétérosexuels. On pourrait aussi imaginer modifier l'opinion de ceux opposés au progrès pour la simple raison qu'ils sont rétrogrades.
Finalement notre société ressemblerait à l'Union soviétique où la norme serait une tyrannie. Nous n'en sommes pas loin quand on songe que certaines universités américaines prévoient des lieux où les minorités se retrouvent entre elle et où tous débats sont évités…
Terrorisme mémétique
Ce qu'il y a de nouveaux dans ce que nos sociétés affrontent, est que le terrorisme devient une affaire de profane (sic). Il n'y a plus besoin pour être terroriste d'avoir fait le voyage jusqu'à Moscou ou Damas (époque Guerre Froide) et être allé dans un camp d'entraînement. L'idée suffit.
Richard Dawkins est un biologiste évolutionniste connu pour avoir développé la théorie du gène égoïste. Cette théorie l'a conduit à élaborer celle des mêmes. Selon le scientifique anglais, les idées sont comme les gènes: elles cherchent à se répliquer.
Une idée (concept, symbole, croyance…) va donc chercher à se reproduire dans le plus grand nombre d'esprits possible et la conscience humaine représente l'écosystème parfait. Il fonde le néologisme même à partir du mot gène et du latin mens, l'esprit pour désigner ces idées. Pour Dawkins, la religion est l'un des mêmes les plus puissants.
Les idées pourraient se reproduire comme des virus et rentrer en compétition pour le contrôle d'un même écosystème: notre esprit. La théorie des mêmes a connu peu de succès en France d'abord parce qu'elle soulève des problèmes épistémologiques importants.
Néanmoins il faut reconnaître que certains concepts possèdent des pouvoirs d'attraction importants comme une histoire drôle qui se diffuse ou une rumeur ou encore certaines expressions. Penser des idées comme des virus permet, en restant très prudent d'imaginer comment elles se diffusent.
Les sujets souffrant de pathologie mentale sont-ils plus vulnérables à la propagande d'un groupe terroriste. En d'autres termes sont-ils de bons terrains aux mêmes?
La question est complexe et plusieurs fois soulevée, dans d'autres contextes certes.
Par exemple au XVIIème siècle les confesseurs s'inquiétaient de l'influence des romans sur l'esprit des jeunes filles. L'Europe du XIXème a imputé au Jeune Werther de Goethe l'épidémie de suicide qui toucha la jeunesse. Plus près de nous, l'opinion a vu dans les dessins japonais un danger pour les jeunes esprits. On cherche dans la génération des quadras en quoi Goldorak a provoqué une épidémie de violence.
Néanmoins persiste l'idée que certains concepts peuvent avoir au minimum une influence néfaste sur des esprits malléables ou vulnérables. Le problème est d'identifier la vulnérabilité d'un esprit. Il y a des profils de personnalités qui peuvent adhérer et faire de très bons fanatiques. La paranoïa est une structure qui peut entraîner une adhésion sans réserve à une cause. Pour autant tous les paranoïaques ne deviennent pas terroristes. Il faut qu'ils reconnaissent dans une cause quelque chose qui face résonance. Comme n'importe qui en fait.
Arrogance et altérité
Nous sommes persuadés que notre société ou nos idéaux représentent le paroxysme de la civilisation. Les progrès de la science associés aux progrès sociaux doivent nous permettre de résoudre la plupart des enjeux qui se présentent à nous. Nous sommes éduqués, tolérants, ouverts à toutes les cultures, les orientations sexuelles, les choix de vie et pacifiques. Que d'arrogance!
Il ne s'agit pas d'une posture politique de droite ou de gauche. Les Américains ont cru qu'apporter les bienfaits de la démocratie suffirait à créer un cercle vertueux qui produirait la paix au Moyen Orient. De l'autre bord politique, prévaut l'idée qu'il suffit d'être ouvert, accueillant envers l'autre pour qu'en miroir il devienne à son tour tolérant.
Les djihadistes ne sont pas des Soviétiques qui n'avaient pas grand-chose à espérer et dont la majorité voyait l'ouest avec beaucoup d'envie et qui se sont convertis à grande vitesse à la société de consommation lorsqu'ils en eurent la possibilité.
Le problème de l'Occident est l'autre et c'est pourquoi beaucoup voient dans le terrorisme une forme de psychopathologie. L'autre c'est le fou, le perturbateur de l'ordre et de la norme. Étymologiquement, aliéné, aliénation viennent du latin alienus, autre. L'aliéné représente ce qu'il y a de plus autre ce que Freud après les frères Grimm nomme l'inquiétante étrangeté (traduction approximative de l'allemand Unheimliche). Le fou nous ressemble et d'ailleurs ne se distingue pas de la personne saine d'esprit. Mais il est censé être imprévisible et donc dangereux.
Certes l'accueil de l'autre, l'ouverture et la tolérance sont des valeurs largement promues et constituent parfois un programme politique. Mais objectivement nos sociétés acceptent ces autres à la condition qu'ils soient des victimes. Les associations qui aident les migrants de façon active mettent en avant l'impératif humanitaire. L'autre est foncièrement pacifié et ne peut être pensé en dehors des catégories de la victime et l'homme occidental du bourreau.
Si vous n'avez pas ma haine, vous aurez quoi?
On ne hait pas un fou, on le soigne. En tout cas, on le laisse dans des mains supposées compétentes. On peut certes s'émouvoir, avoir de la compassion mais finalement nous y sommes relativement indifférents.
Un journaliste, Antoine Leiris a écrit un beau texte, poignant à la suite des attentats de novembre 2015 où il a perdu sa femme. Il écrit ne pas vouloir être haineux envers les auteurs de ces actes et qu'en substance seule la culture nous sauvera.
Que faut-il ressentir alors?
Devant un tel acte n'est-il pas naturel de ressentir de la colère et de la haine envers ceux qui nous considèrent comme des ennemis pour le simple fait que nous ne partageons pas les mêmes croyances? La majorité des commentaires de ce texte saluent son caractère puissant, émouvant et courageux. Mais aucun ne s'interroge sur l'aporie qu'il propose: finalement quel sentiment avoir envers ces terroristes?
Ne pas ressentir de la haine et même aucun sentiment c'est être indifférent. Or l'indifférence face à une menace est le comble de l'arrogance. Résister c'est continuer à vivre malgré tout et ne pas se laisser sidérer par la peur que veulent provoquer les terroristes. Mais n'éprouver aucun sentiment envers ces actes est une forme de mépris. Il ne faut jamais mépriser son ennemi.
Il est évident que le but ne doit pas être l'exercice de la vengeance mais bien la suppression de cette menace et que la réponse ne peut être seulement armée. Il faut aussi penser à la paix et donc aux causes qui nous ont conduits en Occident à cette situation.
Certes la haine aveugle, empêche de raisonner et de considérer les événements actuels de façon globale.
Mais ces gens qui tuent sans distinction dans nos rues doivent-ils être traités avec indifférence comme une nuisance, irritante mais qui disparaîtra un jour, comme les moustiques en été (sic).
Ou ne faut-il pas plutôt que vouloir opérer une recherche des causes premières que ce soit celle de la folie, de l'histoire ou de la société et de ses insuffisances, affirmer que les monstres existent et qu'il est impératif de les combattre.
Yann Andrétuan (Figaro Vox, 8 novembre 2017)