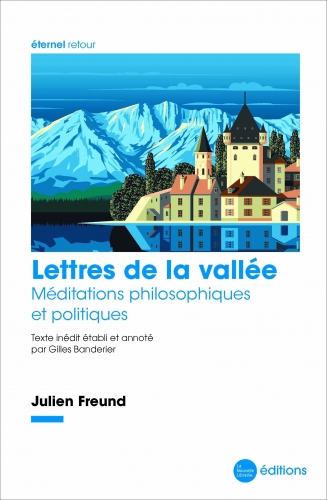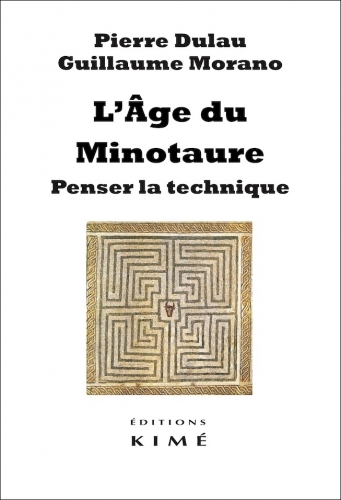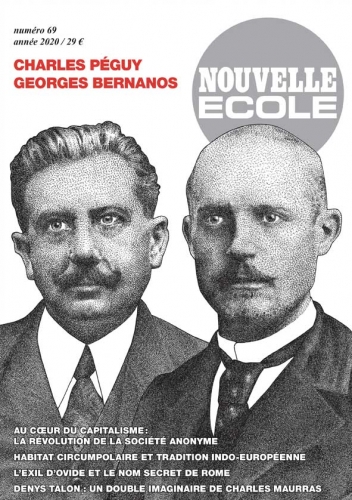Henri Levavasseur : « L’identité des peuples se fonde sur un double héritage, culturel et biologique »
BREIZH INFO : Henri Levavasseur, pouvez-vous vous présenter brièvement à nos lecteurs ?
HENRI LEVAVASSEUR. Historien et linguiste de formation, je m’intéresse depuis longtemps à la genèse des cultures de l’Europe ancienne. Ma vision du monde a par ailleurs été fortement influencée par la lecture de Martin Heidegger et la manière dont ce philosophe reprend les questionnements fondamentaux de la pensée grecque pour parvenir à une compréhension intime de la modernité. Attaché à mes racines normandes, j’accorde une grande importance à la notion de « patrie charnelle », telle que la conçoivent Barrès et Péguy. Soucieux de transmettre la flamme aux jeunes générations à l’heure où se joue le destin de l’Europe, je me suis tout naturellement rapproché de l’institut Iliade, qui accomplit dans ce domaine un travail remarquable.
BREIZH INFO : Votre essai constitue une réflexion fondamentale sur la notion d’identité, et sur l’articulation de cette notion avec la Cité, c’est-à-dire avec le Politique. Quelle est votre vision de l’identité de la nation française ? L’identité politique de la république ne s’est-elle pas construite en niant précisément l’identité « charnelle » des peuples et des régions ?
HENRI LEVAVASSEUR. Les entités politiques ne doivent pas être pensées comme des notions abstraites et figées, mais comme des réalités organiques. En tant que telles, elles constituent des ensembles qui valent plus que la somme de leurs parties, mais qui ne peuvent se maintenir en vie lorsque les organes qui les composent cessent de fonctionner harmonieusement. De même, la nation est une entité politique souveraine, qui représente plus que la somme des identités régionales et locales qu’elle rassemble, mais qui ne peut exister de manière pérenne sans ces dernières. La nation est un organisme vivant dont les familles, les communes, les régions forment en quelle sorte le « corps ». Être français, ce n’est pas (ou pas seulement) adhérer à des « valeurs » et à des institutions politiques, c’est d’abord être Normand, Picard, Breton, Provençal, Lorrain (pour ne citer que quelques-unes des identités réelles et enracinées qui constituent collectivement l’essence de la nation française, telle qu’elle s’est progressivement formée au fil des siècles).
Depuis la Révolution française, cette conception organique de la nation tend malheureusement à disparaitre au profit d’une conception idéologique coupée du réel et de l’histoire, fondée sur des valeurs à prétentions universalistes, intangibles et « républicaines ». J’entoure ici de guillemets l’adjectif « républicain », puisque ce discours, révolutionnaire et subversif par essence, vise à nier ou à transformer de manière radicale l’identité française héritée de notre histoire : ce républicanisme-là n’a plus guère à voir avec le service de l’état et du bien commun, c’est-à-dire avec la res publica au sens romain (signification que ce mot conserve encore sous la plume du juriste Jean Bodin au WVIe siècle).
Il est d’ailleurs assez paradoxal que les révolutionnaires français se soient réclamés du système romain, fondé sur une conception très inégalitaire et aristocratique de la citoyenneté. Mais ces rêveurs sanguinaires n’étaient pas à une contradiction près : ne prêchaient-ils pas l’amour de l’humanité tout en exterminant les Vendéens ? J’évoque dans mon essai les circonstances horribles de la mort de la princesse de Lamballe, massacrée dans des conditions de sauvagerie qui rappellent étrangement l’égorgement récent d’un professeur de lycée par un mahométan fanatique…
BREIZH INFO : L’invocation des « valeurs de la république », qui prend aujourd’hui une dimension quasiment religieuse, ne dissimule-t-elle pas, derrière les appels à l’unité nationale, la fracture béante qui traverse la société française ?
HENRI LEVAVASSEUR. De toute évidence, la question de l’identité de la France se pose aujourd’hui en des termes nouveaux, du fait de l’entrée sur notre territoire, en l’espace d’un demi-siècle à peine, de millions d’immigrés provenant de l’espace extra-européen. A l’échelle du contingent, c’est un phénomène d’une ampleur sans équivalent depuis la Préhistoire. Je renvoie sur ce point aux travaux de l’un de nos plus grands démographes, le regretté Jacques Dupâquier, membre de l’Institut.
Le traumatisme culturel, social, économique et politique provoqué par l’arrivée de ces flux humains considérables a créé en France, mais aussi dans la plupart des pays d’Europe, une véritable fracture entre l’identité ethnoculturelle et l’identité civique, entre ce que les Grecs nommaient, à l’aube de l’histoire européenne de la pensée, l’ethnos (« ethnie ») et la polis (« cité »).
C’est le constat de cette fracture sans précédent, qui menace la cohésion et l’existence même des nations et des peuples d’Europe, qui m’a conduit à écrire ce livre, afin d’inciter mes contemporains à prendre toute la mesure du problème, et surtout à trouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour redonner à nos nations l’avenir qu’elles méritent.
BREIZH INFO : Comment concevez-vous donc la notion même d’identité ? Est-ce une donnée figée ? L’identité n’est-elle pas, comme l’affirment certain, une construction en perpétuelle évolution ?
HENRI LEVAVASSEUR. L’identité des peuples doit naturellement être pensée de manière dynamique : elle est soumise, comme toute réalité vivante, à la loi du devenir. Pour comprendre l’origine et le sens de notre identité, il faut donc revenir aux fondements d’une saine anthropologie. En dépit de ce qu’affirment les tenants de l’idéologie libérale-libertaire, l’homme n’est pas une construction abstraite : il ne se réduit pas à l’image d’un individu doté à la naissance de droits universels, libre de signer un « contrat social » avec ses pairs. Nous savons tout au contraire, depuis Aristote, que l’homme est un « animal politique ». Cela signifie que son identité se construit dans l’espace d’une Cité, sur un territoire où s’exerce une souveraineté, qui permet de garantir la pérennité et le développement d’une culture. Car la « nature » de l’homme est précisément celle d’un « être de culture », comme l’a bien montré le philosophe allemand Arnold Gehlen dans son ouvrage magistral intitulé L’homme, dont la traduction française vient de paraître cette année chez Gallimard. L’existence de la personne humaine se déploie donc toujours, dès l’origine, dans le cadre d’une famille et d’un peuple.
L’identité des peuples se fonde sur un double héritage, culturel et biologique. Les deux dimensions sont indissociables et se « façonnent » mutuellement, en constante interaction avec le milieu et le territoire. C’est pourquoi les revendications très platement « racialistes » des « indigénistes » sont absurdes : vouloir revendiquer des droits en fonction de la couleur de peau, indépendamment de l’appartenance à une cité, à un territoire et surtout à une culture, n’a aucun sens.
BREIZH INFO : Existe-t-il donc pour vous une identité « européenne », ou l’Europe n’est-elle qu’une construction vide de sens, un fantasme dangereux qui s’opposerait à l’identité des nations ?
HENRI LEVAVASSEUR. Les peuples d’Europe ont en commun plus de cinq mille ans d’histoire, ce que confirment les données établies par la linguistique indo-européenne, l’archéologie et la paléogénétique. Je renvoie ici à la synthèse récente publiée par le généticien David Reich, de l’université de Harvard (Comment nous sommes devenus ce que nous sommes, Quanto, 2019).
L’Europe, ce n’est pas l’Occident, ou plutôt : l’Occident, ce n’est plus l’Europe. Les notions d’Europe et d’Occident ont certes été plus ou moins synonymes jusqu’au xxe siècle. Mais la « Grande guerre mondiale de trente ans », qui a éclaté en 1914 et s’est achevée en 1945, a laissé les nations européennes exsangues, soumises pour moitié au joug communiste, pour moitié à la domination américaine. Or, depuis la chute du système soviétique et le retour des nations d’Europe centrale à la liberté, les concepts d’Occident et d’Europe ne se recoupent plus : l’Occident prend de plus en plus la forme d’un système idéologique libéral-libertaire mondialiste, hostile à l’identité, à la culture, aux traditions, aux intérêts et à la souveraineté des nations européennes.
Il va de soi que l’Europe ne se confond pas davantage avec l’édifice institutionnel de l’U.E., qui s’acharne précisément à nier l’existence de l’identité européenne, en réduisant cette dernière aux « valeurs » occidentales, et en transposant à l’échelle du continent les aberrations du discours idéologique jacobin.
A la différence des nations qui la composent, l’Europe n’est pas une entité politique. Elle est à la fois autre chose que cela, et bien plus. Elle constitue un espace de civilisation, dont l’existence ne peut être distinguée de celle des cultures, des nations et des peuples qui l’incarnent et lui donnent vie. Cet ensemble véritablement polyphonique se déploie sur un territoire délimité par la géographie et l’histoire, c’est-à-dire par le poids des réalités géopolitiques. L’Europe, c’est une très longue mémoire partagée. C’est la conscience de racines communes, d’autant plus solides qu’elles plongent dans un passé plurimillénaire. C’est la claire vision de l’appartenance à un « concert des nations chrétiennes », voué à dépasser les antagonismes immédiats lorsque les périls extérieurs menacent la pérennité même de l’ensemble. L’Europe, c’est l’union sacrée des nations chrétiennes se portant au secours de Vienne, capitale du Saint-Empire romain germanique, afin de repousser les Ottomans qui l’assiègent en 1683.
BREIZH INFO : L’Europe que vous évoquez est-elle donc un produit de l’histoire, un reflet du passé ? En quoi la référence à l’héritage de l’Europe ancienne peut-il aider dans l’avenir nos peuples à préserver et réaffirmer leur identité ?
HENRI LEVAVASSEUR. Recueillir et revendiquer cet héritage, ce n’est pas s’enfermer dans une vision figée ou idéalisée du passé, c’est parvenir à une compréhension intime de « ce que nous sommes », de ce qui constitue notre spécificité en tant que peuples porteurs de cultures issues d’une matrice commune. C’est mieux saisir ce qui caractérise notre vision du monde et l’éthique qui nous anime. Les mots grecs ethos (« éthique ») et ethnos (« ethnie ») sont d’ailleurs étymologiquement apparentés. Cette relation étymologique est évidemment significative : l’éthique est une manière de « se tenir », conformément à l’usage reçu des aïeux.
Se réapproprier notre héritage, c’est concevoir l’identité comme la réalisation d’un potentiel et l’expression d’un génie propre, qui permet d’agir dans le monde d’une manière conforme à notre nature, c’est-à-dire à notre culture. Prendre conscience de « ce que nous sommes », c’est acquérir l’intuition de « ce que nous pouvons ». Renan, dans son célèbre discours sur la nation, ne dit pas autre chose : une nation, écrit-il, est un « principe spirituel » qui unit la mémoire d’un passé commun à la volonté de prolonger cet héritage. Renan ne dit pas que la nation se réduit à l’expression d’une volonté de « vivre ensemble », mais que cette volonté, naturellement indispensable à la pérennité de notre souveraineté politique, n’a de sens et de solidité que dans la mesure où elle s’enracine dans un patrimoine spirituel commun.
C’est pourquoi le discours à prétentions « républicaines », dans son extrémisme subversif, ne peut pas se réclamer de Renan sans le travestir. Je suis d’ailleurs parti de ce constat pour écrire ce livre.
BREIZH INFO : Comment procéder selon vous à la prise de conscience identitaire que vous appelez de vos vœux ? Quelles formes concrètes cette démarche peut-elle adopter ?
HENRI LEVAVASSEUR. Reprendre conscience de « ce que nous sommes », c’est-à-dire de ce qui nous caractérise en tant que peuple, implique naturellement de rejeter l’absurdité de la « cancel culture », mouvement qu’il faut plutôt qualifier de « culture cancel » : non pas « culture de l’effacement », mais bien « effacement de la culture » !
Il faut également renoncer aux illusions de l’intégration soi-disant « républicaine », qui prétend imposer à tous (sans en être réellement capable) le respect de « valeurs » plus ou moins universelles (donc abstraites), au prix de notre identité spécifique et de nos libertés concrètes : afin de séduire des éléments exogènes qui ne voient aucune nécessité ni aucun intérêt à s’intégrer, les populations autochtones sont sommées de renoncer à leur identité propre. Cela n’est pas acceptable.
Comme nous y invite Julien Langella dans un ouvrage récent, il faut « refaire un peuple », conscient de son histoire et de sa vocation propre. De manière concrète et pratique, cela signifie qu’il faut rebâtir la Cité à partir de ses fondations, en s’appuyant sur les « communautés organiques » que les tenants de l’idéologie révolutionnaire « arc-en-ciel » s’efforcent précisément de détruire. Ces communautés naturelles, historiques et politiques sont par exemple la famille, la paroisse, la commune, le terroir ou la région – conçues non pas comme de simples entités administratives, mais comme des communautés liées à un territoire, au sein desquelles s’épanouit une identité à la fois enracinée et incarnée, à l’échelle individuelle aussi bien que collective. C’est dans ce cadre qu’il devient possible de réveiller le sens du « bien commun », en saisissant toutes les occasions de redonner vie à nos traditions. Non pas pour singer le passé ou se complaire dans le folklore, mais pour que les germes de vie contenus dans ces traditions puissent à nouveau croître, sans être étouffés par la grisaille « républicaine », la folie « woke », ou les velléités suprématistes manifestées par des cultures exogènes. La jeunesse a un rôle clé à jouer dans ce processus de renouveau, qui doit être guidé naturellement par une « avant-garde ». Tel est l’appel que je lance dans la conclusion de mon ouvrage – tâche ambitieuse à laquelle travaille notamment l’institut Iliade, à travers ses cycles de formation. Il ne s’agit pas pour l’Institut de dispenser un savoir académique, mais de réveiller les mémoires et les énergies, et de proposer un modèle de solidarité communautaire fondée sur la philia, sur la conscience identitaire vécue au quotidien et partagée. Cette avant-garde devra s’engager dans toutes les formes de vies associatives (culturelles et artistiques, intellectuelles et scientifiques, professionnelles et économiques, mais aussi politiques) pour affirmer, moins par le discours que par l’exemple, sa capacité à se réapproprier notre identité et à la faire vivre.
Dans le même temps, l’importance accordée à la dimension communautaire et locale ne doit pas dispenser ce qui le veulent, et le peuvent, d’exercer une influence à d’autres échelons, dans les cercles décisionnels au sein desquels ils auront su pénétrer. Si nos communautés sont des sanctuaires, où sont préservées les sources pérennes de notre identité, cela ne doit pas nous amener à déserter pour autant l’horizon du politique : n’oublions pas qu’il nous faudra un jour, le moment venu, savoir à nouveau manier les instruments de la puissance.
Enfin, cette entreprise de reconquête intérieure ne pourra provoquer un véritable renouveau de notre civilisation que si elle est menée simultanément dans tous les pays d’Europe, qui doivent plus ou moins faire face aujourd’hui aux mêmes défis. La tâche est immense et exaltante. Elle requiert toute notre intelligence, toute notre volonté, et surtout tout notre courage. Il n’est plus temps de reculer, ni même de tergiverser. Comme l’écrit Ernst Jünger dans le Traité du Rebelle : « La grandeur humaine doit être sans cesse reconquise. Elle triomphe lorsqu’elle repousse l’assaut de l’abjection dans le cœur de chaque homme. C’est là que se trouve la vraie substance de l’histoire. »
Henri Levavasseur, propos recueillis par Yann Vallerie (Breizh Info, 28 avril 2021)