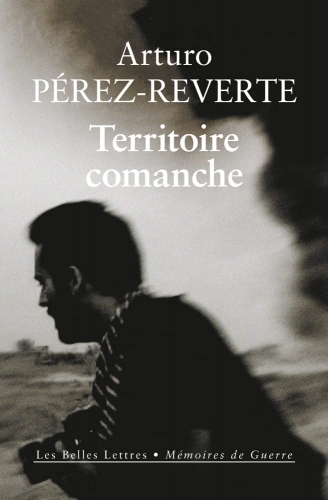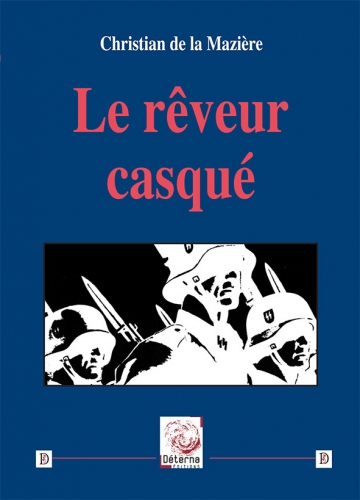Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Renaud Girard, cueilli sur le site de Geopragma et consacré à la décision de Vladimir Poutine de faire envahir l'Ukraine par l'armée de la Fédération de Russie. Grand reporter au Figaro, Renaud Girard est membre du comité d'orientation stratégique de Geopragma.

Les trois erreurs de jugement de Vladimir Poutine
Quelle dégringolade stratégique !
A l’été 2021, Vladimir Poutine était au plus haut de sa cote dans la savane des grands fauves de la géopolitique. Il était à la fois craint et respecté dans le monde. Le président américain s’était déplacé au mois de juin jusqu’à Genève pour s’entretenir avec lui. Avec Joe Biden, Poutine avait reconduit pour cinq ans le traité START de limitation des armements stratégiques. Un cessez-le feu dans la cyber guerre avait également été trouvé entre les Etats-Unis et la Russie. Biden avait même fini par accepter l’ouverture du gazoduc North Stream 2, amenant directement, par la Baltique, le gaz russe à l’Allemagne. En Asie, Poutine avait établi d’excellentes relations avec la Chine, tout en maintenant le lien historique de l’Inde et de la Russie. Il n’avait pas de mauvaises relations avec le Japon et la Corée du Sud. Au Moyen-Orient, Poutine n’avait que des amis, son soutien militaire à la dictature syrienne de septembre 2015 ne lui ayant aliéné ni Israël, ni l’Arabie saoudite, l’ex grand argentier de la rébellion syrienne. En Europe, Poutine avait établi une relation presque amicale avec les leaders français et allemand. Juste avant de se retirer de la politique, la chancelière Merkel lui avait rendu visite à Moscou, le 20 août 2021, afin de lui faire ses adieux. Une visite de courtoisie qu’elle ne fera pas au maître de la Chine.
En reniant ses promesses et en agressant militairement l’Ukraine à l’aube du jeudi 24 février 2022, Vladimir Poutine a commis un acte quasi-suicidaire. Il s’est, tout seul, déplacé du Capitole vers la Roche Tarpéienne. Son invasion d’un pays voisin, pacifique, historiquement frère, reconnu librement par la Russie depuis 1991, est incompréhensible. C’est un acte géopolitiquement irrationnel. Je ne l’avais pas du tout vu venir, je dois le reconnaître humblement.
Envahir l’Ukraine : pour gagner quoi ? La condamnation du monde civilisé ? La haine définitive des Ukrainiens ? La démotivation puis l’embourbement de son armée ? La mort de jeunes soldats russes par milliers ? L’isolement de la Russie et sa faillite économique ? L’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne ?
Annexer la Crimée, sans effusion de sang comme il l’avait fait en mars 2014, était un geste qu’on ne pouvait pas légalement entériner (son prédécesseur au Kremlin ayant garanti l’intégrité territoriale de l’Ukraine par le mémorandum de Budapest de décembre 1994) mais qu’on pouvait comprendre : Poutine voulait éviter que Sébastopol, port militaire de la flotte russe en Mer Noire, tombe aux mains de l’Otan. Faire, en 2014 et 2015, couler le sang russe et ukrainien au Donbass, avait déjà été une erreur stratégique de Poutine. Il n’avait fait que consolider le nationalisme ukrainien – en 2010, une moitié des Ukrainiens avait voté pour un président prorusse ; au premier tour des élections présidentielles de 2019, le candidat prorusse n’obtiendra que 11,7% des voix.
Mais, en envahissant la totalité de l’Ukraine, Poutine a commis une faute cardinale. Il a d’ores et déjà perdu quatre guerres. La guerre morale, en violant la Charte des Nations Unies. La guerre de la communication en traitant Zelensky de nazi : le président ukrainien, courageux et stratège, est devenu un héros pour le monde entier. La guerre économique, car même les banques chinoises se conformeront à la fermeture de l’accès au dollar et à l’euro, imposée aux banques russes. La guerre diplomatique, en effaçant le sentiment de culpabilité qu’avait Berlin envers Moscou depuis l’opération Barbarossa, ainsi que le désir de neutralité de la Finlande et de la Suède. Pourtant Poutine avait été maintes fois averti, notamment par Emmanuel Macron, qu’il courrait au fiasco en passant l’acte.
Cinq jours après son agression, Poutine est tombé au plus bas de sa cote internationale. Il n’est plus respecté, ni même craint, comme le montre la décision allemande de livrer des missiles antiaériens portatifs Stinger à la Résistance ukrainienne.
Cette dégringolade est dû au cumul de trois erreurs de jugement, toutes inspirées par le mépris. Poutine a pensé à tort que les Ukrainiens ne se défendraient pas et que son expédition militaire serait une promenade de santé. Son mépris affichée pour l’UE l’a conduit à sous-estimer la capacité d’union des Européens face au danger. Enfin, sa bunkérisation, loin des élites intellectuelles russes (très opposées à cette guerre), l’a empêché de prendre conseil dans son propre pays.
Le président français continue à parler à son homologue du Kremlin. Macron a raison car la priorité est d’arrêter le bain de sang entre frères ukrainiens et russes. Poutine a exigé la démilitarisation puis la finlandisation de l’Ukraine, ainsi que la reconnaissance de l’annexion de la Crimée. En utilisant ses blindés, il les a rendues plus improbables que jamais.
Renaud Girard (Geopragma, 1er mars 2022)