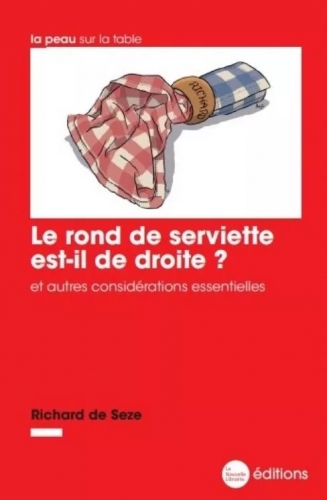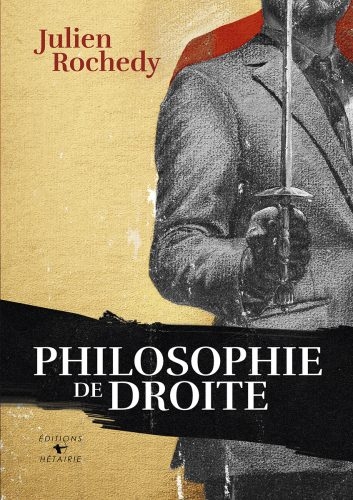Un politique peut aujourd'hui se réclamer du trotskisme le plus échevelé et obtenir sans coup férir le nombre de parrainages nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle, quand bien même son courant ne représente-t-il jamais, élection après élection, que moins de 1 % des suffrages exprimés.
Nul journaliste, quand Fabien Roussel tonne contre l'invasion russe en Ukraine, ne lui rappelle ce 11 janvier 1980 où, en direct de Moscou, le premier secrétaire du PCF, Georges Marchais, justifiait l'invasion de l'Afghanistan par des troupes soviétiques uniquement soucieuses de libérer les populations locales de féodaux moyenâgeux pratiquant le «droit de cuissage».
Certains le regrettent. On nous permettra pourtant de penser que l'on doit au contraire s'en féliciter, en considérant que le pluralisme, nécessaire dans une démocratie, traduit finalement plus sa vitalité qu'il n'augmente ses faiblesses, et que les erreurs des uns n'ont pas à entacher les choix des autres.
Dans le même temps pourtant, lorsque des politiques se voient attribuer malgré eux un label «d'extrême droite» qu'aujourd'hui quasiment tous les spécialistes universitaires du sujet remettent en question, considérant qu'il ne concerne guère qu'une infime minorité et nullement une force politique de l'ampleur de celle qui a amené Marine Le Pen pour la seconde fois au second tour de l'élection présidentielle, et Éric Zemmour, qui faisait là sa première apparition, à un score de 7 % au premier tour, tout change.
Plus question en effet de pluralisme: «Pas de liberté pour les ennemis de la liberté» tonnent nos modernes Saint-Just, se félicitant alors sans pudeur des parrainages refusés, des meetings interdits, de l'ostracisme professionnel frappant militants ou candidats, quand ce n'est pas de leur agression.
Ce «deux poids, deux mesures» a-t-il toujours existé ? Sous les noms successifs de «front républicain», «pacte républicain», «digue républicaine» jusqu'où remonter ? Au front républicain des origines de la IIIe République, constitué face aux menaces bonapartistes et monarchistes ? À cette discipline républicaine qui allait permettre au Front populaire d'arriver au pouvoir au sortir du 6 février 34 ? Les menaces sont réelles alors: on pouvait se demander en 1880 si le régime nouveau allait durer, et s'inquiéter en 1936 de la montée du fascisme. Mais derrière l'affichage idéologique de ces alliances - qui laissent sur leur gauche, socialistes, utopistes et anarchistes violents - on ne saurait oublier l'élément tactique, la conquête du pouvoir. Sous la IVe République ainsi, les fronts républicains ne visent plus qu'à permettre à une vaste alliance centrale de se le partager, écartant à droite les gaullistes et à gauche les communistes.
Sous la Ve République, cette stratégie devient initialement un instrument d'hégémonie au profit de la seule gauche, qui fait peser sur toute alliance avec le Front national qui progresse un interdit moral que Jacques Chirac valide politiquement. À partir du milieu des années 80, la droite qui s'auto-baptise dès lors «de gouvernement» parce qu'elle interdit à d'autres d'y participer n'hésite pas aux alliances avec la gauche, sanctionnant ceux de ses membres qui violent le nécessaire «cordon sanitaire». Ce nouveau Front républicain culmine en 2002 avec le happening de l'entre-deux tours d'une élection présidentielle où s'opposent Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Et si, à partir de 2011, la théorie du «ni, ni» (ni FN, ni PS) est celle de Nicolas Sarkozy, le Front républicain, qui continue d'ouvrir la voie vers les maroquins par la grâce médiatique, conserve ses adeptes en 2022, même si la flambée de l'abstention et du vote blanc en montre pourtant les limites.
Un Front donc, une digue, mais contre quoi, et pourquoi à sens unique ? Car s'il est aujourd'hui très difficile de qualifier le programme du Front national de Marine Le Pen «d'extrême droite», quand il n'est qu'une version édulcorée de celui du RPR des années 80, ou de trouver dans son entourage des fascistes assumés et dans ses références historiques un culte des années sombres, on peut en effet être plus réservé à l'encontre de partis de gauche où foisonnent les disciples d'Hugo Chavez, les admirateurs du Che et, où, plus largement, on n'entend guère remettre en cause les principes de l'idéologie la plus meurtrière du XXe siècle. Quant à lutter contre les hordes en chemise brune, nul ne saurait s'y opposer, mais encore faudrait-il qu'elles existent. Or, depuis des dizaines d'années, la violence politique qui se manifeste en France n'est certes pas prioritairement le fait de milices fascistes, mais bien de groupuscules d'extrême gauche.
Il est vrai que cette violence-là sert le pouvoir en place, ainsi légitimé pour réprimer avec une rare violence les manifestations ou imposer des mesures de contrôle de la population de plus en plus attentatoire aux libertés. Et pour permettre demain le «vote utile» des électeurs de la «droite de gouvernement» sur ses candidats ou ceux qu'il aura adoubés, ce même pouvoir a tout intérêt à agiter le spectre du «grand soir» des «partageux» : les «Versaillais» du «parti de l'ordre» le rallieront à nouveau, comme au moment de la crise des «gilets jaunes».
Ainsi, contrairement à ce que pensent ceux qui ne veulent y voir que la conséquence du poids d'une intelligentsia médiatique fortement ancrée à gauche, le «deux poids, deux mesures» doit apparaître en ce printemps 2022 pour ce qu'il est: un instrument permettant à un bloc politique central constitué aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, mais le dépassant largement - ce «bloc élitaire» évoqué par Jérôme Sainte-Marie, ce rassemblement des «anywhere» décrit par David Goodhart, ces gagnants de la mondialisation des métropoles dont parle Christophe Guilluy -, de rester au pouvoir.
N'ignorant pas qu'il partage avec la gauche, y compris la plus radicale, une même vision du monde progressiste, ce pouvoir est trop subtil pour se tromper d'ennemi: la révolte de leurs petits-fils et fils n'amène qu'un sourire nostalgique sur les lèvres des ex-soixante-huitards ou lycéens en lutte contre la «réforme Devaquet» - tous maintenant macronistes -, et les rodomontades du «Premier ministre élu» ne les impressionnent pas plus. En sus de ce poids incapacitant d'une pseudo-morale largement acquise aux idées de gauche qu'il ne faut pas négliger, il n'y a en fait aucun intérêt tactique à dénoncer les alliances qui peuvent se faire entre l'ancienne «gauche de gouvernement» et une gauche plus radicale ou plus sectaire.
Mais que s'affirme un courant national-populaire disposant d'une doctrine et prêt à remettre en cause la «liquidation», pour reprendre le titre d'un ouvrage de Frédéric Rouvillois sur le macronisme, entreprise depuis maintenant bien des années, voilà qui ne saurait être toléré. «Nous avons changé d'époque», disent les représentants autoproclamés du «cercle de la raison», voulant indiquer par là «qu'il n'y a pas d'autre alternative», comme le clamait Margaret Tatcher, et que la fuite en avant doit continuer pour permettre à la société rêvée d'advenir. Grâce à la gauche, spectre utile quand elle est révolutionnaire et caution morale quand elle se veut intellectuelle, et contre cette droite à laquelle, et ce n'est donc pas un hasard, l'oligarchie réserve ses coups.
Christophe Boutin (Figaro Vox, 4 mai 2022)