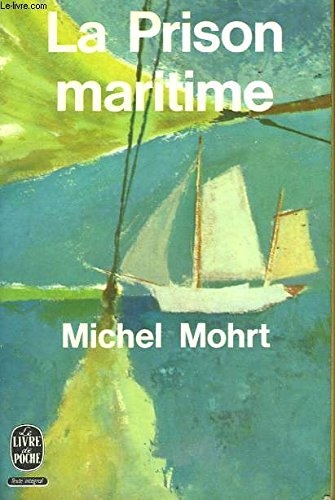Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Jean-Luc Coronel de Boissezon au laboratoire d'idées Droite de demain et consacré au conservatisme ainsi qu'à l'essence de la droite. Jean-Luc Coronel de Boissezon enseigne l’histoire de la pensée économique à l’ISSEP. Il est professeur agrégé d’histoire du droit et spécialiste de l’histoire intellectuelle du conservatisme. Il a été, à ce titre, un des contributeurs du Dictionnaire du conservatisme (Cerf, 2017).

(Entretien) Jean-Luc Coronel de Boissezon, « La droite entrevoit (…) une réappropriation de son essence philosophique »
Comment expliquer la réticence française vis-à-vis du terme « conservateur » ?
Contrairement à une idée reçue, cette réticence n’a pas toujours existé, loin de là ! Le mot apparaît significativement sous le Directoire, au cours de la réaction thermidorienne, période d’intense freinage à l’encontre de la dynamique révolutionnaire : dès l’an IV, un rapport officiel réclame « un gouvernement tutélaire et conservateur ». L’opinion publique, lassée sinon écœurée par les excès de la Révolution, est alors favorable à un reflux vers la tradition et cette faveur touche, subséquemment, l’adjectif « conservateur », pour près d’un siècle ! Après la franche appropriation du nom par la droite contre-révolutionnaire (ce qui est alors un pléonasme) lors de la fondation du journal Le Conservateur par Chateaubriand en 1818, le terme reste aussi répandu que positif jusqu’à la décennie 1880, où la Troisième République, d’abord paradoxalement dominée par des monarchistes qui préparaient la restauration du comte de Chambord, est reprise en main par les républicains. Après les élections de 1885 qui voient la défaite de l’Union conservatrice, le terme entame un rapide déclin, qui ira jusqu’à son ostracisation au seuil du XXe siècle.
La raison de ce discrédit est alors double. D’un côté, évidemment, les différentes forces intellectuelles et politiques de gauche œuvrent à sa déconsidération, par la symétrique promotion du progressisme qui est leur dénominateur commun. De l’autre côté, la droite de conviction, celle qui n’était pas devenue « modérée » sous la pression des intérêts matériels ou l’usure du temps, a pris pleinement la mesure, un siècle après 1789, du paradoxe croissant d’une défense des « acquis de l’histoire » et de la continuité institutionnelle : demeurer alors « conservateur », n’était-ce pas conserver désormais la République, le libéralisme et le capitalisme d’affaires, héritages de la Révolution bourgeoise ? La naissance de la « droite révolutionnaire » s’explique ainsi. De l’Action française des origines (notamment son Cercle Proudhon) jusqu’aux « non-conformistes des années 30 », nul ne veut plus se dire « conservateur » : il s’agit désormais, comme l’écrirons Robert Aron et Alexandre Marc, d’être révolutionnaire contre « le désordre établi » (La Révolution nécessaire, 1933).
La seconde moitié du XXe siècle, assez largement conditionnée sur le plan politique par l’exploitation, par le marxisme alors culturellement dominant, des suites de la Seconde guerre mondiale et de la décolonisation, avec pour acmé Mai-68, n’a pu que confirmer cette défaveur du qualificatif de « conservateur ». L’anti-marxisme qui entendit prendre sa revanche dans les années 1980, avec le « néo-libéralisme » de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, ne fut qu’une demi-réaction. Bien que nombre de commentateurs aient employé à l’endroit de ces expériences britannique et américaine l’expression de « révolution conservatrice », chacun sait qu’un incontestable freinage en matière de mœurs, après la « contre-culture » des décennies précédentes, y fut concomitant de l’adoption d’un libéralisme économique résolu (« néo-classique »), assez éloigné des vues économiques traditionnelles du conservatisme, qui avaient relevé jusqu’alors d’un protectionnisme national, distinct tant du libéralisme que du socialisme. La « droite de gouvernement » française a suivi plutôt paresseusement cette tardive mode anglo-saxonne, tout en minimisant son caractère culturellement conservateur : après quelques velléités vite abandonnées (plateforme RPR-UDF de 1986, proposant notamment des réformes en matière d’immigration), il n’en est resté que la déréglementation économique.
Aussi n’est-ce que dans la grande désillusion du début du XXIe siècle, lorsque se sont coagulées les conséquences de la crise économique de 2008, fille du capitalisme financier débridé par ladite déréglementation, les pertes de repères consécutives aux parallèles déréglementations « sociétales » issues de la même matrice individualiste libérale, avec ses « droits subjectifs », illustrés par l’adoption du « mariage pour tous » en 2013 et les débats subséquents sur la PMA et la GPA et, enfin, les conséquences du « laisser-faire, laisser-passer » dans la « crise des migrants » de 2015, concomitante de l’explosion du terrorisme islamiste, que s’est libérée en France la revendication de l’idée conservatrice. Il devenait en effet difficile, à droite, d’entretenir l’enthousiasme pour un libéralisme placé au point de convergence des maux du temps. Une boucle de plus d’un siècle s’est close : la droite française entrevoit, depuis la candidature présidentielle pourtant si équivoque de François Fillon (un thatchéro-reaganisme retardataire, la nouveauté ne consistant qu’à en assumer la dimension de conservatisme « sociétal »), une réappropriation de son essence philosophique. La place qu’y a pris le philosophe François-Xavier Bellamy, choisi pour mener la liste LR aux dernières européennes, les invitations fréquentes par ce même parti du Québecquois Mathieu Bock-Côté, en sont de remarquables attestations.
Beaucoup critiquent les libéraux-conservateurs en disant que le libéralisme entraîne des dérives progressistes, pourtant le conservatisme est né des libéraux britanniques, qu’en pensez-vous ?Il est exact que le conservatisme ait pour premier théoricien Edmund Burke, qui appartenait bien au parti whig, rassemblant les libéraux anglais. Mais ses Reflections on the Revolution in France de 1790 l’avaient incontestablement placé en minorité au sein de son parti : son cas n’est nullement représentatif du libéralisme britannique. En prenant davantage de hauteur, il faudrait remarquer combien l’antagonisme entre Whigs et Tories est complexe et ne saurait être entièrement ramené à l’opposition de progressistes et de conservateurs. Nombre de Whigs se sont originellement opposé aux Tories, au XVIIe s., parce qu’ils considéraient que ces derniers, alors partisans du roi Jacques II Stuart, importaient en Angleterre un absolutisme monarchique et un catholicisme tous deux caractéristiques de la France et contraires à la tradition britannique issue de la Magna Carta (1215) : les novateurs délétères étaient à leurs yeux les Tories. Burke se considère à cet égard comme un « old Whig » bien distinct des progressistes que sont peu à peu devenu ses confrères. Toute son habileté dialectique consiste à présenter la Glorious Revolution de 1688 comme un évènement de restauration des « droits historiques » des Anglais, aux antipodes d’une Révolution française qui efface ceux des Français, faisant de leur patrie une « carte blanche ». Philosophiquement, la pensée de Burke s’oppose point par point à l’individualisme méthodologique et juridique qui est au cœur du libéralisme, y compris en réalité chez les théoriciens de la révolution anglaise de 1688, à commencer par John Locke. L’interprétation conservatrice que fait Burke de l’évènement est tactique ; elle est facilitée, il est vrai, par le fait qu’au Royaume-Uni les Lumières, en particulier écossaises, font une plus grande place à l’empirisme et aux usages – dans la filiation du Common Law. Ces réalités ne sont pas transposables hors du contexte anglais – tout l’effort de Burke, penseur du particularisme historique, est de l’affirmer. Du reste, en dépit de ses efforts pour « traditionnaliser » les Whigs, la pensée de Burke n’a essaimé que chez leurs adversaires les Tories, qui les premiers en Europe prirent en 1834 le nom de Conservative party.
Plus généralement, la question des rapports entre libéralisme et conservatisme souffre d’une équivoque fondamentale. L’un et l’autre ont bel et bien, en effet, un point commun, une aire d’intersection : l’hostilité à l’emprise de l’État, conçu comme puissance de centralisation administrative et normative, conformément à la doctrine de la souveraineté absolue, qui trouve son origine dans le contexte dramatique des guerres de religion du XVIe s. Mais ce point de rencontre n’est qu’à la croisée d’itinéraires aux directions opposées. Le libéralisme vise à réduire l’emprise de l’État pour émanciper davantage les individus : du point de vue économique, en libérant la poursuite des intérêts privés et l’initiative individuelle, contre les réglementations publiques ; du point de vue juridique, en garantissant des « droits subjectifs » de l’individu, contre les droits objectifs découlant de la communauté et assurant la primauté du tout sur les parties. À l’inverse, le conservatisme vise lui aussi à réduire l’emprise de l’État, mais pour rendre leur place aux communautés naturelles : famille traditionnelle, solidarité intergénérationnelle appuyée sur des propriétés lignagères, communes et régions historiques, écoles libres et universités indépendantes, groupements professionnels, églises. En d’autres termes, la lutte des libéraux contre l’État vise à aller plus loin dans la modernité et son processus de fluidification des structures sociales, là où celle des conservateurs entend refluer dans la direction inverse, au profit de la réactivation des enracinements et de la valorisation des héritages.
Cela rappelle deux réalités historiques. La première est que l’État conçu comme puissance exclusive (plenitudo potestatis), et non plus comme faîte coordonnateur d’un ensemble de pouvoirs antérieurs selon le principe de subsidiarité (summa potestas), est une étape du processus moderne, qui a un amont « holiste » et un aval individualiste. La seconde est que le libéralisme est la première gauche, seulement déportée progressivement vers une droite de circonstance par deux siècles de « mouvement sinistrogyre », dont il a précisément donné le signal de départ avec les trois « révolutions atlantiques » (anglaise, américaine, française). Cette « droite circonstancielle » n’a pour autant jamais cessé d’être, du point de vue de ses valeurs fondatrices, antagoniste de la « droite essentielle » qu’est le conservatisme et, dans cette lumière, le syntagme « libéral-conservateur » est un oxymore.
Toutefois, les nécessités de la pratique politique étant ce qu’elles sont, en particulier quant aux inévitables alliances, l’équivoque du « libéral-conservatisme » a été cultivée abondamment dans l’histoire politique occidentale au XXe siècle, dès lors que les libéraux comme les conservateurs se sont retrouvés assignés au camp des ennemis du progrès par leurs communs adversaires, socialistes et communistes. Cette alliance, seulement objective, a néanmoins donné lieu à quelques tentatives de conciliation des deux traditions intellectuelles, chez certains auteurs anglais ou américains pour lesquels cette pente est naturelle eu égard à leur héritage culturel, mais aussi chez de plus rares autres ressortissants de la sphère linguistique germanique en Europe centrale cette fois, en particulier Friedrich von Hayek et Wilhelm Röpke, tous deux figures éminentes de la célèbre Société du Mont-Pèlerin, significativement fondée en 1947, au début d’une Guerre froide qui allait opposer au bloc communiste un monde indéfectiblement attaché à la propriété privée. Cependant, Hayek a tenu à clarifier sa position, dans sa postface à La Constitution de la liberté (1960), explicitement intitulée « Why I’m not a conservative ». Seul Röpke est parvenu à rester sur une ligne de crête qui a fourni l’épine dorsale, sur le plan théorique, de l’ordoliberalismus, école demeurée assez spécifiquement allemande, inspiratrice de l’« économie sociale de marché » des chanceliers Konrad Adenauer et Ludwig Erhard, et créditée à ce titre du « miracle économique allemand » de l’après-guerre.
De même les néoconservateurs américains ont apporté de nouvelles visions du conservatisme, est-ce une ligne réellement conservatrice ou sont-ils loin des valeurs du conservatisme ?
La chose intéressante est qu’en Amérique du Nord le conservatisme ne peut qu’être « néo », car les États-Unis se sont fondés sur le rejet de la tutelle des institutions de la monarchie anglaise et, plus largement, de la civilisation traditionnelle de l’Europe – et ce dès l’exil des Pilgrim Fathers du XVIIe s., avant que la rupture ne soit entérinée par les Founding Fathers de l’indépendance au XVIIIe. C’est pourquoi, sur le sol de cette vaste République nativement progressiste, le « conservatisme américain » paraît une contradiction dans les termes. De fait, les forces politiques majoritaires aux États-Unis jusqu’à la moitié du XXe s. n’ont guère été que différentes strates de libéralisme. Cela ne rend que plus digne d’attention le tour de force qu’a représenté, à partir des années 1950, l’apparition d’un mouvement intellectuel se réclamant d’un authentique conservatisme, à l’initiative de Russel Kirk (The Conservative Mind, 1953). Celui-ci a réveillé un héritage presque disparu, celui de l’Angleterre maternelle : le politologue Jay A. Sigler a pu dire, à cet égard, que Kirk et ses proches avaient réintroduit un conservatisme de type européen qui avait quitté l’Amérique depuis le départ des loyalistes fidèles à la Couronne britannique ! Il est significatif que, compte tenu de cette disparition des conditions initiales de la doctrine, le mouvement ait pris le nom de New Conservatism. L’apparition de ce courant, fort protéiforme au demeurant, me semble le signe d’un tournant historique majeur, peut-être insuffisamment perçu : il témoignait de la prise de conscience, dans une partie de l’intelligentsia américaine, de l’impossibilité d’assurer la subsistance durable de leur État, si se poursuivait l’éradication des éléments pré-libéraux qui en avaient permis en fait, de façon officieuse et même déniée, la prospérité. La crise culturelle et identitaire où est désormais plongée, en raison de l’évolution de l’idéologie progressiste et du capitalisme mondialisé qui s’appuie sur elle, une population américaine d’origine européenne qui se sait majoritaire pour seulement quelques décennies encore, atteste la lucidité de cette prise de conscience, précisément manifestée par un effort de rattachement aux principales racines civilisationnelles européennes.
Pour répondre plus précisément à votre question, c’est vingt ans après le New Conservatism fondé par Kirk et popularisé par William F. Buckley Jr. et sa National Review qu’est apparu un nouveau courant qui s’est baptisé Neoconservatism, au début des années 1970. Dominée par la figure d’Irving Kristol, il a singulièrement rassemblé des intellectuels de gauche de la côte Est, souvent issu du judaïsme new-yorkais, effrayés par l’évolution imprimée par la New Left avec sa « contre-culture » (dont Mai-68 fut en France l’une des répliques sismiques), origine directe de l’actuel politically correct. C’est donc d’une autre prise de conscience de l’importance des éléments traditionnels de la culture, chez une vieille gauche réalisant soudain que ses valeurs elles-mêmes en dépendaient et, en particulier, que la classe moyenne dont elle provenait serait laminée par les conséquences du radicalism, qu’est né la seconde branche majeure du conservatisme américain. L’écho que peut avoir dans l’Europe d’aujourd’hui une telle conversion est évident, dans les évolutions d’intellectuels de gauche comme Michel Onfray en France ou David Goodhart en Angleterre, de même que dans les œuvres de Jean-Claude Michéa ou Christophe Guilluy.
La différence avec ces derniers auteurs reste toutefois profonde sur le plan économique, puisque c’est dans la périphérie du Neoconservatism que s’est développé le « néo-libéralisme » des supply-siders, en rupture complète avec l’interventionnisme étatique d’inspiration keynésienne. Il convient de préciser cependant que, d’une part, cette orientation prolongeait (avec la fameuse « courbe de Laffer ») l’anti-fiscalisme caractéristique du conservatisme et, d’autre part, qu’il s’agissait largement de combattre une politique de redistribution idéologique, spécialement la « discrimination positive ». D’une façon plus générale, à partir d’une défense de la sphère privée nettement exacerbée dans la culture anglo-saxonne, l’ensemble du conservatisme américain a développé des correspondances théoriques entre sa promotion politique des corps intermédiaires sis dans la « société civile » et un libéralisme économique laissant la plus grande autonomie à ces mêmes forces non-étatiques, la conviction de la majorité des auteurs étant que dans ce libre jeu se révèlent des qualités morales – héritage WASP évident. Leur discours se tient donc loin des libertariens et, prônant un capitalisme « familial », reste défavorable au capitalisme financiarisé et mondialisé. On peut voir là un intéressant parallèle avec ce que représentent, en Europe centrale, l’ordolibéralisme allemand déjà évoqué et le modèle du « capitalisme rhénan » étudié par Michel Albert.
Une place particulière, enfin, me semble devoir être faite au sociologue Robert Nisbet, disciple du Français Le Play, qui s’est placé à l’intersection des deux principaux courants du conservatisme américain, et a remis en exergue les notions de communauté, d’autorité, de tradition et de sacré (voir, en français, La Tradition sociologique, 1984), préfigurant les travaux de certains communautariens américains.
Les verts portent un écologisme doctrinal, les progressistes un progrès sans limites, la droite par l’intermédiaire du conservatisme peut-elle s’adapter aux enjeux écologistes ?
Ce devrait être, si l’on ose dire, la plus naturelle des choses. Si l’on met de côté les récriminations naturalistes de l’abbé Mably ou de Jean-Jacques Rousseau, dont les discours restent marginaux au sein du progressisme des Lumières, on constate que les premières critiques des atteintes à la nature, à ses rythmes lents et organiques, aux paysages et à l’osmose entre l’homme et la terre, proviennent presque exclusivement de la pensée conservatrice. Celle d’abord des contre-révolutionnaires, qui voient nettement le lien entre la révolution politique et la révolution industrielle, cette dernière fournissant à la fois les premiers moyens financiers et les appétits de long terme de la bourgeoisie libérale. Bonald, dans ses Réflexions sur la révolution de 1830, esquisse une critique précoce de cet industrialisme et de ses effets destructeurs du lien entre l’homme et la nature. Le romantisme politique, en Allemagne principalement (Adam Muller, Franz von Baader, Joseph Görres, etc.), mais aussi en Angleterre (Samuel Taylor Coleridge, Thomas Carlyle), a entrepris une véritable croisade intellectuelle contre la profanation de la nature, porteuse de sacralité, et du paysage, écrin de l’âme populaire, ainsi que contre la laideur de la société industrielle émergente. La génération conservatrice ultérieure, dans la seconde moitié du XIXe s., a lié cette critique à la lutte contre le paupérisme, dans sa défense d’une classe ouvrière désarmée par la législation individualiste et anti-corporative du nouveau droit du travail. Précédé par Benjamin Disraeli, le grand réformateur du parti conservateur britannique, qui a réorienté la politique tory en faveur des ouvriers, le courant du « catholicisme social » continental, en particulier français (Alban de Villeneuve-Bargemont, Armand de Melun, Le Play, René de La Tour du Pin, Albert de Mun), allemand (Mgr Wilhelm von Ketteler) et autrichien (Karl von Vogelsang), a mené la critique du déracinement provoqué par l’exode rural, de la grande ville ruineuse de l’hygiène et de la santé, tandis qu’il promouvait les jardins ouvriers, la relocalisation des manufactures dans les campagnes, et plus généralement le retour à la terre.
Il faut garder à l’esprit que les partis conservateurs ont tout au long du XIXe s. une sociologie où dominent nettement les ruraux, en particulier les propriétaires terriens, là où le libéralisme a clairement la faveur de la bourgeoisie urbaine et des milieux de la fortune mobilière. La défense de la ruralité était à cet égard également conçu, depuis Disraeli jusqu’à La Tour du Pin, comme moyen de rééquilibrer le poids politique des différentes classes sociales, en minorant celui de la bourgeoisie urbaine – dont Disraeli fustigeait l’esprit de calcul, l’utilitarisme et le rationalisme desséché.
Ce dernier trait, anti-rationaliste, de la critique des atteintes à l’environnement, a été particulièrement développé par le conservatisme du XXe s. Au seuil de celui-ci, le courant du Kulturpessimismus, outre-Rhin (Paul de Lagarde, Julius Langbehn, plus tard Oswald Spengler), a mis l’accent sur l’altération culturelle produite par l’industrialisation et la perte des repères naturels, en mettant en exergue le rapport entre rationalisme et exploitation productiviste de la nature. Dans cette filiation, Ludwig Klages, pionnier de la Konservative Revolution qui devait s’épanouir sous la République de Weimar, fut l’auteur d’un des premiers manifestes écologistes, L’Homme et la Terre (1913).Klages eut une influence majeure sur le « philosophe paysan » Gustave Thibon, figure de la philosophie conservatrice française, qui lui a consacré son tout premier livre. On décèle là les racines conservatrices du courant de « l’écologie profonde ».
Au mitan du XXe s., l’écologie constituait donc un affluent central du conservatisme en Europe. Il a fallu tout le phénomène de culpabilisation stratégiquement entretenu par les forces politiques de gauche à l’issue des évènements tragiques de la Seconde guerre mondiale, et spécialement en France la mise en cause du discours de retour à la terre du gouvernement de Vichy, pour que l’écologie s’éclipse durablement du corpus idéologique de droite. C’est ainsi qu’elle a connu une annexion à peu près complète par la gauche, jusqu’à devenir comme on sait, dans la dernière décennie du XXe s., l’un des principaux courants électoraux de son aile radicale, en particulier en Allemagne et en France. Pour autant, des scissions au sein des Verts, des deux côtés du Rhin, ont révélé que cette captation d’héritage ne faisait pas l’unanimité : si le Mouvement écologiste indépendant (MEI) d’Antoine Waechter refuse seulement de se situer sur l’échiquier politique, l’Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) fondé par Herbert Grühl assume quant à lui un positionnement conservateur.
Aujourd’hui, au moment même où semble triompher l’écologisme de gauche, de la promotion médiatique de Greta Thunberg aux succès électoraux d’EELV en France, l’équivoque d’une écologie progressiste se dissipe en réalité, dans le domaine des idées dont les évolutions précèdent toujours celle des urnes. Il sera de moins en moins possible, en effet, de reconnaître de légitimes défenseurs de la nature chez ceux qui en nient avec acharnement les manifestations chez l’homme, qu’il s’agisse de l’identité sexuelle, de l’hétérosexualité de la famille, de l’impératif de défense d’un territoire, ou de l’irréductibilité des identités ethniques. Les représentants de l’écologie politique actuellement majoritaires, par leur engagement en faveur de la « théorie du genre » et des revendications des minorités sexuelles, leur promotion du mariage homosexuel comme leur animosité à l’endroit de la famille traditionnelle et du « patriarcat », leur hostilité aux frontières, leur réclamation d’une société multiculturelle et d’un accueil inconditionnel des « migrants », leur dénonciation du « racisme systémique » et leur négation du droit à l’identité des autochtones, font la singulière démonstration d’une négation de l’écologie humaine. C’est là plus qu’une schizophrénie qui défendrait « la nature » environnementale ou animale tout en la pourfendant chez l’homme : même le souci du seul « environnement » est, à l’évidence, mis à mal par des positions favorables à des mouvements migratoires massifs et, de la sorte, aux déstabilisations réciproques d’écosystèmes locaux.
Pour tous ces motifs, la réappropriation de l’écologie par les courants conservateurs en Europe a commencé avec le nouveau siècle et ne pourra que se poursuivre. En France, la Nouvelle Droite en a donné le signal précoce avec Laurent Ozon et sa revue Le Recours au forêts (1994), avant qu’Alain de Benoist ne fasse connaître son évolution vers une position écologiste radicale, avec son ouvrage Demain, la décroissance ! Penser l’écologie jusqu’au bout (2007). Dans la filiation de la Manif pour Tous, la revue Limite (2015) a entrepris la défense d’une « écologie intégrale », sous les plumes d’une nouvelle génération (Gautier Bès de Berc, Eugénie Bastié, Falk van Gaver). En Angleterre, après les efforts décisifs d’Edward « Teddy » Goldsmith pour dégager l’écologie de l’emprise des courants socialistes dans les deux dernières décennies de sa revue The Ecologist, le philosophe Roger Scruton a donné à l’écologie conservatrice son texte de référence : Green Philosophy. How to Think Seriously About the Planet (2012). Il convient d’ajouter que, sur le plan religieux, l’enseignement des derniers papes a prolongé avec logique la « doctrine sociale de l’Église », issue des catholiques sociaux, par une « écologie chrétienne » élaborée par Benoît XVI, avec Spes Salvi et Sacramentum caritatis (2007), et poursuivie par le pape François avec Laudato Si (2015), appelant à accueillir le « don de la Création » et à le protéger en tant que « collaborateurs du Créateur ».
Peut-on réellement s’opposer au progrès, le limiter, alors qu’on sait que nous prendrions du retard sur les autres États, notamment au niveau défense (avec le cyberespace) ?
De longue date, la famille de pensée conservatrice a nié au progrès son caractère linéaire d’une part, d’autre part son caractère monolithique : pour ses auteurs, non seulement progrès et décadence alternent dans l’histoire, mais le progrès matériel ou technique doit être distingué du progrès physique, moral ou encore intellectuel. Le Play, par exemple, qui était polytechnicien et ingénieur des Mines, n’en pensait pas moins qu’ordre matériel et ordre moral étaient rigoureusement distincts, constatant même que le progrès dans le premier avait fréquemment entraîné un déclin dans le second. Les conservateurs d’aujourd’hui peuvent reprendre cette distinction, pour envisager des politiques totalement différenciées en matière technologique et en matière culturelle.Allons plus loin : c’est seulement à partir d’un « retour à la culture » que pourrait être maîtrisé le processus d’innovation technologique, dans le sens de l’intérêt national et civilisationnel. Ce n’est qu’une politique de restauration des murs porteurs et des arcs-boutants de l’architecture culturelle des peuples – après un demi-siècle d’intense déconstruction, d’abord « contre-culturelle », puis « multiculturelle » – qui pourrait permettre de replacer, au sommet, des valeurs anagogiques et de remettre à leur place subordonnée les techniques nouvelles. Loin de débiliter le processus de création technologique, une telle verticalité fonctionnerait de façon « aspirante », stimulant le dynamisme créateur en direction d’un « grand dessein », d’une reprise du « roman national » ou de l’épopée civilisationnelle. On ne que peut faire le constat, notamment en France, qu’au contraire la perte des repères culturels a provoqué la dépression de la créativité, tant artistique que techno-scientifique, ainsi qu’un profond déclin du système éducatif aux effets dévastateurs sur le développement des intelligences, enfin un abandon du patriotisme économique sous la pression du déni d’identité nationale, aboutissant aux délocalisations et à la désindustrialisation qui affligent notre pays comme la plupart de ses voisins d’Europe occidentale depuis quarante ans, c’est-à-dire dans la période d’exact contrecoup de la crise culturelle. Ce constat indique que les conservateurs, s’ils s’opposent à la chimère du « Progrès » à majuscule, non seulement n’ont pas à freiner les progrès – au pluriel – technologiques, mais semblent mêmes aujourd’hui les seuls à pouvoir en favoriser la reprise autochtone, locale et souveraine.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette orientation n’entre pas en contradiction avec la réponse à votre précédente question. C’est la principale figure du néo-conservatisme allemand de l’après-guerre, Arnold Gehlen, qui a établi que « l’homme est par nature un être de culture », reprenant dans son anthropologie philosophique une tradition de pensée qui remonte à Aristote. Ce propos aux riches implications rappelle que l’homme est contraint par sa nature de prolonger ses capacités organiques, insuffisantes à assurer sa survie dans le monde, par des créations culturelles : outils, armes, habitations, mais aussi cités et institutions, normes et valeurs. La technè n’est pas extérieure à l’homme, elle est au contraire un effet spécifique de sa condition : elle est une part de la culture. Comme elle, la technique est particulière, produit d’un peuple, dans sa localité, au cours de son développement historique. L’occidentalisation du monde, conséquence des colonisations européennes puis de la colonisation culturelle américaine, a entraîné l’oubli de cette réalité. Seule la résistance opposée par la pensée conservatrice au discours universaliste pourrait permettre, aujourd’hui, l’audace du constat que le monde vit de techniques issues, précisément, de cet Occident qui est l’objet d’une culpabilisation médiatique et d’un procès idéologique constants. Se réapproprier avec une légitime fierté cet aspect de la culture des peuples européens, reprendre en main le développement de la technique grâce à la cohérence d’une unité culturelle retrouvée, mettre fin aux délocalisations, réindustrialiser nos pays, assurer le développement du localisme et des circuits courts si favorables à l’environnement, bâtir des espaces économiques auto-centrés, contester le libre-échangisme et assumer un néo-protectionnisme continental, être en mesure par un « protectionnisme éducateur » (Friedrich List) de développer enfin les industries de pointe que nous avons abandonnées, tout spécialement dans le domaine numérique monopolisé par les GAFAM : autant de chantiers dont ni les libéraux individualistes et libre-échangistes, ni la gauche multiculturaliste et focalisée sur un État-Providence dispensateur de prestations sociales, ne se chargeront. Les conservateurs ont à ce titre la responsabilité historique, en matière économique, de faire advenir cet État-stratège.
Comment adapter le conservatisme au XXIe siècle ? Quel conservatisme pour la droite de demain ?
C’est moins le conservatisme qui a à « s’adapter au XXIe siècle » que ledit siècle qui est d’ores et déjà venu à lui : rarement, depuis ses origines, cette famille de pensée était apparue avec autant de clarté comme la grande alternative. La poursuite de l’évolution du progressisme y est pour beaucoup, qui a vu sa première strate, libérale, abandonner ce qu’il lui restait de défense du patrimoine culturel au profit de la mondialisation, et sa seconde strate, socialiste, délaisser la défense des couches sociales modestes au profit des luttes pour « la diversité » : les deux strates ont aujourd’hui fusionné idéologiquement, voire politiquement comme dans le cas français du parti d’Emmanuel Macron. Le durable malentendu d’une « droite libérale » est dissipé : dans l’électorat plus encore que dans les partis, les libéraux ont rejoint les libertaires ; le libéralisme a fait retour à son origine. Il ne reste de droite que la conservatrice.
De même, c’est spontanément que s’est dégagée la voie de ce « conservatisme pour la droite de demain » sur lequel vous m’interrogez : le face-à-face politique déterminant a été reconnu par les pouvoirs progressistes en place, comme en France où le président Macron a dramatiquement présenté les dernières élections européennes comme un affrontement des « progressistes » et des « populistes », également qualifiés de « lèpre [montant] un peu partout en Europe ». Tous les éléments pertinents pour le conservatisme d’aujourd’hui sont là, en creux, dans la peur attisée par ce discours : la « droite de demain » n’est autre que celle qui aura l’audace de le retourner. Certes, il entre principalement dans cette scénarisation le vœu du président Macron d’assurer sa réélection en n’ayant face à lui qu’une Marine Le Pen pour l’heure dépourvue d’alliés. Mais le pari tout conjoncturel de cette bipolarisation pourrait être risqué, car une fois l’échéance passée, les espoirs que placent en elle les électeurs de Mme Le Pen seront quant à eux toujours structurellement présents, tandis que la crédibilité du camp progressiste qu’entend incarner M. Macron aura encore beaucoup décru : aucun des problèmes qui ont jeté dans la rue les Gilets jaunes, puis les opposants à la réforme des retraites, ne trouveront de solutions durables dans une économie d’alignement sur le capitalisme financier mondialisé, pas plus que la multiplication des attentats islamistes, ni les risques sanitaires, ne pourront prendre fin dans une politique de la « société ouverte » répugnant au contrôle des frontières. Tandis que la France n’évolue plus désormais que d’une crise sociale à une crise sécuritaire, en lisière constante d’évènements dramatiques, dans une perte de contrôle que la réduction croissante de la liberté d’expression (projet de loi Avia, etc.) tente de conjurer en ne la rendant que plus odieuse, un certain nombre de nos voisins européens, en particulier la Hongrie et la Pologne, de même dans une large mesure que leurs alliés tchèques et slovaques, mais aussi avec plus de réserve l’Autriche et l’Angleterre, prennent une autre voie : celle d’un conservatisme qu’ils assument de concert, au-delà de leurs différences importantes. Du groupe de Visegrad au Brexit, ces gouvernements montrent, chacun à leur manière, que vouloir conserver l’héritage civilisationnel européen, désormais, c’est résister à une Union européenne qui ne se conçoit que comme une zone économique de libre-échange et un espace juridique de défense des droits de l’homme, c’est-à-dire un double universalisme et, dès lors, une double vacuité culturelle. Déni de l’identité, déni de l’histoire, déni des frontières, déni même d’une élémentaire préférence européenne. Les conservateurs auront à rompre avec cette construction suicidaire, précisément parce qu’ils sont européens : c’est une spécificité du conservatisme que d’être une doctrine civilisationnelle, originellement constituée dans la conscience de l’œcumène formé par l’ancienne Europe, fille de l’Empire romain et de la Chrétienté médiévale. Conscients de la nécessité géopolitique de penser en termes de grands espaces cohérents, à l’heure de l’extraterritorialité du droit américain, du plein retour du géant chinois dans le jeu de l’hégémonie mondiale, et de la guerre de civilisation menée par l’internationale islamiste, les conservateurs de demain seront alter-européens ou ne seront pas. L’historien et essayiste David Engels a proposé une formulation pour cela : « l’hespérialisme ». Son récent manifeste en montre la voie (Renovatio Europae. Plaidoyer pour un renouveau hespérialiste de l’Europe, 2020).
Ainsi les conservateurs ont-ils vocation à s’investir dans « ce qui monte un peu partout en Europe », selon la formulation présidentielle. Si M. Macron en joue, espérant ne susciter face à lui qu’un « populisme » aisé à vaincre, c’est parce que ce populisme a échoué à se rendre suffisamment crédible. Il consiste avant tout en un style, qui trouve ses limites dans l’exercice de la fonction tribunitienne, bien distincte de la vocation gouvernementale. Privilégiant l’addition des mécontentements populaires et la promesse d’une maintien inconditionnel du niveau de vie des classes moyennes menacées, sans production d’expertises pointues ni de propositions novatrices, sans proposition surtout d’un grand dessein alternatif, appuyé sur une perspective civilisationnelle, le populisme reste une forme qui manque de fond – au point d’avoir pu se situer à droite comme, plus sporadiquement, à gauche. Il manque à un populisme sincère, c’est-à-dire poursuivant effectivement la défense d’un peuple, le caractère substantiel du conservatisme. Et, à l’inverse, il a longtemps manqué au conservatisme, spontanément élitiste, un accès suffisant à l’électorat populaire. C’est assez dire que l’un a besoin de l’autre et quelle formule renferme la réponse à votre dernière question : la « droite de demain » sera nécessairement de fond conservateur et de forme populiste. Le point auquel est parvenu « l’état de droit » en Europe, privant les peuples de leur souveraineté et donc du contrôle de leur destin, par la censure juridictionnelle de leur volonté exprimée par leurs représentants, ne peut plus trouver d’autre issue que la réclamation de cette souveraineté sous la forme référendaire, dernière chance de trancher les différents nœuds gordiens qui sont noués autour de leur cou. Cette mue institutionnelle n’aura lieu que si des majorités populaires retrouvent l’accès à la décision, contre la coalition des pouvoirs non-élus, médiatique et judiciaire, qui en découragent, délégitiment et censurent l’expression. Mais simultanément, ces choix populaires ne pourront être respectés fidèlement, et mis en œuvre avec compétence, que par un personnel politique conservateur, formé selon les canons élitaires de cette école, capable de reprendre le tissage de l’histoire nationale, sur la base de traditions éprouvées et de colonnes portantes culturelles, avec la légitimité que donne le courage d’avoir bravé l’oppression médiatique et le respect qu’apporte le service de valeurs transcendant la fugacité de l’instant postmoderne.
Jean-Luc Coronel de Boissezon (Droite de demain, 10 décembre 2020)