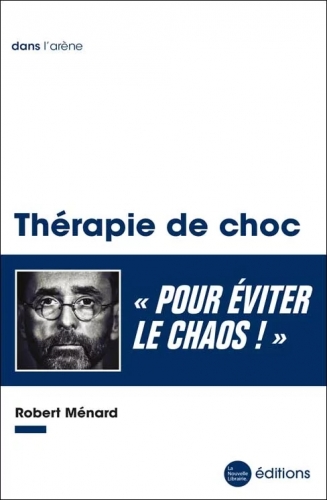Julien Rochedy: «Je reproche au conservatisme traditionnel son manque de courage»
Le Regard Libre: En 2014, vous avez quitté le Front national pour vous lancer exclusivement dans le combat métapolitique. Pourquoi ce choix?
Julien Rochedy: J’étais entré en politique assez jeune et je ne voulais pas devenir exclusivement politicien. La politique est un monde dont il est difficile de sortir une fois à l’intérieur: on y entre avec des idéaux et de la passion, et on les perd en général au bout de quelques années. On ne peut cependant plus quitter ce monde parce qu’on y gagne de l’argent. Aujourd’hui, je pense même que la majorité des hommes politiques n’aiment pas particulièrement ce qu’ils font, mais y sont obligés, aspirés par leur milieu. Je pense que le monde de demain ne sera pas nécessairement structuré par la politique. Celle-ci n’est qu’une caisse enregistreuse des grands mouvements culturels et sociaux qui se jouent en Europe et en Occident. C’est désormais la société qui prévaut. Par conséquent, pour avoir un pouvoir sur ce qui va arriver demain, il s’agit d’acquérir ce qu’on appelle «l’influence». Influence sur la jeunesse, sur les intellectuels, sur les classes dirigeantes. Influence qu’on acquiert davantage par le truchement du combat des idées que par la pure «politique politicienne».
Vous avez été un membre influent du Front national, mais vous ne vous reconnaissez plus dans la ligne politique souverainiste adoptée par Marine Le Pen. Il existe néanmoins au sein du parti une ligne plutôt libéral-conservatrice, dans le sillage de Marion Maréchal. Vous reconnaissez-vous dans cette droite-là?
Oui, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai quitté le Front national. Marine Le Pen s’est choisi un positionnement strictement souveraino-populiste, tandis que – s’il fallait absolument me mettre une étiquette, nécessairement réductrice – je suis effectivement plus proche des libéraux-conservateurs.
Qu’est-ce qu’une droite libérale-conservatrice?
Disons qu’en ce qui concerne la France, c’est une droite qui prend conscience avant tout des problèmes identitaires – les plus graves que nous ayons à affronter. C’est une droite qui se concentre sur nos racines civilisationnelles, tout en considérant la réduction nécessaire des impôts et des charges sociales qui pèsent terriblement sur les acteurs économiques français – notamment sur nos petites entreprises, nos travailleurs et nos artisans. Je me sens proche de ces idées-là. Je pense que c’est ce que nous pouvons faire de mieux en ce moment. Avant de promettre que la société française se portera bien mieux quand on aura changé le monde et l’Europe, il faut régler les problèmes franco-français, liés à notre Etat omnipotent et à notre culture très gauchiste. Evidemment, nous pouvons dans le même temps tenter d’insuffler quelque chose de neuf en Europe, mais nous ne pouvons pas nous défausser de tous nos problèmes sur l’Union européenne – ce que les souverainiste ont tendance à faire en permanence. Une façon de faire assez fausse en plus d’être démagogique.
Vous parlez beaucoup d’identité. Est-ce cela qui complète l’étiquette de libéral-conservateur, que vous jugez simplificatrice?
Oui. Le cadre intellectuel du libéral-conservatisme tel que je m’y retrouve est un cadre plutôt national, qui nécessite un contexte civilisationnel homogène. La libre entreprise fonctionne dans la mesure où les gens sont capables de s’autoréguler moralement, sans être dépendants des lois et des règlements émanant d’un Etat, car ils tirent ces règles d’eux-mêmes et de l’organisation communautaire. Un des modèles de ce libéral-conservatisme est l’Amérique, du moins dans certaines de ses parties, où les gens sont libres mais où «l’église est au milieu du village» – c’est-à-dire qu’il y existe une régulation communautaire effective. Sans cette dernière, le libéralisme perd tous ses freins moraux et entre dans un processus négatif. On parle alors de «libéralisme libertaire» ou de «libéralisme progressiste». Par conséquent, parce que le libéralisme doit être construit sur une base cohérente pour fonctionner, le libéral-conservatisme se doit nécessairement d’intégrer une certaine dose d’«identitarisme».
A propos de conservatisme, vous critiquez souvent la droite conservatrice traditionnelle – la droite du Figaro par exemple – qui draine une part non négligeable de l’opinion publique. Pourquoi cette critique? Après tout, les thèmes identitaires y sont très présents depuis plusieurs années déjà.
Je reproche au conservatisme traditionnel sa pusillanimité, son manque de courage. C’est une droite qui n’ose pas tirer toutes les conséquences de ses réflexions. Elle est souvent en retard sur ses raisonnements et tient tellement à être bien vue par les élites progressistes qu’elle a finalement peur de son nom. Dès lors qu’elle avance une idée légèrement radicale, elle fait aussitôt marche arrière, pour ne pas être traitée d’extrémiste. Or, cette crainte précisément donne tout pouvoir à la gauche, qui se régale de jeter des anathèmes sur la droite, la rendant inefficiente. Ce que je reproche le plus au conservatisme, c’est de ne pas oser affronter la gauche en face, n’assumant pas ce qu’il est: une droite qui peut tirer des enseignements de la contre-révolution, de l’antimodernisme, de la tradition anglaise «burkienne». Par peur, cette droite-là n’ose pas aller sur le champ de bataille idéologique avec toutes les munitions qu’elle possède.
Sur le plan idéologique précisément, vous dites combattre le nihilisme – reprenant évidemment le vocabulaire de Nietzsche sur lequel vous avez écrit un livre: Nietzsche l’actuel. Qu’entendez-vous par là?
On parle souvent de «racisme systémique» pour décrire la société occidentale; je parle quant à moi de «nihilisme systémique». Ce nihilisme s’incarne dans la volonté de l’Occident, consciente ou inconsciente, de s’auto-supprimer. Le nihilisme, c’est le désir du néant, du néant en soi-même – du suicide en quelque sorte. L’Occident et l’Europe occidentale semblent souvent tout faire pour se supprimer eux-mêmes, pour supprimer ce qu’ils sont dans leur chair, dans leur matérialité.
Quelle est la place de Nietzsche dans cette analyse?
L’Occident s’est jeté au XIXe siècle dans une toute nouvelle aventure: celle de la «mort de Dieu» – comme l’a appelée Nietzsche. Dans ce contexte, Nietzsche est l’un des premiers à avoir analysé l’avènement du nihilisme occidental. C’est le philosophe qui a réfléchi aux conséquences d’une civilisation qui se passe de Dieu à tous les niveaux, alors que toutes les civilisations dans le monde et dans l’histoire ont toujours cru en une divinité ou en une religion – importantes pour fédérer les individus et tenir en bride le nihilisme qu’ils peuvent avoir en eux. Nietzsche a analysé ce que cela pouvait produire sur nos consciences, en psychologie. Il a vu que le nihilisme menaçait et qu’il pouvait conduire à la ruine totale de la civilisation européenne, à son autodestruction. Nietzsche disait lui-même qu’il faudrait le lire un siècle après sa mort ; nous y sommes. C’est en cela qu’il est intéressant: nous vivons exactement ce qu’il avait prédit et ce contre quoi il nous avait mis en garde. Mais s’il avait prévu ces choses-là dans sa philosophie, on peut aussi y trouver des éléments qui nous permettent de nous sauver.
Justement, au-delà du constat passif, de l’analyse et de la critique de la société, quels sont les combats qu’il faut mener «activement» selon vous? Qu’y a-t-il à construire?
C’est une large question. C’est un travail que je mène en réfléchissant à ce qui pourrait être un nouvel idéal pour la société européenne, un nouveau souffle. On constate bien aujourd’hui que l’Occident ne sait plus que faire, sinon se supprimer. La crise profonde qu’il traverse résulte de cette absence de but et d’idéal. C’est aussi pour cela que la civilisation occidentale a trouvé des succédanés à la religion pour essayer de continuer de rêver et ainsi ne pas sombrer dans le nihilisme. Ce furent par exemple les idéaux totalitaires du XXe siècle, qu’ils fussent communistes ou nationaux-socialistes. Ces idéaux permettaient de croire en quelque chose. Mais depuis que la société «libérale-progressiste» a gagné et que le communisme est mort, les gens n’ont plus rien pour se projeter dans le futur. On le constate avec des phénomènes comme l’écologie, ou plutôt «l’écologie progressiste», qui conduit les gens à ne plus vouloir faire d’enfants – symptôme typique du nihilisme. C’est l’idéologie punk: no future, parce que nous pensons être détestables et avoir rendu le monde détestable. Dans ce contexte suicidaire, c’est à nous, intellectuels, de chercher ce qui pourrait nous donner un nouvel idéal, nous redonner l’envie de vivre, de faire des enfants, afin de poursuivre le destin de notre civilisation.
Au cœur de l’Occident décadent, vous parlez souvent de « l’individu postmoderne » en le comparant au dernier homme décrit dans Ainsi parlait Zarathoustra. Qu’est-ce que cet «individu postmoderne»?
L’individu postmoderne est un individu réduit à son seul individualisme. Il est d’une naïveté à faire peur et croit que nous sommes sortis de l’Histoire, que l’Histoire n’est plus tragique. Il se concentre exclusivement sur sa petite santé et n’est plus mû par une vraie philosophie jouisseuse, mais se contente d’une médiocre jouissance du bien-être. Cet individu correspond au «bouddhisme européen» décrit par Nietzsche: non pas le grand bouddhisme beau et intelligent des civilisations asiatiques, mais un bouddhisme au sens d’une pensée médiocre qui se concentre sur les petites souffrances, les petites vertus et les petites douleurs. On ne fait plus rien de grand, on ne se projette plus, on ne parle plus que d’amour du prochain. L’individu post-moderne est finalement un chrétien devenu fou, pour reprendre la formule de Chesterton. C’est un tout petit individu qui ne rêve plus à grand-chose, ou, comme le disait Jacques Brel en répondant à la question «qu’est-ce qu’un imbécile?», c’est celui qui pense qu’il faut se contenter de vivre. Ce faisant, l’individu devient complètement fou.
Pensez-vous qu’il s’agisse du type d’individu majoritaire en Europe?
En Occident, en tous cas, c’est le type d’individu que l’on a fabriqué. Mais nous sommes en train de vivre la fin de cet individu post-moderne – en même temps que son apogée – parce que les temps redeviennent tragiques. Nous allons devoir redécouvrir la communauté et on peut espérer, dans notre malheur, retrouver un certain bon sens, un nouveau souffle pour l’Europe.
On constate que vous basez une grande partie de votre analyse sur la pensée de Nietzsche. Cependant, vous êtes en profond désaccord avec la tradition française du «nietzschéisme de gauche» – dont Michel Onfray est une des figures actuelles. Que lui reprochez-vous?
Michel Onfray, effectivement, était un nietzschéen de gauche, mais il est en train de changer, comme on peut le remarquer. Lui-même a déclaré à des amis il y a un ou deux ans qu’il commençait seulement à comprendre Nietzsche. C’est-à-dire qu’il était parti sur une base nietzschéenne relativement fausse, qu’il remet en question désormais. On le voit à son parcours : il se sépare de plus en plus de ses idées de gauche et progressistes qu’il pouvait avoir il y a encore dix ou vingt ans. Je reproche aux nietzschéens dits «de gauche» d’utiliser Nietzsche pour détruire les bases de la société classique occidentale – notamment le christianisme. Ces gens-là utilisent en fait la critique nietzschéenne pour se libérer d’un certain nombre de carcans qu’ils trouvent oppressifs, mais dont ils oublient que si Nietzsche les a critiqués, c’était précisément pour nous mettre dans des carcans encore plus durs, encore plus exigeants, et tout à fait antiprogressistes. C’est donc ne prendre de Nietzsche que ce qui les arrangent, sans aller au fond des choses.
Mais n’est-ce pas le même piège qui se présente à vous qui souhaitez pratiquer une sorte de «nietzschéisme de droite»? Ne doit-on pas d’abord considérer Nietzsche comme un poète plutôt que d’en faire une «utilisation» militante?
Nombreux sont ceux qui, pour ne pas tirer toutes les conséquences de sa pensée, réduisent Nietzsche à un poète, à quelqu’un qui n’est pas systématique, qui se contredit. Ces gens restent pour moi très à l’écart de ce que dit Nietzsche réellement, et je ne peux pas être d’accord avec eux. Je tiens Nietzsche pour un philosophe complet. Certes, il ne s’est pas attardé à la production d’un système tout à fait cohérent, mais il a produit une œuvre dans laquelle on trouve une vision du monde relativement globale sur tous les sujets. La philosophie nietzschéenne est aussi très utile pour comprendre le monde que nous avons à affronter. Comme je l’ai avancé précédemment, Nietzsche a vu toutes les conséquences de la nouvelle ère sans Dieu de la civilisation occidentale, dont nous arrivons au terme aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que je sois nietzschéen à cent pour cent. Je ne dis pas que Nietzsche aurait été à mes côtés dans tous mes combats politiques d’aujourd’hui – j’essaie du reste de dépasser sa pensée sur un certain nombre de choses. Je dis simplement qu’il y a dans sa philosophie des éléments par lesquels il est absolument nécessaire de passer si l’on veut tenter de comprendre totalement le monde actuel.
Julien Rochedy, propos recueillis par Antoine Bernhard (Le Regard Libre, 4 février 2021)