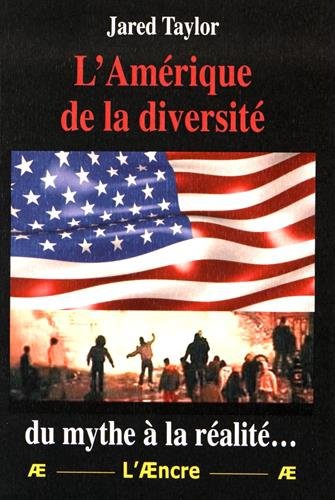Christophe Guilluy : "Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui ce sont les pauvres qui vont demander la fin de l'État-Providence"
Atlantico : Dans votre dernier livre Le crépuscule de la France d'en haut, vous dressez un premier constat insistant sur la fracture entre un discours politique évoquant les classes moyennes alors que celles-ci seraient en voie de transformation vers une classe populaire. Quelle différence faites-vous entre une représentation politique et la réalité du terrain ?
Christophe Guilluy : Oui, c’est paradoxal alors même que nous sommes au temps de "la sortie de la classe" moyenne des petites catégories salariées. La classe politique dans son ensemble, droite et gauche confondues, est l'héritière des Trente Glorieuses. Leur représentation du pays, c'est la France de Giscard. Avec deux Français sur trois qui sont des classes moyennes qui ne s'en sortent pas trop mal, et qui sont encore dans une phase où l'on peut imaginer que leurs enfants vont s'en sortir. C'est l'idée d'une classe moyenne majoritaire.
Et d'ailleurs, ces partis ont été conçus pour cela, ils s'adressent toujours aux classes moyennes.
Mais le paradoxe est que les sociologues nous expliquent depuis 20 ans que la classe moyenne a implosé, qu'elle s'est émiettée, divisée. Il y a une classe moyenne inférieure, supérieure, il y a même une classe moyenne "inférieure-inférieure". Ce que les politiques ne comprennent pas, c'est qu'un concept peut être pertinent à un instant T et être totalement inopérant quelques années plus tard, ce qui est le cas avec le concept de classe moyenne. Il ne dit plus rien. Je me suis donc posé la question de savoir pourquoi la classe politique continuait d'utiliser un concept qui n'existe plus.
Il y a d'abord un intérêt politique, qui est de laisser entendre qu'il existe encore une classe moyenne majoritaire. Cela signifie que le système économique qui a été choisi profite à la majorité. C'est une façon de réaffirmer une France qui serait intégrée socialement, économiquement, même si, par ailleurs, il peut y avoir des problèmes. Et ce "par ailleurs" correspond aux banlieues, où vivent des populations qui ont des "problèmes", où il y a des émeutes, des exclus, etc. Mais ce "eux" n'est pas "nous". Parce qu'il y a ici une impossibilité de penser la classe moyenne autrement que comme une classe moyenne blanche.
Le second intérêt ici, pour les classes supérieures, c'est de s'identifier aux classes moyennes. Ce qui est génial, c'est de se laisser croire que finalement on fait partie de "la moyenne", comme l'ouvrier ou l'employé, c’est-à-dire comme ceux qui ont véritablement subi une baisse de niveau de vie, une vraie précarisation, un vrai descenseur social. Ce brouillage social est accentué par le fait que ces classes supérieures tiennent en même temps un discours critiquent sur "les riches". Elles portent pourtant et cautionnent le modèle mondialisé de ces élites en tenant le discours de la société ouverte. Le problème est que "la société ouverte" est l’autre nom de la "loi du marché". Une loi du marché qui bénéficie effectivement prioritairement aux riches et aux détenteurs du capital mais aussi à ces classes supérieures qui, actuellement, se constituent notamment des patrimoines dignes des hôtels particuliers du XIXe. Mais aujourd'hui, cette bourgeoisie n'est plus identifiée comme telle. D’où mon utilisation du mot "bobo", qui m'a été reprochée. Si cette catégorie ne constitue qu’une fraction des couches supérieures (dont le point commun est de soutenir le modèle mondialisé, elles peuvent donc être de gauche ou de droite), elle permet de sortir du brouillage de classe en utilisant le mot "bourgeois". Ces gens sont arrivés dans des quartiers populaires, là où vivaient des catégories modestes (anciens ouvriers, actifs immigrés…), dont les revenus, le capital culturel, n’ont rien à voir avec ces classes supérieures. Cette nouvelle bourgeosie n’est pas "riche", elle ne détient souvent pas le "capital", mais il faut les désigner pour ce qu'ils sont : des bourgeois. Ces gens sont très sympas, cools etc., mais ils représentent une catégorie sociale qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'étaient hier les classes populaires qui occupaient ces territoires. Il ne faut pas non plus oublier la violence sociale de cet accaparement de biens qui étaient anciennement ceux de ces catégories populaires.
L'idée a été de connecter cela avec une vision globale des effets de mondialisation sur le territoire. Et attention, il n'y a pas de complot : il s'agit simplement du résultat du "laissez-faire" du marché. Le marché de l'emploi dans les grandes métropoles est totalement polarisé. Les emplois des anciennes classes moyennes ont alors progressivement disparu. Le marché des métropoles n'a pas besoin de ces gens. Le résultat est qu'aujourd'hui, 66% des classes populaires ne vivent plus dans les 15 premières métropoles.
Un sondage IFOP pour Atlantico publié le 4 septembre indiquait que 75% des Français considéraient que le terme "républicain" ne les touchait plus, ce terme ayant perdu son sens. Votre constat insiste également sur la notion de "séparatisme républicain", indiquant que la société française serait en voie d’américanisation, par l'acceptation "banale" du multiculturalisme. Ici encore, considérez-vous que le discours "républicain" actuel soit en retard ?
Je parle de fanfare républicaine. La grosse caisse. L'absurdité de ce débat est de penser que nous, en France, parce que nous sommes plus malins que les autres, nous allions entrer dans le système mondialisé, mais en gardant la République. Sauf que nous ne pouvons pas avoir le système mondialisé sans en avoir les conséquences sociétales. Il faut choisir. Soit nous gardions un système autarcique, protectionniste, fermé, etc., soit on choisit la société ouverte et ses conséquences, c’est-à-dire le multiculturalisme.
Il suffit d'aller cinq minutes dans un collège pour voir comment les enfants se définissent : blanc, noir, musulman, juif, tout sauf "je ne reconnais aucune origine". Même si nous avons pu connaître cela au début de l'immigration maghrébine. Mais cela a basculé à la fin des années 1980, et maintenant, on y est. Et le discours consistant à vouloir revenir à l'assimilationniste républicain n'a pas de sens. C'était un très beau système mais que fait-on ? On demande aux filles d'enlever leurs voiles, aux juifs d'enlever leurs kippas, etc. ? Oui, mais ça s'appelle une dictature. Attention, je ne dis pas qu'il y a eu acceptation, parce que personne n'a voulu une société multiculturelle, et certainement pas les milieux populaires (quelles que soient leurs origines). Ce modèle n'a pas été voulu en tant que tel, ce n'est que la conséquence de l'ouverture. La société française est devenue une société américaine comme les autres. Il suffit de regarder les méthodes de gestion des minorités : quelle différence entre le Royaume-Uni et la France ? Un jeune Pakistanais à Londres a à peu près le même ressenti qu'un jeune maghrébin en France, un jeune Noir de Bristol par rapport à un jeune Noir de Villiers-le-Bel.
Le problème ici, c'est la différence entre le multiculturalisme à 10 000 euros et le multiculturalisme à 1 000 euros. À 1 000 euros, les choix résidentiels et scolaires sont de 0. Ce qui veut dire cohabitation totale. Si vous habitez dans un pavillon bas de gamme au fin fond de l'Oise et que la cohabitation est difficile avec les familles tchétchènes installées à côté de chez vous, vous ne pouvez pas déménager. En revanche, le bobo de l’Est parisien qui s'achète un loft s’assure grâce au marché de son voisinage et, au pire, peut toujours déménager ou déscolariser ses enfants si cela se passe mal. C'est la seule différence. Parce que pour toutes ces questions, et contrairement à ce que laisse entendre la doxa médiatique, nous sommes tous pareils. En haut, en bas, toutes les catégories sociales, quelles que soient les origines... Ce qui change, c'est le discours d'habillage. Le "je suis pour la société ouverte" ne se traduit pas dans la réalité. La norme, c’est l’érection de frontières invisibles dans les espaces multiculturels ou le séparatisme car personne ne veut être minoritaire.
La société multiculturelle est une société avec des tensions réelles et une paranoïa identitaire pour tout le monde. Les blancs pensent que les musulmans vont prendre le terrain, les maghrébins pensent que les Français sont racistes, les Noirs considèrent que les Arabes leur en veulent, les Juifs sont dans une relation conflictuelle avec les musulmans.
Aujourd'hui, c'est la tension avec l'islam qui monopolise le débat, en raison de la présence d'une importante communauté en France, (et en extension) mais également en raison du réveil de l'islam dans le monde musulman. Nous sommes sur une logique démographique avec un islam qui prend de plus en plus de place. Dans une telle configuration, si une partie de la communauté se radicalise, elle devient de fait beaucoup plus visible.
En réalité, sur ces questions il n’y a pas "les bons" et "les méchants" : nous sommes face à des comportements universels. Il est possible de faire comprendre à l'autre que ce qui se passe aujourd'hui avec le FN est d'une banalité extrême. En expliquant que ce qui se passe, c'est que le vote FN est un vote de "blédard", d’attachement à son "village", d’une volonté banale de ne pas devenir minoritaire, surtout pour les catégories populaires, quelles que soient leurs origines, qui n’ont pas les moyens d’ériger des frontières invisibles. C’est vrai en France, mais aussi en Algérie, au Sénégal ou en Chine : ces ressorts sont universels. Tout le monde peut le comprendre. Nous sommes dans cette complexité du monde multiculturel, que nous n'avons pas choisi. Quand je dis "nous", les falsificateurs laissent entendre qu’il s’agit d’un comportement de "petit blanc". C’est faux, cette perception est commune à tous les individus quelles que soient leurs origines. Les musulmans ne sont pas plus partisans de la société multiculturelle que les Juifs, les Chinois, les Français blancs ou les Noirs. Ils la pratiquent mais sans l’avoir choisie. Cette société idéalisée par la classe dominante, elle est ce qu'elle est, avec sa dose de séparatisme. Ce qui pose la question du séparatisme, qui n'est pas une hypothèse mais une réalité. Et cette société-là, c'est la société américaine. La France est aujourd'hui le pays d'Europe qui la plus grande communauté maghrébine, la plus grande communauté juive, et la plus grande communauté noire. Le multiculturalisme, nous y sommes, malgré la fanfare républicaine qui joue encore. Aujourd'hui, c'est la question de l'islam qui est posée, mais demain, compte tenu des flux migratoires qui ont lieu aujourd'hui et de la croissance démographique en Afrique, c'est la question de l'identité noire qui se posera.
Vous évoquez l'idée d'une "société populaire" en rupture avec un discours dominant, formant ce que l'on pourrait appeler une société parallèle. Quels en sont les contours ? Qui sont les membres de cette société populaire ? A l'inverse, comment évoquer cette "France d’en haut" électoralement parlant ?
Électoralement parlant, cette France d’en haut, structurellement minoritaire, pèse beaucoup sur les grands partis. Mais ce qui est intéressant, c'est la désaffiliation des nouvelles classes populaires de leurs alliances traditionnelles. L'ouvrier qui votait à gauche, le paysan qui votait à droite : tout cela, c'est fini. C'est soit l'abstention, soit le vote FN pour les catégories populaires d’origine française ou européenne. Mais ce qui se forme, c'est une nouvelle société ou des gens qui étaient opposés (l'ouvrier, le petit commerçant, l’employé et le paysan, qui se retrouvent pour beaucoup sur ces territoires de la France périphérique) ont une perception commune de la mondialisation.
C'est ce qui les rapproche. Ce sont ces catégories qui vont vers le parti de sortie de la classe moyenne, le FN. Il n'y a pas de conscience de classe, mais ces gens pensent à peu près la même chose du sort qu'on leur a fait avec la mondialisation, mais également des effets de la métropolisation. Ces populations sont sédentaires, elles n'ont plus les moyens de partir, elles doivent s'ancrer sur le territoire, dans des zones peu dynamiques en termes de création d’emplois privés dans un contexte de raréfaction de l’argent public. De plus, ces territoires ont beaucoup vécu de redistribution, de l'investissement public, de la création de postes dans le secteur public. Mais tout cela est terminé. La manne publique a disparu. Et ce n'est pas parce que les gens ont Internet qu'ils sont à New York, ce discours est une arnaque. Le Cantal et Manhattan, ce n'est pas la même chose. Le réseau, ce n'est pas Internet, ce qui compte c'est de rencontrer des gens, être physiquement en face de quelqu'un avec qui on décide de faire des choses, comme le font les cadres supérieurs dans les métropoles. La mobilité n'est plus une mobilité pour tous, elle concerne prioritairement les catégories supérieures, ce qui implique une nouvelle forme de sédentarisation des catégories populaires.
Dans un livre publié en 2006 (Combattre les inégalités et la pauvreté. Les États-Unis face à l'Europe), le directeur de la recherche économique de Harvard, Alberto Alesina, et son collège Edward Glaeser montrent "la relation fondamentale entre fragmentation raciale et dépenses sociales en pourcentage de PIB", indiquant que plus un pays est fragmenté "racialement", moins les dépenses sociales sont élevées. La France périphérique peut-elle participer à de telles décisions ?
C'est également la thèse de Robert Putnam, qui a analysé les grandes villes, et qui a démontré le même phénomène. Il se posait la question de savoir pourquoi les politiques sociales étaient plus faibles dans les grandes villes. Et effectivement, le résultat était que les gens ne veulent pas payer pour les pauvres d'une autre communauté. C'est toute l'ambiguïté du rapport actuel à l'État-Providence qui se traduit dans la parole politique. Il existe un discours radical actuellement sur cette question, qui consiste à dire que l'on donne trop d'argent aux chômeurs, aux assistés, etc. Et ce, sans poser la question culturelle qui se cache pourtant derrière. C'est exactement ce qui se passe en France.
Ce qui est amusant, c'est que les libéraux pensent que les Français sont gagnés par le libéralisme et qu'ils sont contre l'État-Providence. C’est faux. Mais la situation paradoxale est qu’aujourd’hui ce sont les pauvres qui vont demander la fin de l'État-Providence.
Vous avez été attaqué pour votre travail. Quelle est la difficulté de votre discours au sein de l'Université ?
Oui, des critiques de quelques individus très idéologisés et éloignés des réalités, qui falsifient mon travail, et aussi tout bêtement par des "concurrents". Une histoire de business. Au-delà de ça, ces gens défendent en réalité un modèle, celui des classes dirigeantes, dont ils bénéficient.
Christophe Guilluy (Atlantico, 19 septembre 2016)