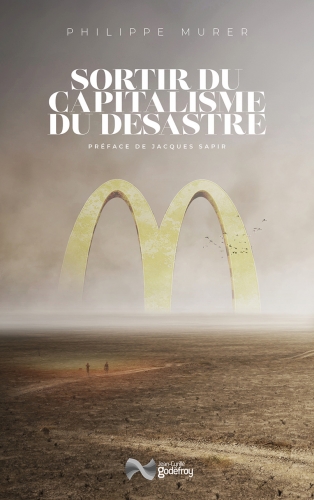En ce 17 juin 2021, partout, les masques tombent. Pas seulement ceux censés nous prémunir contre la pandémie de Covid, et que nous portons de manière discontinue depuis plus d'un an, mais également ceux qui entourent le juteux petit business de la lutte contre les discriminations, porté par de gentilles et inclusives businesswomen, qui seraient bien en peine de voir le motif de leurs affaires disparaître.
Ainsi, pour prospérer dans l'antiracisme, il est nécessaire de voir le racisme perdurer, mais également de le débusquer là où il ne se trouve pas et d'assigner les personnes autoproclamées «racisées» à résidence identitaire, faisant de leur couleur de peau une sorte d'état civil. Il en est de même dans la lutte contre le sexisme ou contre l'homophobie et l'ensemble des atteintes visant des catégories déterminées.
Ainsi, qu'elle ne fut pas, hier, la surprise de nombreuses et candides bonnes âmes de la gauche en apprenant, via nos confrères de Marianne, qu'Assa Traoré, dont le combat pour rétablir sa vérité, davantage que la vérité, concernant la mort de son frère Adama, survenue lors d'une arrestation mouvementée, venait de signer un partenariat avec la marque de chaussures de luxe Louboutin. Rappelons que l'entreprise française est aujourd'hui valorisée au-delà des 2 milliards d'euros, depuis l'entrée de la famille Agnelli dans son capital, via sa holding Exor, en début d'année.
Bien entendu, notre pasionaria, en lutte contre le racisme d'État et les violences policières, précise que les fruits de cette collusion baroque avec un mastodonte capitaliste, désormais allié à un groupe rarement célébré pour son souci de la justice sociale, seront intégralement versés à des associations de lutte «contre les violences policières, le racisme, la discrimination», comme le rappelle Marianne. Dont acte. Ce serait donc maintenant les multinationales qui porteraient haut et fort le combat contre les discriminations, sans aucune arrière-pensée commerciale, comme on peut bien l'imaginer. Parfait. On attend néanmoins de voir les représentants de Nike, BMW, ou encore Mastercard, brandir leurs pancartes contre les inégalités sociales et le capitalisme dans un cortège du NPA, ainsi la boucle serait bouclée. Nous y reviendrons.
Cette manœuvre de rapprochement entre le marketing, l'appât du gain et les combats identitaires n'est pas nouvelle, mais franchit chaque jour de cocasses pas supplémentaires. On ne résiste pas au plaisir de rappeler les mésaventures de Patrisse Cullors, cofondatrice de Black Lives Matter, portant son marxisme en bandoulière comme d'autres un sac Louis Vuitton, récemment épinglée pour s'être offert une maison de luxe dans un quartier résidentiel blanc de Los Angeles, lui permettant de fuir le voisinage de ses frères et sœurs de couleur. Dans le même registre on pense inévitablement à la chanteuse Yseult, à la pointe des combats mentionnés plus haut, menés depuis son nouvel exil fiscal belge, qui, mécontente d'un portrait brossé par le quotidien Le Monde , a fait republier le papier, transformé en véritable publirédactionnel, par un média ami, avant de lancer une campagne de harcèlement numérique contre la pauvre journaliste Jane Roussel, auteur de l'article. Il faut dire que le papier incriminé ne manquait pas de mettre en exergue la fascination de la diva pour le business, son ego surdimensionné, et sa manière peu amène de considérer ses interlocuteurs.
Toujours dans le même esprit, nous convoquerons aussi ici la délicieuse Camélia Jordana, qui nous parlait il y a peu «des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau», dont le sens du timing frôle la perfection, chacune de ses saillies militantes correspondant aux périodes où elle doit promouvoir un film ou un disque, quand ce n'est pas les deux à la fois. Rappelons néanmoins que notre damnée de la terre en lutte contre toutes les injustices ignore totalement à la fois le racisme, qu'elle n'a jamais subi, tout autant que les cités, dont sa bourgeoise origine lui a fait éviter la fréquentation.
Peut être également fait mention de l'inénarrable Rokhaya Diallo, fashion victim élevée au grain de l'International Visitor leadership américain, dont la dénonciation du racisme et de la domination blanche au gré de sorties parfois baroques, lui permet d'assurer un joli train de vie grâce à sa présence continue sur les radios et télévisions de l'état raciste français, où elle dispense quotidiennement sa parole comme le plus parfait des dominants qu'elle dénonce. Il en est de même de bien de ses camarades entretenus par la méchante fonction publique française où, depuis leurs chaires universitaires en sociologie ou études de genres, ils peuvent diffuser à foison leur haine de leur pays. On ne se refait pas. Tous les combats sont bons, surtout quand ils font fructifier la notoriété et accessoirement le portefeuille.
Mais tout cela est presque bon enfant au regard des activités de la papesse du mélange des genres que représente la militante «féministe» Caroline de Haas. L'ancienne secrétaire générale de l'UNEF (de 2006 à 2009), peu soucieuse à cette époque des affaires de harcèlement sexuel qui secouaient le syndicat étudiant de gauche, s'est lancée à corps perdu dans le business de la lutte contre les violences sexistes. Après avoir participé à la fondation de l'association Osez le féminisme, dont les combats à géométrie variable ne laissent de surprendre, elle a lancé en 2018 le collectif #NousToutes, lui-même centré sur les mêmes sujets, avant de franchir le pas entrepreneurial avec la création de la société Egaé, dont les activités et méthodes douteuses ont été dénoncées la semaine dernière dans une enquête d'Eugénie Bastié pour Le Figaro , également détaillées dans la dernière livraison de l'hebdomadaire Le Point.
Chargée de proposer des audits, des formations et des procédures de signalement sur les violences sexistes à destination des entreprises et institutions, notre chevalier blanc de la dénonciation du patriarcat, dont l'absence de compétence et de qualification dans les domaines, notamment juridiques, qu'elle traite, fait froid dans le dos, a vu le chiffre d'affaires de sa société tripler entre 2015 et 2019, dépassant les 600.000 euros. Pour arriver à ses fins, nous apprend Le Point, Caroline de Haas, outre d'encourager ses clients à pratiquer la délation, le plus souvent fondée sur de simples rumeurs ou une volonté de nuire par inimitiés, mène des enquêtes à charge offrant de nombreux biais méthodologiques, fait disparaître les témoignages n'allant pas dans le sens souhaité, quand elle ne les bidouille pas intégralement de manière à leur donner un sens différent de celui envisagé par son auteur, bafouant au passage les règles élémentaires de la défense. Dans ce registre, l'affaire Emmanuel Tellier, du nom de ce journaliste de Télérama licencié «sans cause réelle et solide», selon un jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 avril, par le magazine culturel, après une «enquête» de Egaé, est exemplaire. Bien décidé à laver son honneur, le journaliste, depuis, ne s'est pas démonté, et a régulièrement publié des tweets froids et techniques pointant les contradictions et malversations de l'entrepreneuse militante, dont le besoin de débusquer le maximum de violences sexistes, même imaginaires, est une nécessité impérieuse pour voir son chiffre d'affaires continuer à prospérer.
Tout cela pourrait être risible et anecdotique si cela ne mettait pas en valeur une tendance de fond, qui voit se rejoindre pour le meilleur et pour le fric, deux pendants d'un libéralisme que tout devrait pourtant opposer politiquement, à savoir le libéralisme sociétal, fondé sur la défense et mise en avant des identités, cher à la gauche américaine qui l'exporte partout, et le libéralisme économique qui voit dans la diversité l'occasion d'ouvrir autant de niches marketing qu'il existe de catégories à promouvoir. Nous en avons eu les premiers exemples avec le développement de la mode islamiste et les burkinis siglés Nike, entreprise dont on rappelle qu'elle ne possède aucune usine aux États-Unis et doit son succès à l'externationalisation de ses productions dans des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande, où la main-d’œuvre ne bénéficie d'aucune protection sociale et s'affaire pour des salaires qui frôlent l'esclavage. Soyons inclusifs, mais ne regardons pas de trop près les conditions de travail des petits enfants asiatiques, pourvu que nous œuvrions pour la bonne cause.
Ce phénomène avait été dénoncé pour la première fois par l'universitaire marxiste de l'Université de Chicago, Walter Benn Michaels, dans son livre La diversité contre l'égalité, qui avait fait grand bruit à sa sortie en 2006. Ainsi, selon ce professeur de lettres, «Au cours des 30 dernières années, les pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada sont devenus de plus en plus inégalitaires, économiquement parlant. Et plus ils sont devenus inégalitaires, plus ils se sont attachés à la diversité. […] Je pense que les gens se sont de plus en plus attachés à un modèle libéral de justice, dans lequel la discrimination — racisme, sexisme, homophobie, etc. — est le pire de tous les maux. Si ça marche, c'est à la fois parce que c'est vrai — la discrimination est évidemment une mauvaise chose — et parce que ça ne mange pas de pain— le capitalisme n'a pas besoin de la discrimination. Ce dont le capitalisme a besoin, c'est de l'exploitation», donc de nouvelles niches, comme il le confiait en 2009 à Bénédicte Charles dans Marianne. Il ajoutait, décrivant parfaitement la tendance observée: «Si vous prenez les 10 % de gens les plus riches (ceux qui ont en fait tiré le plus de bénéfices de l'explosion néolibérale des inégalités) et que vous vous assurez qu'une proportion correcte d'entre eux sont noirs, musulmans, femmes ou gays, vous n'avez pas généré plus d'égalité sociale. Vous avez juste créé une société dans laquelle ceux qui tirent avantage des inégalités ne sont pas tous de la même couleur ou du même sexe. Le patron de Pepsi a déclaré dans le New York Times il y a peu: "La diversité permet à notre entreprise d'enrichir les actionnaires"».
Quelques mois plus tard, dans une conférence parisienne donnée à la Fondation Jean-Jaurès, à laquelle nous assistions, il rappelait que, si les quatre plus grandes universités américaines n'avaient jamais eu dans leurs rangs autant d'étudiants issus de la diversité, la très grande majorité des familles des élèves inscrits dans ces institutions revendiquaient plus de 200.000 dollars de revenus annuels, alors que dans les années 60, près d'un quart des étudiants en question provenait de familles modestes ayant réussi à monter dans l'ascenseur social figuré par l'american way of life. Édifiant.
Alors, la diversité contre l'égalité, vraiment? Si le fait que les entreprises se soucient de questions sociales et investissent dans l'engagement et la RSE est sans doute une très bonne chose et peut permettre de prendre le relais d'États souvent peu agiles en la matière, cela ouvre aussi la porte à l'exposition de tous les cynismes dont le marketing a le secret, mais également à la confusion voyant des entrepreneurs identitaires se servir de leur caution militante à leur seul profit, ayant besoin de voir les discriminations proliférer et toucher des domaines en lesquels leur présence n'est pas évidente pour entretenir leur pactole grâce à la candeur de bonnes âmes réellement concernées par les injustices.
Benjamin Sire (Figaro Vox, 17 juin 2021)