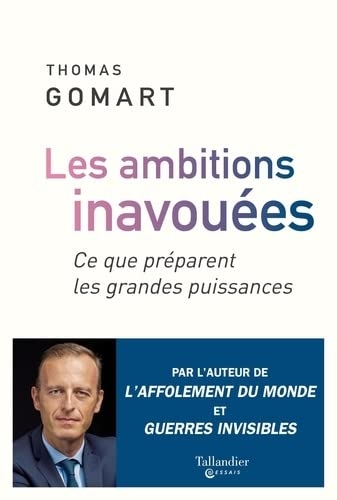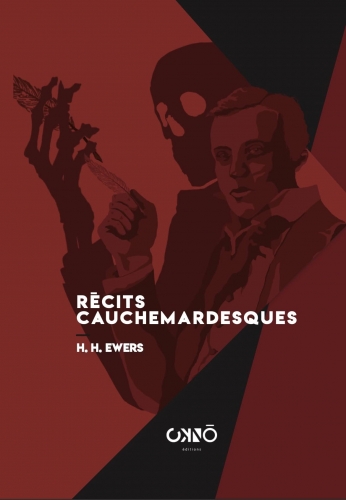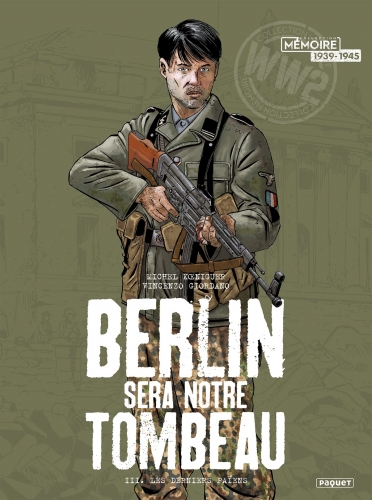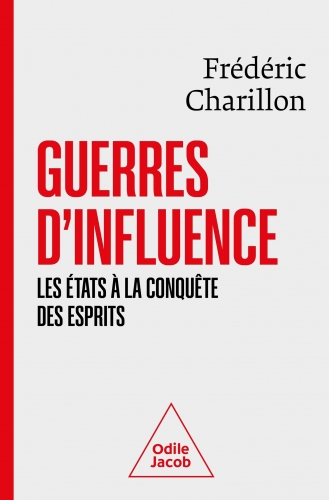Querelles de couple ou querelles de famille ?
Dans une interview qu’il a donnée le 17 octobre dernier Emmanuel Macron a déclaré : « Je crois dans la force du couple franco-allemand ». Il s’agissait là d’un bel acte de foi puisque, quelques jours plus tard, il était obligé d’annuler le sommet franco-allemand, les deux partenaires craignant que la réunion n’aboutisse qu’à envenimer leurs relations, les sujets de friction entre eux devenant chaque jour plus nombreux[1].
Toutefois, même si l’arrivée de la nouvelle équipe conduite par Olaf Scholz a indubitablement changé l’atmosphère des relations entre les deux pays, celles-ci ont rarement été idylliques. Malgré accolades et embrassades, l’Allemagne n’a jamais montré un grand empressement à construire une industrie d’armement européenne dans laquelle elle n’aurait pas le premier rôle, y compris dans les domaines d’excellence de la France ; elle est parvenue à faire transposer au niveau européen sa stratégie énergétique (l’energiewende) bien que celle-ci fasse fi des intérêts français et des investissements déjà réalisés dans notre pays ; elle réclame depuis longtemps un siège au Conseil de Sécurité de l’ONU ou le partage de celui que la France y détient. L’avenir des querelles observées au sein du « couple » est à l’évidence important.
Mais les débats du soi-disant « couple » ne cachent-ils pas un malaise de la « famille » européenne dans son ensemble ?
L’un des principaux objectifs de la construction européenne engagée après-guerre était de mettre fin aux conflits récurrents en Europe de l’Ouest ; dans cette perspective l’entente franco-allemande était au cœur de la création de la CECA (1951) puis de la Communauté Économique Européenne et d’Euratom (1957). Mais les choses ont bien évolué depuis et, contrairement à ce qui est souvent affirmé, les évènements récents ne favorisent pas l’affermissement des liens entre les pays membres de l’Union Européenne (UE – 1992) :
– L’intégration, à partir de 2004, des pays d’Europe centrale ou orientale auparavant sous domination soviétique a profondément modifié l’objectif et la logique de la construction européenne, qui jusque-là plaçaient la dyade franco-allemande au cœur du projet. Elle a déplacé le centre de gravité de l’UE des pays méditerranéens, où l’influence française est historiquement et culturellement forte, vers l’Europe centrale et du Nord, où l’influence allemande est historiquement, culturellement et industriellement forte. Elle a permis aux États-Unis de chercher à opposer, comme l’a fait en 2003 Donald Rumsfeld, alors Secrétaire à la Défense, les nouveaux adhérents à la « vieille Europe ».
– L’entrée de la Grande Bretagne dans le processus européen en 1973 a substitué au dialogue initial des anciens ennemis un trilogue permettant de lisser la rivalité franco-allemande. Mais le Brexit a replacé les deux protagonistes dans leur face à face initial sans qu’aucune autre puissance de même niveau soit désormais en mesure d’apaiser les tensions entre eux ; la Commission en a naturellement profité pour jouer le conciliateur et donc renforcer son poids dans la régulation de l’Union. En outre, alors qu’on aurait pu espérer que le retrait des Britanniques atténuerait l’influence américaine, il est vite apparu que les Américains ont aujourd’hui en Europe de nombreux relais au moins aussi convaincus et actifs que l’étaient les Britanniques, à commencer par les Allemands eux-mêmes[2].
– L’épidémie de Covid et ses conséquences économiques ont donné un poids sensiblement accru aux organes européens intégrés, ce que l’actuelle crise énergétique prolonge et amplifie. La Banque centrale européenne (BCE) a manié la planche à billets pour fournir aux États l’argent gratuit[3] leur permettant de rendre la crise aussi indolore que possible sur le plan économique. Parallèlement, la Commission a convaincu de nombreux gouvernements que la résolution des crises rencontrées ne nécessitait plus seulement l’harmonisation des politiques nationales mais leur mutualisation sous son égide ainsi qu’un fort accroissement des ressources communautaires.
– La guerre en Ukraine a renforcé ces tendances, la présidente de la Commission s’arrogeant des pouvoirs de leader de fait que les textes ne lui reconnaissent nullement et les États membres acceptant que la mutualisation des politiques s’étende à de nouveaux domaines, la Défense et l’Energie en particulier. Elle a surtout créé une confusion quant à la nature de l’Union européenne : dès lors que celle-ci s’aligne sur les positions américaines on ne voit plus bien pourquoi elle devrait disposer d’une politique de défense et d’une industrie d’armement autonomes ; en d’autres termes et pour simplifier, l’OTAN est perçue comme le bras armé de l’UE et l’UE comme la déclinaison européenne de l’OTAN[4].
– Le rapprochement européen a clairement favorisé l’essor économique des pays membres et en particulier des membres récents. Toutefois, malgré l’ampleur des politiques communes et des financements communautaires, les économies nationales peinent à converger. Alors que la situation économique de la France et de l’Allemagne étaient voisines il y a un quart de siècle, les Allemands sont aujourd’hui 20 % plus riches que les Français (en PIB par tête), l’endettement de l’Allemagne est environ deux fois moindre que celui de la France et l’Allemagne a dégagé chaque année un excédent de sa balance commerciale de 7 % dans le temps où la France creusait son déficit : le « couple » a donc clairement divergé économiquement. De même, la crise énergétique frappe aujourd’hui très inégalement les pays membres et l’inflation varie du simple au double d’un pays à l’autre.
Ce rapide tour d’horizon conduit à trois constats :
– la position de l’Allemagne s’est considérablement renforcée par rapport à celle de la France : sur le plan économique à l’évidence mais aussi grâce à sa place centrale au sein de l’Europe. La France détient toutefois deux atouts essentiels : sa force de frappe nucléaire et son siège au Conseil de Sécurité de l’ONU ;
– le « couple » franco-allemand n’a plus le même poids au sein des institutions européennes et s’est dilué au sein d’une Europe institutionnelle donnant aux petits États quasiment le même poids qu’à ceux qui jouent un rôle majeur dans la vie internationale. La Commission, quant à elle, saisit la moindre occasion pour renforcer son rôle en présentant l’unification des politiques sectorielles des Etats membres comme la solution unique aux problèmes à résoudre ; sa présidente, dont le mandat est de cinq ans, se veut l’incarnation de l’Europe, davantage que le « président de l’UE » ou le président du Parlement européen, dont les mandats sont deux fois plus courts, a fortiori que le président du Conseil européen qui pour agir ne dispose que de six mois[5] ;
– malgré ou à cause de cela les ferments de dissensions entre États membres s’accroissent, même si les spreads de taux[6] ont été jusqu’à présent contenus. Il est en effet de plus en plus difficile de concilier, d’une part l’élargissement de l’Union à des pays de plus en plus disparates politiquement et économiquement, d’autre part l’unification des politiques sectorielles ; vouloir trouver une solution unique aux problèmes rencontrés dans un territoire aussi vaste et divers relève de la gageure[7].
Dès lors on ne voit plus très bien quel est aujourd’hui le projet européen, quelle Europe il vise à construire. L’UE se réfère à des « valeurs » mais se garde bien de les nommer, de peur que leurs fondements historiques, philosophiques ou religieux heurtent certains. Elle s’est transformée en un complexe mécanisme de redistributions financières entre États et entre acteurs économiques. Elle est ainsi devenue une sorte d’ONU miniature, doublée d’un distributeur de billets destinés à ceux qui font allégeance à Bruxelles. Est-ce là ce que les promoteurs de l’idée européenne ambitionnaient ? Est-ce là l’ « Europe souveraine » souhaitée par Emmanuel Macron ?
Dans ce contexte, l’Allemagne joue à présent un jeu ambivalent. Le modèle économique sur lequel elle a fondé sa puissance et qui la plaçait sous la double dépendance de la Russie pour l’énergie et de la Chine pour la puissance industrielle et les exportations, est désormais menacé. Mais elle dispose elle aussi d’une force de frappe, financière celle-ci, qui lui permet d’intervenir massivement. Elle peut donc choisir, selon ses intérêts, de jouer la carte de l’Union ou celle de l’autonomie et semble désormais préférer de plus en plus souvent cette dernière option. Cette attitude reflète une affirmation de puissance clairement exprimée en septembre par Christine Lambrecht, la ministre de la Défense : « La taille de l’Allemagne, sa situation géographique, sa puissance économique, bref son poids, fait de nous une puissance de premier plan, qu’on le veuille ou non ». Olaf Scholz a donc pu affirmer en mai que « bientôt l’Allemagne aura la plus grande armée conventionnelle d’Europe » et dégager à son profit une enveloppe de 100 Md€ ; annoncer sans s’être concerté avec ses alliés européens ni avec la Commission un plan de soutien à l’économie de 65 Md€, puis un autre en septembre de 200 Md€, mobilisant ainsi 8 % du PIB ; ou faire cavalier seul pour conclure des contrats d’approvisionnement en gaz remplaçant ceux qu’il avait avec la Russie. Le « changement d’époque » (Zeitenwende) annoncé par Olaf Scholz au Bundestag après l’invasion de l’Ukraine par la Russie doit donc être compris comme un ambitieux repositionnement d’ensemble de l’Allemagne.
La France doit donc impérativement surveiller son « partenaire » pour éviter qu’il ne prenne trop d’ascendant ; elle doit le faire d’autant plus scrupuleusement que, comme Bruno Le Maire l’a affirmé dans une récente interview, « nous n’avons jamais eu la même idée du couple franco-allemand » : si l’on file la sempiternelle métaphore, l’un veut une relation englobante et exclusive, l’autre préfère l’amour libre. La France doit aussi prendre conscience des dérèglements qui frappent l’ensemble de la « famille » européenne et de l’inadaptation des institutions européennes à une Europe aux limites de plus en plus floues, prétendant concilier dilution des États forts et unification des politiques sectorielles.
Mais elle doit également s’inspirer de l’histoire allemande récente et
– en parallèle de ce que l’Allemagne a fait avec constance vis-à-vis de l’Europe centrale et du Nord, développer elle-même des liens privilégiés avec l’Europe méditerranéenne[8] ;
– comme l’Allemagne l’a fait il y a vingt ans, se décider enfin à assainir ses finances publiques pour améliorer sa productivité, mais aussi accepter de travailler davantage[9] ;
– comme l’Allemagne le fait aujourd’hui, consacrer davantage d’énergie à défendre ses propres intérêts plutôt qu’à faire des leçons de morale à la planète entière.
Jean-Philippe Duranthon (Geopragma, 13 novembre 2022)
Notes :
[1] Désaccord sur la régulation des prix de l’énergie, refus d’organiser un déplacement conjoint Scholz/Macron en Chine, préférence pour l’achat de matériels militaires américains (F35 par exemple) plutôt que français, désaccords sur les projets communs de système de combat aérien SCAF et de char du futur MGCF, lancement d’un projet de bouclier antimissile fondé sur le système Patriot américain et concurrent de celui que la France a engagé, etc.
[2] Annegret Kramp-Karrenbauer, alors ministre de la Défense, a ainsi déclaré en novembre 2020 que « les Etats-Unis d’Amérique ont été et restent le principal allié en matière de politique de sécurité et de défense. Et ils le resteront dans un avenir proche. »
[3] On fait ici référence au quantitative easing consistant, pour la BCE, à acheter des titres de dette publics ou privés.
[4] Lorsque la Finlande et la Suède auront intégré l’OTAN les seuls pays membres de l’UE qui ne seront pas membres de l’OTAN seront l’Autriche, Chypre, l’Irlande et Malte. Inversement, les seuls pays européens membres de l’OTAN mais pas de l’UE seront l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro (tous les trois candidats à l’UE), l’Islande, la Norvège et le Royaume Uni, la caractère européen de la Turquie pouvant être discuté. L’Ukraine souhaite faire partie des deux structures.
[5] La fonction de président du Conseil européen est exercée par roulement par chaque pays membre pendant 6 mois.
[6] Ecarts entre les taux auxquels les pays peuvent se financer sur les marchés.
[7] A l’inverse et paradoxalement, la Commission propose de reconnaître, pour la révision du pacte de stabilité budgétaire, la possibilité pour chaque Etat membre de déterminer quasi librement la façon d’atteindre les objectifs communs.
[8] Les semaines récentes montrent, s’agissant de l’Italie, l’ampleur du chemin à parcourir. Saluer la nomination du nouveau gouvernement italien issu des élections du 25 septembre en déclarant, comme l’a fait la ministre des affaires européennes, Laurence Boone, que « nous serons très vigilants sur le respect des valeurs et des règles de l’Etat de droit » n’est pas le meilleur moyen de créer un climat de confiance : dans d’autres pays des leaders peu recommandables fraichement élus ou réélus dans des conditions bien moins démocratiques ont bénéficié d’accueils plus chaleureux. De même, et indépendamment de la nature des décisions de fond qui ont été prises, la façon dont a été géré l’accueil de l’Ocean Viking et les déclarations ministérielles faites à cette occasionne favorisent pas l’entente et la coopération entre les deux pays.
[9] Alors qu’en 2004 les Français et les Allemands avaient la même durée moyenne de travail effectif, soit 616 heures par an, les premiers ont depuis légèrement réduit cette durée (610 heures) alors que les seconds augmentaient fortement la leur (704 heures).