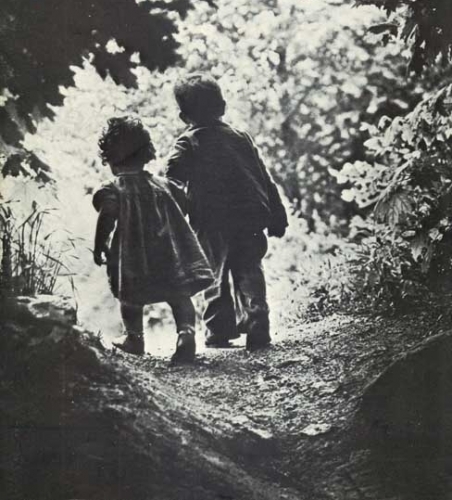Quel avenir aux empires ?
Nous sommes tellement convaincus que la démocratie à l’occidentale est l’étape finale de l’histoire que nous n’envisageons pas un instant que celle-ci puisse aller dans un autre sens. Cela résulte du fait que la démocratie étant sacralisée dans nos sociétés comme le bien par excellence, on ne voit d’alternative que dans ce qui parait être le mal absolu, et qu’on croit être l’opposé exact de la démocratie, le totalitarisme. Mais il y a d’autres configurations possibles, comme l’histoire l’a montré. Et notamment les empires. L’actualité met en outre les projecteurs sur la coupure en cours entre les démocraties occidentales et ce qu’on perçoit comme une alternative russo-chinoise, vue comme autoritaire, agressive et, précisément, impériale.
On parle donc beaucoup d’empires. Mais avec beaucoup d’imprécision. Il y en a eu des formes variées dans l’histoire, mais le terme n’a son sens plein que pour désigner un pouvoir autoritaire, direct, sur un territoire vaste et relativement hétérogène, dépassant l’horizon d’une nation. C’est le sens qui sera retenu ici. Au sens strict il n’y a en plus vraiment aujourd’hui, tout au plus partiellement : le langage courant parle d’empire américain, pour ce qu’il est plus précis d’appeler une hégémonie.
Est-ce à dire qu’il n’y en aura plus à l’avenir ? Non, et le contraire est même probable. Nous sommes en effet dans une période de transition : nos systèmes donnent bien des signes de faiblesse, les brassages de peuples s’intensifient notamment dans les pays avancés, de nouvelles puissances montent, et la guerre réapparaît là où on ne l’attendait plus. L’histoire va donc se remettre en mouvement. Or dans une période troublée et évolutive, la formule impériale a toutes ses chances. Ce qui ne veut pas dire que cela soit souhaitable…
Qu’est-ce qu’un empire ?
Le terme d’empire défini comme ci-dessus s’oppose à celui de nation. Ce qui caractérise sauf rares exceptions une nation est son homogénéité ethnoculturelle. L’empire, lui, est plurinational, même si une ethnie ou nation y domine. La problématique de l’empire se définit dès lors largement par rapport à la question nationale. Un des aspects de cette opposition est la question de la démocratie. Comme je l’ai montré ailleurs (Les Nations et leur destin), le système démocratique exige normalement de s’appliquer à une nation, homogène, ayant la même langue et la même culture. Une nation peut être démocratique (au sens large) ou pas, un empire normalement pas.
Un empire est en général le fruit d’une conquête militaire, et le rapport de forces en reste une dimension essentielle. Certains sont plus ou moins éphémères, et sans trace historique ultérieure. Car ils durent en général moins que les nations au sens large, parce que plus complexes, et faute du support objectif que ces dernières trouvent dans le fait national. Mais on a des cas d’empires qui ont duré longtemps et joué un rôle significatif, ainsi Rome, ou la Chine impériale. Toutes deux se sont avérées capables d’offrir une possibilité réelle d’assimilation aux populations conquises et d’abord à leurs dirigeants. Par-là de tels empires ont adopté certains des traits d’une nation, et notamment une certaine unité linguistique. Et ils ont duré plus longtemps.
L’expérience de l’Europe est tout à fait différente. L’histoire européenne n’a pas fourni de cas d’unification impériale et s’est même caractérisée par son éloignement de ce modèle, qui imprégnait pourtant les esprits encore au Moyen Âge. Cette grande fragmentation politique sur une base largement nationale est spécifique à l’Europe. Quant aux empires coloniaux européens à partir du XIXe, ils étaient clairement distingués de leurs métropoles. Celles-ci étaient des démocraties au moins partielles, nationales, et leurs empires non. Ils ont joué un rôle décisif pour modeler la planète telle que nous la connaissons. Mais fondés qu’ils étaient sur des principes contradictoires et sur un rapport de force transitoire, sans véritable assimilation, ils ont très peu duré.
Empires et nations : forces et faiblesses
On l’a dit, l’empire est une entité vaste, complexe, réunissant des parties hétérogènes. L’État-nation, lui, raisonne sur un seul peuple, un seul territoire, une seule communauté politique. La nation tend à homogénéiser et exclure ce qui n’entre pas dans son schéma, l’empire lui traite différemment les différents peuples. Il accepte la différence comme telle, moyennant soumission ; l’État-nation cherche à la dépasser. Cette hétérogénéité possible permet à un empire de gouverner, du moins un temps, des ensembles plus vastes et diversifiés, ce que la base nationale exclut. Les empires sont d’ailleurs souvent pragmatiques et flexibles, tant que leur pouvoir n’est pas remis en cause.
L’existence de sous-communautés est relativement compatible avec les systèmes autoritaires et donc les empires. Mais c’est contradictoire avec une démocratie. Celle-ci suppose en effet que les élections se fassent sur la base d’un vote sur des options diverses, au sein d’une population suffisamment cohérente et homogène pour que la minorité accepte la loi de la majorité comme représentative d’un peuple auquel tous s’identifient. Si ce n’est pas le cas, la démocratie sera remise en cause et, au-delà d’elle, la vie commune et la solidarité qu’elle comporte.
D’où une conséquence importante : l’empire (ou un autre système autoritaire) peut donner une réponse à la désagrégation de systèmes politiques, notamment démocratiques, si leur hétérogénéité notamment culturelle ou ethnique devient ingérable. Ce qui nous conduit à une interrogation importante pour notre époque. Au vu de l’hétérogénéité et des fragilités croissantes de nos constructions politiques, l’idée vient à l’esprit que les chances des empires à l’avenir sont loin d’être nulles, malgré leur limites.
Des exemples d’empires dès aujourd’hui ?
Où en est-on aujourd’hui ? Si nous n’avons actuellement plus d’empire au sens retenu ici, certaines situations méritent attention.
Il y a d’abord actuellement plusieurs exemples intermédiaires, de pays pluriethniques ou plurinationaux, mais où l’une de ces nations ou ethnies est nettement majoritaire et structure l’État. Des exemples évidents en sont l’Iran, la Turquie, certains pays d’Amérique latine Ces minorités fortes subsistent, mais elles sont en position d’infériorité nette ; et donc cela peut durer.
Le cas russe est à mettre à part. Il y a toujours eu dans l’empire russe comme en URSS une majorité russe, mais les minorités y étaient importantes. A l’époque, le pouvoir avait su se maintenir par un mélange d’autoritarisme et d’intégration habile d’élites locales, qui trouvaient une place dans le système impérial. Cet empire s’est désagrégé. Reste aujourd’hui une situation confuse. Il y a en Russie même des minorités appréciables, notamment musulmanes. En cela, elle se rangerait plutôt dans la série précédente. Mais le cas russe en diffère à deux titres, le premier étant la présence de minorités russes à l’extérieur, question sensible et reliée au passé impérial. Le deuxième est que la Russie ne considère pas ce qui relevait de l’empire russe ou de l’URSS comme complètement extérieur. D’une certaine façon, sa conception de soi et ses frontières ne sont pas clarifiées. D’où la question d’une permanence impériale dans la problématique russe.
La Chine présente des traits analogues, avec ses minorités tibétaines, ouïgoures etc., mais en moins marqué : la prépondérance de l’ethnie chinoise y est massive ; en outre son territoire correspond très largement à celui de l’ancien empire et elle a peu de revendications historiques à faire valoir.
A terme, la réémergence d’empires ?
Un empire à l’ancienne suppose la conquête militaire par un pays de ses voisins. A première vue, il paraît ne pas y avoir de base pour cela dans le monde que nous connaissons aujourd’hui. En outre le maintien de l’hégémonie américaine dans des zones majeures de la planète rend l’exercice difficile.
Il y a une exception possible, on l’a vu : la Russie. Mais en regardant de près, la réponse ne paraît pas non plus assurée. On note d’abord dans ce pays une hésitation entre le modèle impérial et un modèle national russe : l’invasion de l’Ukraine est-elle motivée par la remise en cause de sa réalité comme État, au profit d’une vision impériale ; ou n’assiste-t-on pas, de façon pas nécessairement consciente côté russe, à une affirmation ethnico-nationale proprement russe ? En tout cas l’agression a eu pour effet de souder un sentiment national ukrainien jusqu’ici flou, appelé à durer au moins dans la partie centre et ouest. De ce point de vue, l’invasion aura probablement ce résultat a priori paradoxal d’y faire basculer la problématique dans un sens national homogène, comme l’ont fait les nettoyages ethniques post-yougoslaves. S’agissant des autres minorités russes ou russophones de la périphérie immédiate, on pourrait imaginer une agression russe dans les pays baltes (mais la Russie se heurterait ici directement à l’Otan), ou au Kazakhstan. Mais là encore cela ne déboucherait pas sur un empire, et par certains côtés au contraire : on s’éloignerait de ce modèle pour se rapprocher d’une logique purement nationale (agressive en l’occurrence). Tout autre est la question des éventuelles ambitions russes au-delà de ce périmètre russophone, notamment dans sa zone de domination anciennement soviétique (Caucase, Asie centrale, etc.). Mais en supposant que la Russie en ait l’intention, elle ne paraît en état d’aller bien loin, au vu des limites de l’armée russe apparues en Ukraine, sans parler de celles de l’économie et de la démographie ; et elle se heurterait assez vite à d’autres puissances (Otan, et même Chine). Et ce serait a fortiori le cas au-delà de ces zones. Dès lors, la perspective véritablement impériale apparaît dans les années qui viennent plutôt limitée pour ce pays, au-delà d’une forme d’hégémonie sur une partie de l’ancienne URSS.
La perspective impériale est en revanche bien plus plausible à terme plus ou moins éloigné dans le monde arabo-musulman, surtout avec le recul de l’hégémonie américaine. Ainsi dans le monde arabe où les États restent assez artificiels, et souvent sans base nationale propre suffisante. Par ailleurs, Turquie et Iran, en partie hétérogènes, ont été de vrais empires et s’en souviennent. La Turquie notamment, avec sa nostalgie ottomane soigneusement entretenue par R. Erdogan et la constitution progressive d’un rôle international qui pourrait assez vite tourner à l’empire. Mais un Iran dépassant l’impasse actuelle pourrait aussi entrer dans ce schéma.
De même, la possibilité d’empires est tout à fait concevable à terme en Asie, notamment avec l’impressionnante émergence de puissances comme la Chine ou l’Inde. Certes, cela ne paraît pas être leur priorité dans l’immédiat, car elles sont pour l’essentiel axées sur leur montée en puissance, même si elles ne dédaignent pas d’exercer une forme d’hégémonie. Mais la situation pourrait évoluer à terme plus long. Et leur surpuissance par rapport aux pays voisins sera alors considérable.
Une forme nouvelle d’empire : l’Europe ?
Il est intéressant d’élargir le débat au-delà des empires classiques, construits sur une base guerrière. A notre époque on peut en effet envisager des processus différents d’évolution vers des formes politiques de type impérial. A terme plus ou moins long, dans un contexte instable où la confiance deviendrait très difficile, des formules robustes comme celle-là peuvent alors avoir leurs chances. La remarque vaut bien sûr d’abord pour les empires éventuels qu’on vient d’évoquer, des hégémonies pouvant devenir tellement prégnantes qu’elles ressemblent à des empires ; on pense alors naturellement d’abord à la Chine.
Mais la question mérite d’être posée dans le cas de l’Europe. En fait, élément militaire mis à part, l’Union européenne ressemble quelque peu à un empire : ce n’est pas une nation mais elle est composée de nations variées ; elle constitue un pouvoir supranational en surplomb, qui se fonde certes en principe sur les démocraties nationales, mais tend à considérer le niveau national comme subalterne, historiquement dépassé, à réguler par en-haut. Ce pouvoir n’est pas élu directement comme un pouvoir politique national ; le ‘parlement’ est élu sur la base d’élections qui se font en fait sur des listes nationales ; l’exécutif n’est pas élu. Le pouvoir politique européen n’est donc pas véritablement responsable devant des électeurs. Ce pouvoir reste toutefois limité à certains domaines, même s’ils sont de plus en plus vastes ; on reste donc dans une situation intermédiaire.
Comment peut-il évoluer ? Il ne peut pas se construire politiquement comme une démocratie nationale : il n’y a pas de peuple européen, ni de vie politique européenne. Il pourrait évidemment se rebâtir sur un projet différent, fondé sur ses nations, mais il ne prend pas ce chemin. Il peut bien sûr continuer de stagner dans un entre-deux bâtard sous hégémonie américaine : c’est le plus probable.
Mais, hors une dislocation possible, on peut imaginer un autre scénario, surtout en cas de crise grave. Dans un contexte de fragilisation des systèmes politiques et économiques nationaux, dont les bases d’identification nationale ont été érodées, ce à quoi s’ajoute l’hétérogénéité croissante des populations vivant en Europe, avec une immigration massive qui peut encore s’accélérer, on peut imaginer, lors d’une crise très grave, un transfert de pouvoir massif, plus ou moins consensuel des états membres à Bruxelles, qui deviendrait tête d’une sorte d’empire. Cela dit, cet empire resterait un peu bizarre, du fait que militairement il est a priori peu probable à ce stade qu’il se détache de l’Otan et donc de l’hégémonie américaine. C’est donc un scénario, mais pas la plus forte probabilité.
Pierre de Lauzun (Geopragma, 8 janvier 2023)