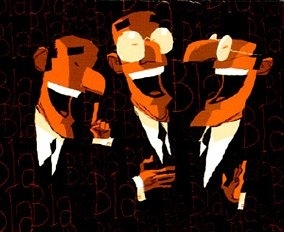Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Gérard Dussouy, cueilli sur Polémia et consacré au rôle que devraient se donner les populistes européens pour œuvrer à une renaissance européenne.
Professeur émérite à l'Université de Bordeaux, Gérard Dussouy est l'auteur de plusieurs essais, dont Les théories de la mondialité (L'Harmattan, 2011) et Contre l'Europe de Bruxelles - Fonder un Etat européen (Tatamis, 2013).

Les populismes européens : derniers spasmes des vieilles nations ou agents de transformation de l’UE ?
Quand on considère les crises présentes qui ne font que commencer, quand on observe la carence conceptuelle, stratégique et politique des États européens face à la guerre, et que l’on s’interroge sur la crédibilité politique des populismes européens sous un angle systémique, c’est-à-dire quant à leur raison d’être et quant à leur capacité à agir sur le système mondial dans lequel les peuples et les individus se retrouvent tous désormais inclus, la question se dédouble ainsi : sont-ils les derniers spasmes des vieilles nations européennes ? Pourraient-ils être les agents de la transformation, et de la renaissance, de l’Europe ?
Il faut bien comprendre en effet, que les dernières vagues populistes en majorité souverainistes sont le produit d’une contrainte systémique multivariée, à la fois économique, sociale, démographique, culturelle. Ces mouvements sont les effets rétroactifs d’un système que les États ont construit qui, dans le même temps, limite leur action et leur capacité d’action politique. C’est bien pourquoi les partis populistes demeurent avant tout des forces protestataires ne sachant pas à qui véritablement s’adresser parce que leurs participants ont conscience que leurs propres États ont perdu toute prise sur le réel. Ils sont le témoignage d’un désarroi total qui conduit les plus nombreux, à droite, à entretenir jusqu’au bout l’illusion souverainiste, et les plus minoritaires, à gauche, à se perdre dans les divagations de la révolution sociale et écologique universelle.
Les populismes, produits de la contrainte systémique des États et des peuples
Une proportion plus ou moins élevée de citoyens européens ne s’y retrouve plus, aussi bien en termes de valeurs et de traditions que de niveaux de vie et de sécurité, dans un système mondial que bien entendu leurs gouvernants ne contrôlent pas, après avoir approuvé sa construction.
La déstabilisation économique et sociale des sociétés européennes
En France, la crise des Gilets Jaunes a été emblématique de cette déstabilisation ; elle est la révolte des victimes d’une insertion mondiale non préparée. Elle n’a pas eu d’équivalent dans les autres États européens, à la structure politique et sociale moins centralisée, moins rigide, et pour certains moins désindustrialisés que la France. En Allemagne, particulièrement performante à l’exportation en raison de sa remarquable spécialisation industrielle, la contestation y a été très limitée, dans les seuls Länder de l’Est. La situation pourrait changer maintenant que l’Allemagne « s’est tiré une balle dans le pied » en mettant fin, à cause de la question ukrainienne, au partenariat fructueux qu’elle avait établi avec la Russie.
D’une manière générale en Europe, on constate, selon Peter Sloterdijk, un retour du pessimisme sociologique avec la « fin du temps de la gâterie » qu’il illustre ainsi : depuis trente ans, d’un rapport 80% de riches à 20% de pauvres on est passé au rapport inverse de 20% à 80%. La fin de l’opulence accentue la fracturation sociale qui fait l’objet d’une thématique maintenant rebattue, celle de la rupture entre élites et peuples. Elle est au fondement des populismes contemporains [1].
Le sujet de l’économie est déterminant pour l’avenir parce que la « légitimité » du système mondial, qui est fondé sur le libre-échange, repose sur la croissance globale, et de préférence, sur la croissance partagée. Or, plusieurs économistes, avec en pointe Robert Gordon, s’attendent à ce que l’économie mondiale entre dans une ère de stagnation, même si la croissance de l’après covid connait un rebond. A cela, des causes économiques endogènes : endettement généralisé et baisse des investissements productifs, compétition accrue et acharnée sur l’énergie et les matières premières, retour de l’inflation. Mais aussi, des causes exogènes telles que le vieillissement des populations, consécutif à la dénatalité [2]. Ce que l’on ne veut pas comprendre en Europe, souverainistes compris, quand on privilégie son confort à sa descendance !
La prégnance de la question identitaire et de l’enjeu civilisationnel
C’est là la cause, plus que le constat précèdent aujourd’hui, de la persistance et de l’enracinement des mouvements populistes les plus nombreux, c’est à dire ceux à tendance souverainiste. Comme on le constate en France, en Italie, en Europe de l’Est. Bien entendu, cette problématique relève aussi de la contrainte systémique mondiale que figurent, dans ce cas précis, les flux migratoires massifs. Sa résolution, qui peut comprendre différents stades allant du simple arrêt de l’invasion à la remigration, et qui peut se concevoir selon des modalités adaptées aux contextes nationaux, n’est envisageable, pour être efficace et définitive, qu’à l’échelle du continent. A l’intérieur de celui-ci, il est impossible de rétablir des frontières compte tenu des interdépendances de toutes natures, et elles ne seraient de toutes les façons que trop poreuses. Tout dépend donc des dirigeants de l’Union et des États qui la composent, quand on considère les expériences en cours dans différents États européens en matière de politique migratoire : échec complet du Brexit (sauf l’arrêt de l’immigration d’origine européenne !), blocage des entrées et des séjours en Hongrie, résultats attendus au Danemark des lois très restrictives en matière d’immigration que son gouvernement de coalition vient d’adopter au nom de la survie de l’identité nationale. D’une façon générale, au niveau planétaire, les changements dans les rapports de force ont porté au premier plan l’enjeu civilisationnel. Constatons aussi qu’à ce contexte mondial anxiogène, les populistes verts ajoutent la terreur climatique.
La confrontation au réel. Les populistes peuvent-ils transformer la politique et desserrer la contrainte systémique ?
Face aux réalités du monde globalisé, la montée en puissance des populismes en Europe (divers scrutins électoraux nationaux ou régionaux la confirment de façon continue) pose la question de leur capacité à gouverner, mais surtout à influencer les politiques nationales et à faire adopter par leurs États respectifs et mieux encore par l’Union européenne, des mesures susceptibles de desserrer la contrainte systémique. Parce que c’est bien à son niveau à elle que l’essentiel se joue. La vraie question est alors de savoir si malgré leur dispersion idéologique, malgré l’incohérence politique qui les habite, certains mouvements populistes sont susceptibles de transformer l’UE et d’en faire, face au reste du monde, la forteresse dont les Européens vont avoir le plus grand besoin. Qu’en sera-t-il en 2024 et après ?
L’échec des populistes aux élections parlementaires européennes de 2019
Le bilan des populistes de la session 2019-2024 est négatif. D’une part, lors des élections au Parlement européen du 20 Mai 2019, les eurosceptiques n’ont pas remporté le succès escompté. Malgré leur progression, ils sont restés loin de la majorité de 367 députés nécessaire pour gouverner le Parlement européen. Le bloc pro-européen, ou europeo-atlantique à la mode libérale et américanophile, a reculé, mais il a conservé la majorité en cumulant les sièges du PPE (182), de Renew Europ (108) et des Socialistes et Démocrates (154). D’autre part, et c’est ce qui est le plus pathétique, les populistes n’ont pas été capables d’enclencher, ou seulement de penser, une dynamique transformatrice, restauratrice d’une Union au service des peuples, à partir de propositions réalistes et audacieuses et d’actions de communication de grande envergure. On peut faire deux constats qui sont deux explications à cet échec des populistes :
1) L’attachement, sous-estimé par les souverainistes, des citoyens et d’une majorité d’électeurs européens à l’UE et à l’euro
A la veille des élections de 2019, différents sondages dont ceux de l’institut britannique Yougov et d’Eurobaromètre indiquaient que si en 2014 un peu plus de la moitié des Européens (51%) approuvaient l’existence de l’euro et de l’EU, ils étaient 75% en 2019 à se prononcer pour l’UE et 62% à déclarer soutenir l’euro. A noter que 67% des Grecs eux-mêmes étaient favorables à l’Union malgré l’austérité que Bruxelles leur avait infligée pour les sortir de la crise financière profonde dans laquelle ils étaient plongés. Dans tous ces sondages, on constatait qu’une majorité de citoyens de l’UE souhaitent voir l’Europe devenir un acteur incontournable sur la scène internationale.
2) L’hétéroclisme des populismes et leur manque de crédibilité
Au sein du Parlement européen actuel, on distingue au moins trois courants qui sont incompatibles :
- Les populistes souverainistes d’Identité et Démocratie (76 sièges et 10,9% de l’hémicycle) et de Conservateurs et Réformistes européens (62 sièges et 8,8%). Le premier groupe réunit la Lega italienne, le Rassemblement National français, l’AFD allemande (véritable nouveauté en 2019 parce que c’est le parti qui a le plus progressé ces dernières années), le FPÖ autrichien, et le Vlams Belang flamand qui est plus séparatiste qu’il n’est souverainiste. Au sein de cet ensemble l’unanimité ne règne pas, ni quant à la politique monétaire de la BCE, ni quant à la politique commerciale de l’UE, ni quant à une éventuelle défense européenne. On attend toujours un programme commun. Quant au second groupe, le CRE, il réunit les Polonais de Droit et Justice et les Italiens rivaux de la Lega de Fratellini d’Italia, aujourd’hui au pouvoir. La caractéristique majeure de ce groupe est de s’opposer à toute avancée vers plus de supranationalité. Il a montré ces derniers temps beaucoup d’empathie envers l’Otan.
- Les populistes anticapitalistes (désignons les ainsi) regroupés dans la confédération formée par la Gauche Unitaire Europe et la Gauche Verte Nordique sont 40 députés issus de 14 Etats européens. Sans être hostiles à l’Union européenne en soi, ils lui reprochent son orientation libérale, mais en tant qu’internationalistes ils réfutent toute idée d’une Europe autocentrée et décidée à défendre ses identités.
- Les populistes écologistes. Les verts constituent un groupe de 68 députés au Parlement. Favorables à la pérennisation de l’UE, ils se cantonnent à une position critique, cette dernière n’accédant pas encore à leurs revendications les plus extrêmes en matière de réglementation climatique et d’immigration. Contrairement à la certification scientifique dont ils se prévalent, Ils se comportent, à l’image de leur icône Greta Thunberg, comme des populistes tant ils font dans le catastrophisme et tant leurs propositions sont simplistes, manquent de rationalité.
2024 et après : transformer l’Union pour desserrer la contrainte systémique et accéder à une souveraineté partagée ?
Plutôt que de passer leur temps à dénigrer l’Union européenne, sans proposer la moindre alternative ou la moindre réforme en termes conceptuels, politiques et stratégiques, les leaders populistes devraient prendre la mesure de la force des interdépendances qui la caractérise. Afin de la mettre au service des intérêts communs dans le cadre d’une souveraineté partagée.
C’est l’Union qui a permis, exemple des plus récents, aux pays partenaires de surmonter plus facilement qu’ils ne l’auraient fait de manière isolée, la crise de la covid 19. Le plan de relance européen de 1800 milliards d’euro n’est pas rien. Il permet à la France en faillite d’escamoter une partie de ses dettes ! Sur le plan financier et monétaire, précisément, les populistes souverainistes ont l’habitude de critiquer la BCE et ils se déclarent opposés à la supervision communautaire des dettes nationales, mais ils veulent ignorer que si plusieurs États du sud de l’Union prospèrent encore, c’est parce qu’ils se trouvent sous le « parapluie monétaire » de l’euro, pour ne pas dire de l’Allemagne. En ce sens que c’est la monnaie commune qui a permis à ces Etats pendant des années d’emprunter à des taux d’intérêt très bas. Les souverainistes sont, en réalité, sans solution de rechange, sauf à revenir à des monnaies nationales totalement dévalorisées et à accroitre la dépendance financière de leurs pays respectifs par rapport à des créanciers comme la Chine, ou à accepter la dollarisation de leurs économies, perspective qui n’est pas du tout à écarter en cas de crise générale des monnaies (plausible en raison de l’endettement des principales économies) et d’une fusion imposée par Washington du dollar et de l’euro. Dans le contexte éminemment favorable du raffermissement du protectorat otanien.
A la veille des élections européennes de 2024, de la désignation d’un Parlement européen qui a les moyens, si sa nouvelle majorité le voulait et le décidait, de modifier la politique menée jusqu’à maintenant par la Commission, d’en prendre le contrepied dans certains secteurs comme celui de la politique migratoire, les populistes les plus conséquents, ceux pour qui le priorité est la sécurité des identités et la prospérité des Européens, seraient bien inspirés de s’organiser en vertu d’un programme susceptible de changer le cours des choses, celui d’un régionalisme stratégique. Cette terminologie, empruntée à deux politologues canadiens, renvoie à trois objectifs : l’amélioration de la sécurité économique et énergétique de tous les partenaires grâce à une politique commune entièrement repensée ; la réorientation de l’Union vers plus d’autocentration en termes d’investissement, de productions et de consommations locales ou relocalisées ; l’achèvement de la zone euro en une véritable Zone Monétaire Optimale (selon les critères de l’économiste canadien Robert Mundell). Objectifs essentiels auxquels l’urgence des temps impose que l’on en ajoute un quatrième, tout aussi vital : une politique migratoire très restrictive et très sélective.
Conclusion
L’inclusion des sociétés européennes dans le système mondial leur a imposé une contrainte extérieure anxiogène multiple (économique, sociale, démographique culturelle) qui est à l’origine des mouvements protestataires désignés sous le vocable de populistes. Si du fait de leur hétéroclisme, de leurs options politiques plus ou moins ouvertement nationalistes, ces mouvements populistes ne sont pas en mesure de desserrer la contrainte systémique, puisqu’ils se condamnent à l’impuissance du séparatisme, il faut s’attendre à ce qu’ils perdurent jusqu’au dépérissement complet des vieilles nations, dont ils seront les derniers spasmes alors qu’ils prétendaient vouloir les sauver. En revanche, s’ils sont enfin capables d’autocritique et s’ils parviennent, à l’occasion du prochain scrutin européen en particulier, à faire émerger une conscience européenne identitaire, à s’organiser et à agir en conséquence, alors tout n’est pas perdu.
Gérard Dussouy (Polémia, 10 juin 2023)
Notes :
[1] Gérard Dussouy, Le pragmatisme méthodologique. Outil d’analyse d’un monde complexe, Amazon, 2023,p.288.
[2] Ibidem, p. 322-325.
Pour aller plus loin : Gérard Dussouy, « Les populismes européens : une approche systémique », dans Nathalie Blanc-Noël et Thibaut Dauphin, Vers un nouvel âge des extrêmes ? Populismes et transformations sociales, Paris, L’Harmattan, Collection Pensée politique, 2023, p.219-243.