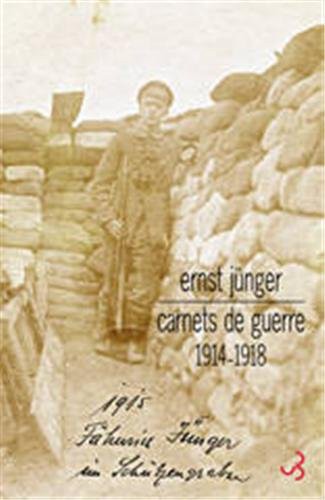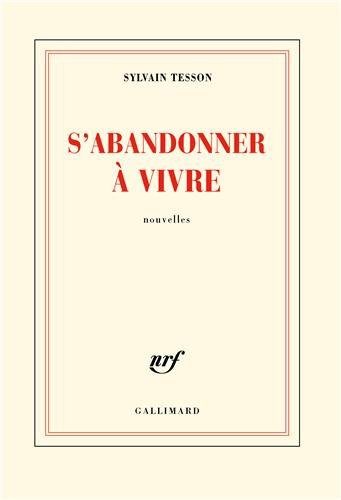Les Icônes du Vide
Les sociétés s’organisent autour de figures totémiques qui symbolisent, à un moment donné, l’identité à laquelle elles aspirent. De Vercingétorix à Clovis, de Jeanne d’Arc à de Gaulle, ces figures incarnent l’épaisseur, la stabilité, l’unité d’un destin glorieux qui se confond avec le progrès. La France se construit, au cours des siècles, à travers ces figures de la durée. L’identité intangible de ces figures permet à tout un peuple de partager l’idée d’une destinée commune. La France existe alors comme nation et les Français comme peuple. Dans une France postmoderne, ces figures exemplaires, qui donnent au destin l’épaisseur de la durée, ont été remplacées par les icones du vide que sont Loana, Zahia ou Nabilla, mais aussi tous les acteurs de la télé-réalité. Signe de cette évolution, des journaux comme Libération ou le Figaro choisissent de consacrer une pleine page à Nabilla ou Zahia.
Jeanne d’Arc est une idée. Nabilla et Zahia sont des corps. Jeanne d’Arc est asexuée, son destin est de sauver la France. Nabilla et Zahia incarnent la sexualité. Elles n’ont pas d’idées, leur destin est de donner leur nom à des lignes de sous-vêtements « sexy », imaginées par des marchands qui transforment chaque produit en objet du désir. L’objet industriel et le désir sont désormais étroitement liés. Smartphones, tablettes, voitures, hôtels, bars, subissent une transformation esthétique qui transcende leur fonction purement utilitaire. Le désir est ainsi le moteur du capitalisme postmoderne : objets, décors, mais aussi corps. L’industrie de la consommation fonctionne sur l’éveil du désir.
Les corps de Zahia et Nabilla sont des sculptures érotiques, artificiellement créées par la chirurgie esthétique. Gilles Lipovetsky et Jean Serroy considère, à juste titre, que « le style, la beauté, la mobilisation des goûts et des sensibilités s’imposent chaque jour davantage comme des impératifs stratégiques des marques : c’est un mode de production esthétique qui définit le capitalisme d’hyperconsommation. » (1) Ce qui est vrai pour les objets, inscrits dans la durée, en dehors des phénomènes de mode, est différent pour les corps. Le corps appartient au domaine de l’éphémère et les icones que nous propose la société de l’hyperconsommation et de l’hyperindividualisme respirent le vide.
La France se défait dans ces icones du vide. Loana, figure inaugurale du capitalisme-désir, a engendré ce basculement vers l’éphémère qui est l’aboutissement final de la société de consommation. Tel est le capitalisme moderne, machine de déchéance intellectuelle, qui remplit le vide de l’existence par des objets esthétisés, mais aussi avec les corps transformés de celles et de ceux qui sont chargés de séduire. Cette beauté artificielle exhibée correspond à une montée de l’individualisme : l’individu se soustrait du collectif pour affirmer une singularité, celle de sa propre vie. Là où Jeanne d’Arc s’inscrit dans le destin de la France, Loana, Zahia et Nabilla répondent à une demande hédoniste. L’individu ne se reconnaît plus dans la nation, il s’affirme dans la consommation et le culte de soi.
Signe des temps, Nabilla aura sa propre émission de télévision sur NRJ 12. La vie de Nabilla filmée quotidiennement devient le feuilleton d’une civilisation prise aux pièges de ce qu’elle produit de plus inutile. Le néant esthétisé devient la promesse d’un bonheur immédiat. Oubliant la politique, Jean-Marie Le Pen s’extasie devant les « beaux seins » de Nabilla qui, en échange, le trouve « trop marrant ». En vieux renard de la politique, Jean-Marie Le Pen sait qu’il s’adresse à un électorat dépolitisé qui regarde les émissions populaires dans lesquelles l’exhibition des corps huilés des bimbos de la téléréalité tient lieu de politique de civilisation.
De Platon à Camus ou Sartre, en passant par Nietzsche ou Marx, l’histoire de l’humanité prend la forme d’une formidable bataille des idées. L’homme, pour résoudre la confusion qui naît de Babel, bâtit des cathédrales de mots, car le mot est au début de toute chose. Platon lui-même avait banni l’image, c’est-à-dire l’artiste, de sa cité idéale, car, selon lui, l’image est trompeuse. « Aujourd’hui, maman est morte », écrivait Camus au début de L’Etranger, enfermant ainsi toute la philosophie de l’absurde dans ces quatre mots. Nabilla est célèbre pour sa phrase culte « Non mais allo quoi ! », créant ainsi un paysage du vide dans lequel vont s’engouffrer les offres de l’hyperconsommation.
Jeanne d’Arc et de Gaulle sont des Sisyphe qui parviennent à poser leur rocher au sommet de la montagne. Loana, Zahia et Nabilla, en stylisant de façon érotique l’univers du vide, nous font oublier Sisyphe. Marx écrit la théorie du matérialisme dialectique sans oublier que « les lois de la beauté » façonnent le monde. Loana, Zahia et Nabilla, qui n’ont pas lu Marx, savent, intuitivement que « les lois de la beauté » et du sexe dirigent le monde. Mais refusant la pornographie, elles proposent du sexe une représentation esthétisée. Le Beau est l’alibi du vide. Longtemps aristocratique, l’esthétisation du monde s’est prolétarisée. Mais, contrairement à Charlie Chaplin, Loana, Zahia et Nabilla sont des travailleuses des temps modernes en rupture avec le mode de production industriel fordien accusé de répandre la laideur. Dépourvu d’intention esthétique et de sexualité torride, le discours politique ne peut plus rivaliser avec le spectacle théâtralisé des corps des bimbos. L’important n’est plus l’idée, mais le corps. qui appartient désormais à la sphère économique et financière.
En donnant une émission de télévision à Nabilla, NRJ 12 n’obéit pas aux injonctions du culte du Beau. C’est au contraire de l’effondrement du Beau dont il est question, effondrement qui prolonge celui d’une société régie par des normes portées historiquement par la bourgeoisie ou la classe ouvrière et dont le projet est de soumettre l’individu au collectif. Jeanne d’Arc et de Gaulle sont les figures d’une société politisée à l’intérieur de laquelle l’individu s’inscrit dans un projet collectif. Loana, Zahia et Nabilla sont les icones d’une société dépolitisée, dans laquelle l’individu refuse l’homogénéisation que propose le collectif pour vivre sa différence radicale, une différence esthétisée. L’émotion politique est une émotion collective, comme celle que peut procurer le spectacle-symbole du défilé du 14 juillet ; l’émotion esthétique postmoderne est provoquée par l’érotisation des corps des bimbos dont les seins augmentent de volume à mesure s’affirme l’autonomie des individus et que diminue leur adhésion à un projet collectif.
Jeanne d’Arc et de Gaulle provoquent l’extase du plein, de la durée, Loana, Zahia et Nabilla, l’ivresse du vide, de l’éphémère. Après le moment de la nation qui prend le visage d’une succession de figures exemplaires consensuelles, voici venu le cycle nouveau de l’alliance entre la production marchande et l’autonomisation des individus qui additionne les icones du vide. A mesure que l’individu s’éloigne de la nation, se multiplient sur les chaînes de télévision les émissions de télé-réalité dont le rôle est de porter au plus degré l’autonomie de l’individu qui s’affranchit, dans son langage, son apparence, son vestiaire et sa sexualité, des normes civilisationnelles.
A l’ancien projet d’élévation intellectuelle des individus, nécessairement élitiste, se substitue le projet nouveau de désacralisation du Beau conventionnel à travers la fétichisation du corps des bimbos, forcément plus démocratique. Au-delà des stratégies marchandes d’un capitalisme postmoderne, il faut y voir l’avènement des dictatures « molles » que dénonçait déjà Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes ou que condamnait Alain Souchon dans Foules sentimentales. Paradoxalement, l’affirmation identitaire de l’individu qui se donne en spectacle est le moyen le plus sûr pour le nier comme être pensant et le reléguer dans la sphère de l’hyperconsommation.
Jeanne d’Arc et de Gaulle, chargés d’une haute valeur spirituelle, ont pu sauver la France. Loana, Zahia et Nabilla, qui assurent le triomphe du vide, peuvent-elles sauver le monde ? Elles sont, en tous cas, le signe évident de notre entrée dans un âge démocratique postmoderne. Et Dieu… créa la femme, le film de Roger Vadim, marque, en 1956, la première étape de l’émancipation des femmes. Près de 60 ans plus tard, les émissions de téléréalité, qui encouragent le culte des bimbos, sont le signe d’une redoutable régression que nous imposent les ruses esthético-érotiques du nouveau capitalisme marchand.
Christian Gambotti (Le nouvel Economiste, 3 juillet 2013)
Note :
(1) Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, L’Esthétisation du Monde, p.11, Gallimard, mars 2013