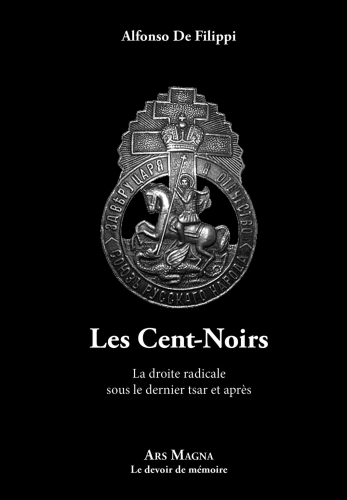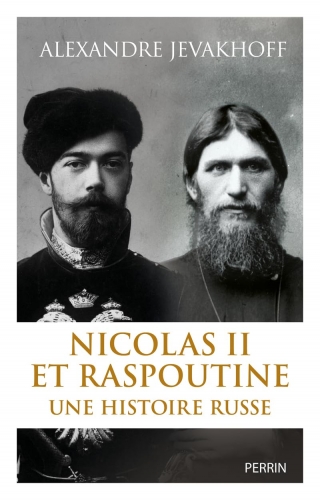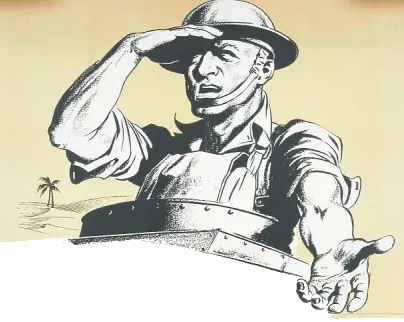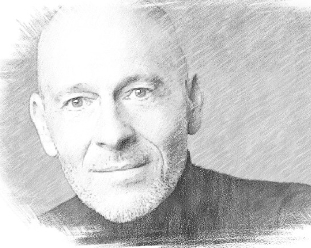Le plan Trump pour la paix en Ukraine du 23 novembre propose une trêve susceptible d’ouvrir la voie à la paix, à condition que le pouvoir ukrainien obtienne des garanties de sécurité.
Le plan Trump pour la paix en Ukraine, tel qu’il a été amendé lors des discussions américano-ukrainiennes du 23 novembre 2025 à Genève, doit être pris très au sérieux. Il représente une chance historique d’arrêter le massacre entre chrétiens slaves orthodoxes, commencé en février 2022 par l’agression de la Russie contre son voisin ukrainien. La trêve que ce plan propose – la paix ne viendra qu’après des années, voire des décennies de diplomatie – est de loin la moins mauvaise des options, pour les Russes, comme pour les Ukrainiens.
Combien de jeunes Russes et Ukrainiens, jadis frères au sein de l’Union soviétique, ont-ils perdu la vie après le passage à l’acte irrationnel de Vladimir Poutine ? Un demi-million ? Davantage ? Je dis irrationnel car cette agression, outre ses enfants morts, a coûté à la Russie quatre atouts qui étaient très importants à ses yeux : l’influence importante qu’elle avait en Ukraine ; un commerce très profitable avec l’Union européenne ; une économie prospère prête à développer l’immense Sibérie ; une Otan en « mort cérébrale » à ses frontières.
Le but stratégique de Vladimir Poutine était de faire de l’Ukraine un pays soumis à Moscou, un peu comme l’est la Biélorussie. Le président russe a échoué ; il n’a pas pris Kiev en une semaine ; il a seulement renforcé la combativité des Ukrainiens, ainsi que leur goût pour la liberté, l’indépendance, l’ouverture à l’Europe. Vladimir Poutine devrait se rendre compte qu’il peut continuer à faire souffrir l’Ukraine par sa guerre d’usure (où la Russie perd progressivement ses infrastructures pétrolières), mais qu’il ne parviendra jamais à la soumettre.
Une «opération militaire spéciale»
Si l’on se met dans les chaussures d’un président russe rationnel, on s’aperçoit qu’il aurait intérêt aujourd’hui à accepter l’offre américaine inespérée que lui fait le président Trump, à savoir le cessez-le-feu sur la ligne de contact actuel, la levée des sanctions, l’amnistie de tous les crimes commis, le retour de la Russie sur tous les marchés pétroliers et gaziers, l’édification de projets miniers et énergétiques communs entre la Russie et les États-Unis.
En forçant un peu sur la propagande, comme il sait très bien le faire, Poutine a les moyens de présenter à son peuple son « opération militaire spéciale » de février 2022 comme une nécessité passée et un succès présent. Il est faux de dire que Poutine ne peut pas arrêter les hostilités car il perdrait la face devant la nation russe. Sauver la face devant son peuple ne lui serait pas très difficile : il peut dire avoir protégé les russophones et russophiles du Donbass, avoir fait de la mer d’Azov une mer russe, avoir arrêté l’expansion de l’Otan vers l’est. Il peut, en outre, présenter un avenir radieux à son peuple, fait d’une exploitation commune de l’Arctique avec les Américains et de la Sibérie avec les Chinois.
La trêve est la moins mauvaise des options pour Poutine car l’actuel grignotage du territoire ukrainien par son armée lui coûte très cher et est particulièrement lent. Les Ukrainiens, passés maîtres dans le combat moderne par drones, savent très bien se défendre. Les experts militaires considèrent que la défense est trois fois moins coûteuse en hommes que l’offensive dans une guerre telle que celle d’Ukraine. Au regard des gains territoriaux conquis par Poutine sur l’Ukraine en 2025, il lui faudrait un demi-siècle pour conquérir l’intégralité du pays.
Pour les Ukrainiens, la trêve proposée par le plan Trump est aussi la moins mauvaise des options. Zelensky a lui-même avoué que son peuple était las de la guerre. Les jeunes générations fuient le pays. Où est la relève, quand on sait que plus de 600.000 jeunes hommes ukrainiens en âge de combattre vivent à l’étranger et n’envisagent pas de revenir au pays faire leur devoir patriotique ? Vu ce qu’elle coûterait en hommes, la reconquête militaire des territoires ukrainiens pris par les Russes depuis 2014 n’est pas envisageable.
Crier victoire et sauver la face
La trêve offrirait une stratégie de paix fructueuse au pouvoir de l’Ukraine, à la condition que Kiev obtienne les garanties de sécurité qu’elle réclame légitimement. Exploitation des terres rares avec les investisseurs américains. Lutte contre la corruption, qui est le fléau de toujours du pays. Édification d’institutions publiques fiables, permettant une accélération du processus d’entrée dans l’Union européenne. Zelensky pourrait, lui aussi, crier victoire et sauver la face : il a résisté à l’une des plus fantastiques armées du monde pendant près de quatre ans, il a sauvegardé la liberté et l’indépendance de son pays. Ce n’est pas rien !
Certes, on peut reprocher au plan Trump de bafouer la justice. Il est vrai qu’on ne verra pas la Russie rendre les territoires qu’elle a conquis par la force, livrer ses criminels de guerre à la CPI, verser des dommages de guerre à l’Ukraine. Mais c’est un idéal qu’il est totalement irréaliste d’attendre. La vérité est qu’il n’y a de justice internationale possible que lorsqu’un camp est clairement le vainqueur. Ce fut, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le cas des procès de Nuremberg et de Tokyo. Ce fut aussi le cas du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Mais quand des crimes de guerre sont commis par une puissance non défaite dans un conflit, ils n’ont aucune chance d’être jugés. L’invasion illégale de l’Irak en 2003 a provoqué des centaines de milliers de morts et un chaos toujours présent en Mésopotamie. George W. Bush et Donald Rumsfeld ont-ils été présentés à des juges ?
Il est indéniable que le plan Trump malmène fortement le droit international et la justice internationale. Mais il serait encore plus immoral de laisser se poursuivre le massacre sous prétexte de justice. Quelle serait la valeur d’une justice qui laisserait mourir demain des dizaines de milliers de jeunes gens pour la seule satisfaction potentielle de condamner un jour des dizaines de criminels de guerre ? Dans les relations internationales, la justice est évidemment une belle chose. Mais elle est rarement préférable à la paix.
Renaud Girard (Geopragma, 2 décembre 2025)