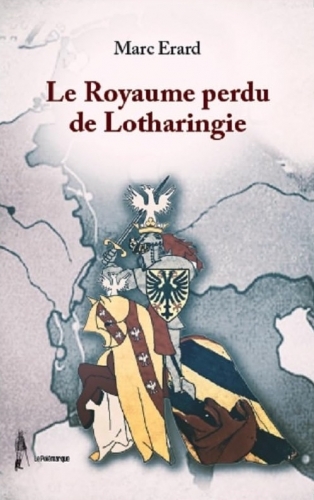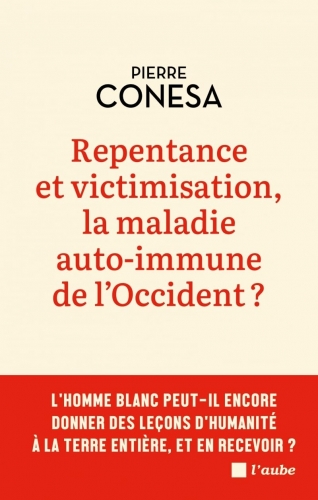Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien donné par Laurent Ozon à Alexis Poulin pour le Monde moderne, dans lequel il évoque le courant politique des néo-conservateurs, ses origines, ses figures clefs et ses choix stratégiques qui fondent aujourd'hui les lignes de fracture du débat politique dans le monde occidental et au-delà...