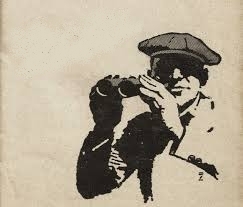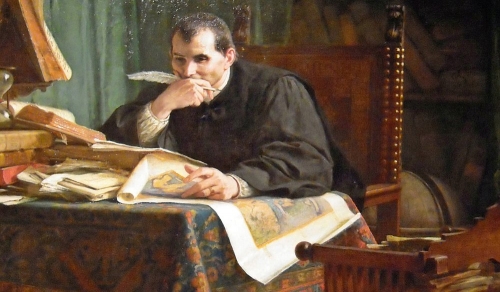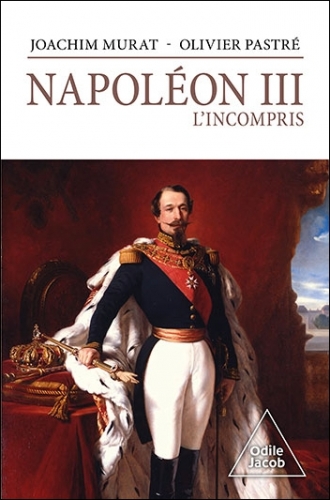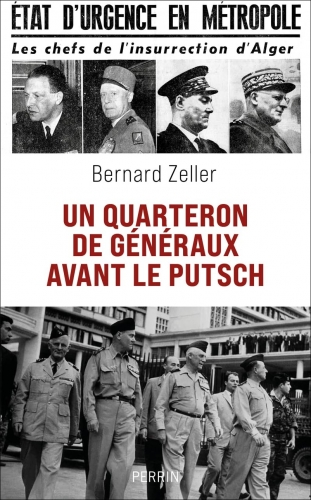Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Frank-Christian Hansel, cueilli sur le site d'Euro-Synergies, qui montre comment les concepts politiques influencent notre perception et ce qui se passe lorsque nous les remettons en question.
Frank-Christian Hansel, né en 1964, est membre de la Chambre des députés de Berlin pour l'AfD depuis 2016. Originaire de Hesse, il a étudié les sciences politiques, la philosophie et suivi des cours en études latino-américaines.

Le langage comme instrument de domination dans la post-démocratie
Avec les mesures qu'elle a prise contre ses détracteurs, l'ancienne ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a suscité plusieurs fois l'émoi au cours de ces derniers mois.
À l'ère de l'ordre discursif hégémonique et de l'interconnexion totale des médias, ce n'est plus la parole libre, mais la formule langagière contrôlée qui est le vecteur du pouvoir. Le langage n'est plus seulement le vecteur des pensées, il les façonne. Il ne régule pas ce qui est dit, mais ce qui peut être pensé. Celui qui domine les concepts domine aujourd'hui la réalité.
Une des clés de la déformation idéologique du débat politique réside dans la novlangue moderne, cette forme de langage manipulatrice anticipée par George Orwell dans 1984 et qui contrôle aujourd'hui, sous de nouveaux auspices, ce qui peut être dit en politique. Ce qui était autrefois un concept utilisé pour décrire le contrôle totalitaire du langage est aujourd'hui devenu le langage normal et invisible de nos dirigeants. Trois ensembles de concepts illustrent parfaitement ce phénomène :
« Haine et incitation à la haine »: le verrouillage sémantique de la liberté d'expression
L'expression « haine et incitation à la haine » fonctionne comme une condamnation de toute position divergente. Sa fonction n'est pas descriptive, mais exorcisante: elle bannit la divergence de l'espace légitime. Ce qui relevait autrefois de la liberté d'expression est aujourd'hui pathologisé et criminalisé par cette expression. La liberté d'expression subit ainsi un recodage silencieux: toutes les opinions ne sont plus protégées, mais seulement celles qui s'inscrivent dans la ligne officielle. Le pluralisme apparent masque une exclusion en profondeur des discours challengeurs.
« Notre démocratie » – la revendication morale de la propriété du politique
L'expression « notre démocratie » n'est pas une profession de foi inclusive, mais un marqueur identitaire exclusif. Quiconque s'oppose à « notre démocratie » – que ce soit en critiquant les institutions, les processus à l'oeuvre ou les acteurs de la scène politique – n'est pas considéré comme un démocrate en dissidence, mais comme un fasciste. Le démocratisme devient ainsi une idéologie autoritaire qui déclare que toute opposition politique est une dégénérescence morale. Il en résulte une délégitimation profonde du débat politique, au profit d'un consensus moralisateur qui ne tolère plus aucune alternative.
« Racisme » et question migratoire: l'obligation de silence au nom de la morale
Aujourd'hui, il ne s'agit plus de prôner la supériorité biologique, mais d'abord de remettre en question le statu quo en matière de politique migratoire. Le raciste est désormais celui qui pose des questions. L'antiraciste est celui qui croit. La migration, en tant que phénomène, est soustraite au débat rationnel et confiée à l'espace sacré de l'intangibilité. La dépolitisation d'un sujet politique par une charge morale est l'une des stratégies les plus efficaces du pouvoir postmoderne.
La remigration – l'antithèse sémantique de l'idéologie migratoire
Dans cet univers linguistique restreint, un terme fait irruption comme une bombe qui explose: le terme de "remigration". Cette expression n'est pas seulement un terme administratif et technique, mais constitue aussi une puissante contre-écriture face à l'ordre linguistique post-migratoire. Elle formule la possibilité d'un retour – non pas individuel, mais structurel – et viole ainsi le premier dogme du présent: que la migration ne connaît qu'un aller, jamais un retour.
La remigration est donc la contre-position métapolitique explicite que d'aucuns opposent au fondement du récit postnational. Antonio Gramsci y aurait vu une tentative d'établir de manière positive un nouveau concept d'hégémonie culturelle. Il marque l'altérité de l'ordre actuel. C'est pourquoi ce concept suscite des réactions si violentes. Il n'est pas réfuté de manière rationnelle, mais brûlé moralement – dans un rituel idéologique qui trouve son origine dans la crainte qu'il puisse devenir efficace. Son pouvoir n'est pas dans sa mise en œuvre immédiate, mais dans la remise en question de l'ensemble du cadre sémantique. Il rend dicible ce qui ne pouvait plus être pensé – et ouvre ainsi une brèche dans l'armure du consensus moralement intouchable. Dans cette interprétation, la remigration devient un code stratégique pour la souveraineté – territoriale, culturelle, linguistique.
Ces exemples le montrent clairement : le langage n'est pas un moyen de communication neutre, mais un instrument de domination épistémique. Ceux qui ne parlent pas comme l'exige le discours perdent leur légitimité en tant que citoyens, intellectuels ou êtres humains. Mais ceux qui comprennent le pouvoir du langage peuvent commencer à dépasser son ordre, à le transcender.
La tâche de la critique métapolitique ne consiste pas en une simple protestation, mais en la création de nouveaux concepts qui démasquent et transcendent l'ancien ordre. Le concept de « remigration » est un tel point de rupture. Le penser, c'est ramener l'impensable dans l'espace politique – comme un défi à une forme de domination qui croit pouvoir contrôler l'avenir par le truchement de concepts.
Frank-Christian Hansel (Euro-Synergies, 6 juin 2025)