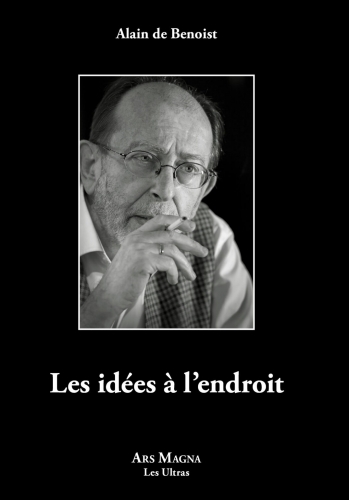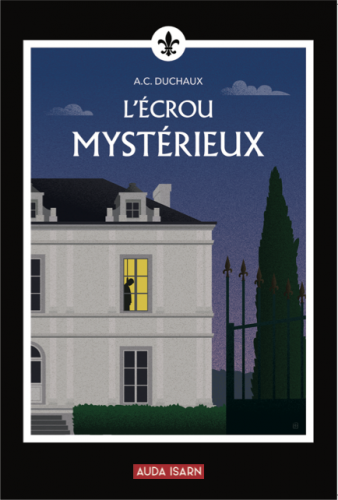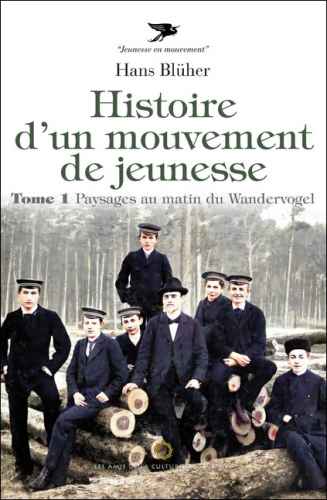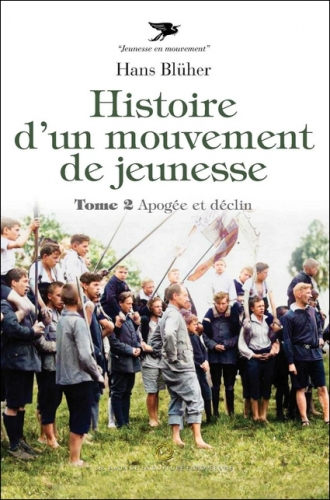Nous reproduisons ci-dessous un coup de gueule de Julien Dir, cueilli sur Breizh-Info et consacré au sectarisme écolo-gauchiste.

Canicule mentale : les écolos-gauchistes rêvent de notre disparition, mais s’indignent qu’on puisse mourir
On les voit, on les entend, on les subit. En boucle, depuis des années, les sirènes du climat hurlent dans nos oreilles : « Il fait chaud, on va tous mourir ! » après le « il fait froid, c’est un signe que ça se réchauffe et qu’on va tous mourir » et le « il pleut, c’est lié au réchauffement climatique on va tous mourir ». Les thermomètres s’affolent, les journalistes transpirent, les médecins de plateau paniquent, les écolos twittent en nage. C’est le réchauffement climatique, ma brave dame, l’Apocalypse éco-responsable. Fermez les volets, arrêtez les barbecues, coupez les moteurs thermiques et hydratez-vous — de l’eau du robinet, bien sûr, surtout pas un Coca dans une bouteille plastique, assassin de tortue marine. Encore moins de la climatisation dans les écoles, et si vous allez sous les 26 degrés dans les commerces, on envoie la police de l’écologie vous mettre à l’amende.
Mais permettez-moi une question simple : pourquoi diable ces gens s’émeuvent-ils autant à l’idée de la disparition de l’humanité, alors que c’est précisément ce qu’ils promeuvent toute l’année ?
Ils détestent l’homme, mais redoutent sa fin
C’est une contradiction aussi hilarante qu’abyssale : ces militants du néant, ces prédicateurs de l’extinction douce, geignent à l’idée que l’humanité puisse s’éteindre… alors même qu’ils passent leur vie à prôner son effacement. Car enfin, qui martèle à longueur de colonnes, de podcasts et de tribunes que faire des enfants est un acte écocidaire, que chaque naissance est un fardeau carbone, que l’avortement est un droit sacré, que le suicide assisté est un progrès, et que l’espèce humaine (enfin surtout l’homme blanc) est un virus sur la planète ?
Qui, sinon eux ?
Les mêmes qui célèbrent la stérilité comme un acte militant, la solitude comme une victoire, l’utérus comme un champ de bataille à neutraliser. Les mêmes qui transforment chaque revendication LGBT en nouveau modèle anthropologique, et qui considèrent le transhumanisme, la PMA pour toutes, l’auto-identification sexuelle et le polyamour asexué comme l’horizon d’une humanité enfin déconstruite.
Et les voilà, pourtant, à pleurnicher à l’idée que “la planète ne nous survivra pas”, comme si cela les attristait.
Le culte de Gaïa contre la vie
Ne vous y trompez pas : ce ne sont pas des défenseurs de la nature, ce sont des partisans d’un ordre moral totalitaire, masqué sous un vernis verdâtre. Ils n’aiment ni les arbres ni les animaux ; ils haïssent simplement les hommes — surtout ceux qui sont blancs, ont des enfants, un barbecue, un 4×4, et un avis divergent.
Leur écologie n’est pas une science, c’est une théologie punitive. Elle ne cherche pas à protéger la création, mais à justifier la destruction de notre civilisation. Il faut expier. Se taire. S’excuser d’exister. Et surtout, ne pas se reproduire.
Mais alors, qu’est-ce qui les dérange tant dans le réchauffement ? Si l’humanité est un fléau, ne devraient-ils pas se réjouir qu’une canicule en finisse avec quelques boomers climato-sceptiques ? Ne serait-ce pas là une épuration naturelle, dans leur logique ? Pourquoi cette panique, si l’effacement de l’espèce est leur Graal ?
Parce qu’au fond, ils ne veulent pas mourir. Ils veulent que vous, nous, les autres, mourions à leur place.
Le véritable réchauffement, ce n’est pas celui du climat, c’est celui du délire idéologique. La température des cerveaux a dépassé les 42° dans les bureaux de Bruxelles, dans les salles de rédaction, et sur les bancs de la gauche morale. C’est une canicule mentale, un incendie de la raison.
Ceux qui rêvent de mondes “dégenrés”, “décarbonés” et “posthumains” nous expliquent avec des trémolos dans la voix que la planète va mal parce qu’il y a encore des gens vivants dessus. Et ils s’affolent quand le thermomètre grimpe. Incohérence ? Non. Hypocrisie.
Oui, il fait chaud. Et alors ?
Le climat change ? Sans doute. Il a toujours changé. L’homme s’adapte — ou il disparaît. Mais il ne supplie pas Gaïa à genoux en récitant des mantras inclusifs.
L’avenir n’appartient pas aux sectaires suicidaires en tongs biodégradables. Il appartient aux peuples enracinés, féconds, conscients d’eux-mêmes et debout. Pas aux effacés de l’histoire qui célèbrent leur propre extinction entre deux shots de soja tiède.
Alors oui, il fait chaud. Qu’ils transpirent. Nous, on construit.
Julien Dir (Breizh-Info, 1er juillet 2025)