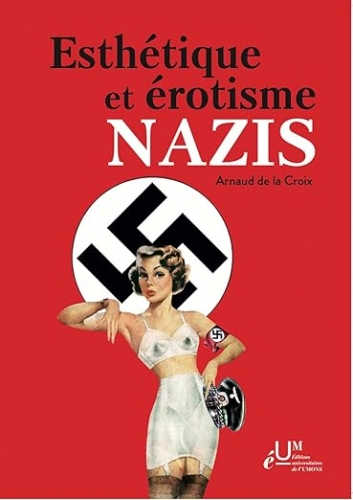Conflits armés et bases économiques : changer notre regard
On connaît l’importance de la base économique de la puissance. Mais plusieurs développements nouveaux conduisent à prendre du recul et à remettre en cause certains schémas établis. Notamment on a eu tendance à oublier que les facteurs économiques de puissance du temps de paix ne sont pas les mêmes en cas de conflit. Cela vaut notamment pour la vulnérabilité aux ruptures d’approvisionnement et embargos, ou pour la capacité industrielle – armement ou construction navale. Inversement la puissance financière ou la présence de multinationales s’avèrent alors moins décisives qu’en temps de paix. Et donc la position des différentes puissances n’est pas la même. Cela concerne en outre plus spécifiquement la France, qui est dans une situation assez différente de celle des autres pays européens.
La vulnérabilité aux ruptures d’approvisionnement et embargos
Déjà le Covid avait mis en évidence les graves problèmes que posait la dépendance d’une économie à l’égard du reste du monde, s’agissant notamment des matières premières et des chaînes mondiales de production. Une stratégie d’approvisionnement rationnelle dans un contexte de circulation assurée des biens peut se trouver mise en défaut si un obstacle intervient : une décision politique, un embargo, une priorité donnée par une puissance exportatrice à ses besoins internes, un nouvel antagonisme, une interruption physique des approvisionnements maritimes. Deux événements de la période récente rappellent cependant que les effets de ces ruptures peuvent être variables selon les cas : les sanctions contre la Russie d’un côté, les épreuves de force quelque peu chaotiques auxquelles se livre Donald Trump de l’autre.
Dans cette dernière affaire, les Etats-Unis de Trump ont pu mesurer plus que jamais leur degré élevé de dépendance industrielle à l’égard de la Chine. Les droits de douane envisagés touchent des flux considérables d’approvisionnements non remplaçables facilement. Et la Chine résiste à la pression, même si elle peut perdre des marchés importants. Cela s’ajoute à la question également bien connue des matières premières, notamment des minerais technologiquement vitaux. La conclusion qui s’en déduit des deux côtés est l’intérêt de réduire cette dépendance réciproque. Cela ne paraît pas insurmontable, au moins sur la durée.
En revanche, les sanctions contre la Russie n’ont pas été sans effet, mais pas ceux escomptés, et l’Europe (qui les a décidées) en a souffert elle aussi, tant sur le coût de l’énergie qu’en bradant l’énorme portefeuille d’entreprises qu’elle contrôlait en Russie. L’effet sur la Russie a été une massive réorientation de ses échanges, qui n’était certainement pas dans l’intérêt des Occidentaux. Il est vrai qu’elle a par nature une capacité d’autarcie importante, encore renforcée par le fait que c’est un des très rares pays à technologie militaire relativement complète et autonome – n’étant dépendante que pour certains composants et produits élaborés, qu’elle a pu en l’espèce trouver en bonne partie ailleurs (contrebande, Chine etc.). Quant aux sanctions financières, elles ont rencontré leurs limites, et en réalité minent la crédibilité du système financier global, contrôlé par les Occidentaux : si vous gelez les actifs que vous ont confiés quelqu’un, la confiance en vous diminue.
Ce que l’on voit dans ces exemples, c’est que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Les grands pays construits pour une relative autonomie comme Chine et Russie partent avec un avantage relatif. Ce pourra être à terme et à nouveau le cas d’autres qui ont quelque peu négligé ce souci, mais qui ont un considérable potentiel de résilience, comme les Etats-Unis. Les pays d’Europe, eux, en sont loin – même si la France se distingue par une certaine capacité d’autonomie, dans ses systèmes d’armement et potentiellement ses ressources maritimes. Très vulnérables sont en revanche d’autres pays, même de taille appréciable ; comme on l’a vu avec l’Iran, très affaibli par les embargos dans sa capacité de résilience – même s’il a résisté.
La capacité industrielle et la technologie
L’importance de la dimension industrielle et notamment de l’industrie d’armement avait été elle aussi un peu perdue de vue ; elle est revenue au premier plan avec la guerre d’Ukraine, énorme consommatrice de ressources, y compris sous la forme la plus simple (munitions). Ce qui suppose une industrie d’armement à très grosse capacité, permanente ou pouvant monter en régime très rapidement.
A vrai dire, l’histoire avait montré le rôle décisif de ce facteur industriel : la défaite de la marine impériale japonaise face aux Américains était dans une mesure importante la résultante de l’écrasante supériorité industrielle de ces derniers à l’époque, y compris dans la construction navale. Or la désindustrialisation galopante du monde occidental, y compris des Etats-Unis, change radicalement ces données, notamment face à la Chine : celle-ci est désormais bien plus puissante industriellement qu’eux, y compris dans la construction navale. Une éventuelle guerre à propos de Taiwan pourrait donc révéler des surprises : outre le fait que les Américains devraient opérer très loin de chez eux, ils risqueraient de ne pas tenir sur la durée et de se révéler moins puissants qu’on le croit habituellement. Ce à quoi s’ajoutent leurs difficultés à trouver des marins et le vieillissement de leur flotte. Certes, la marine chinoise n’a pas d’expérience de guerre, mais la japonaise n’en avait pas non plus lorsqu’elle a écrasé la marine russe à Tsushima ; et surtout elle peut supporter des pertes bien plus importantes en reconstituant ses forces. Le débat fait d’ailleurs rage aux Etats-Unis sur les moyens de reconstituer des chantiers navals moins étiques.
Un deuxième est la dimension technologique. Autant il est illusoire de ne compter que sur la technologie dans des conflits où le facteur humain reste crucial, autant elle a montré sa capacité à faire la différence sur des points essentiels, par exemple la couverture satellitaire pour surveiller les mouvements et guider les tirs de tout type. De même quand des technologies nouvelles changent en profondeur les modalités des affrontements ; elles peuvent d’ailleurs parfois être accessibles à des pays de développement moyen : ainsi les drones ont joué et jouent un rôle majeur en Ukraine, même développés en Iran ou en Turquie. Inversement, Israël a montré l’usage qui pouvait être fait de technologies de pointe dans sa lutte contre le Hezbollah et l’Iran. La guerre d’Ukraine a en outre bouleversé toute la problématique militaire, rendant partiellement obsolètes, en tout cas d’usage bien plus dosé, les instruments coûteux qui dominaient autrefois sans conteste (chars, avions, grands navires). Il ne suffit donc pas d’être avancé technologiquement, il faut aussi avoir un appareil de recherche et de production très mobile, et être en permanence sur les bons créneaux du moment.
Les transports maritimes enfin : on y pense moins, mais ils pourraient être à l’origine de crises, ou de mutations importantes, notamment d’un recul de la mondialisation. Jusqu’à la période récente la liberté de la navigation était très largement assurée, du fait notamment de la domination des Etats-Unis et de leur marine. La situation évolue, par un relatif désengagement des Américains, par développement d’alternatives à commencer par la Chine, et par la montée de menaces multiples, dont les Houthis donnent un avant-goût. La possibilité d’une réduction du transport maritime, par insécurité ou coût élevé, est concevable. D’où l’importance clef de la dimension navale, pour ceux qui peuvent se le permettre. La marine devrait justement être une priorité nationale majeure en France, compte tenu de l’immensité de son domaine maritime, étendu sur toute la planète.
Des facteurs surévalués en cas de conflit
Inversement, d’autres facteurs, importants voire décisifs en temps de paix, se voient fortement relativisés en cas de conflit latent ou ouvert.
Le premier est la puissance financière. Elle est évidemment appréciable : un conflit ouvert est effroyablement coûteux, et même une politique de défense ambitieuse ; les pays de la péninsule arabique n’auraient pas le poids qu’ils ont sans l’extraordinaire rente pétrolière dont ils disposent. Et la Chine n’aurait pu devenir la deuxième puissance militaire de la planète, et renforcer son influence à travers les « routes de la soie », sans son impressionnant succès industriel et technique. Ni les Etats-Unis maintenir leur rang sans le rôle du dollar et leur finance dominante, malgré un endettement pathologique et la désindustrialisation. Mais d’un autre côté, comme on l’a vu avec la Russie, l’arme des embargos financiers s’est avérée à double tranchant. Ajoutons qu’en cas de guerre ouverte les mécanismes financiers sont très gravement remis en cause : la finance n’est donc pas un puissant outil en cas de vrai conflit. Par ailleurs, la tendance récurrente à des crises financières est une faiblesse structurelle des sociétés occidentales ; avec éventuellement, à terme, une dislocation progressive d’outils devenus internationaux sous leur contrôle, comme le rôle du dollar, et la montée d’autres mécanismes, d’ailleurs amorcés déjà.
Le second facteur à relativiser est le rôle des acteurs non-étatiques, les entreprises multinationales. Leur puissance économique est réelle et n’est pas un fait nouveau. Les GAFAM structurent à leur façon la culture commune de la plupart des pays (hors Chine et Russie). Le même effet peut apparaître en matière d’Intelligence Artificielle, actuellement dominée par les Etats-Unis et dans une bonne mesure la Chine. Cela dit, il n’est pas évident que ces influences jouent en dehors du cadre des pays supports de ces sociétés (essentiellement Etats-Unis et Chine aujourd’hui, d’autres peut-être demain). Les multinationales sont vulnérables aux vraies puissances et notamment à leurs pays d’origine, comme on le voit avec Musk face à Trump. Le jeu de tels acteurs, important pour comprendre la problématique internationale actuelle, ne remet donc pas en cause le fait que le déterminant principal reste les rapports entre les puissances souveraines elles-mêmes.
Conclusion
Pays par pays, on tend plutôt à conclure sur ces différents plans que pour affronter un conflit un tant soit peu sérieux les Etats-Unis pourraient partir dans des conditions plutôt robustes, moyennant un important effort de redressement (qui peut être rendu difficile par leurs profondes divisions internes et leurs blocages, et le besoin d’agir sur la durée). La Russie probablement aussi sauf crise interne, mais sur un mode rustique et dans la dépendance de la Chine. La Chine enfin a une puissance industrielle dominante et n’est guère vulnérable que dans l’énergie et quelques matières premières et dans des techniques très avancées – dans lesquelles elle investit massivement pour les dominer ; même si elle peut aussi connaître des crises internes.
En revanche, l’Europe, très hétérogène, est beaucoup plus exposée, et le serait gravement en cas de conflit ouvert. Quant à la France, sa double spécificité dans l’armement et dans le domaine maritime la met à part des autres pays européens. Si elle a intérêt à coopérer avec eux, cette spécificité est trop forte pour qu’elle abandonne son autonomie dans une défense européenne prétendument intégrée, et en réalité à la fois molle, limitée au champ européen et incapable de prendre son autonomie à l’égard des Etats-Unis.
Quoiqu’il en soit, la diversité des situations paraît a priori considérable. Et donc la multipolarité à venir se révélera pleine de surprises …
Pierre de Lauzun (Geopragma, 14 juillet 2025)