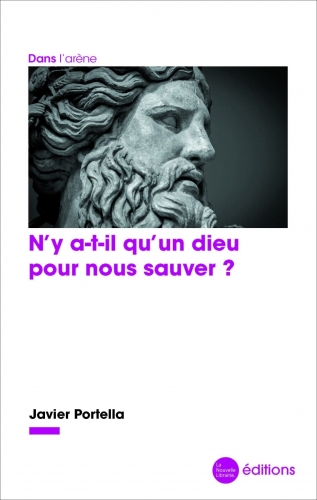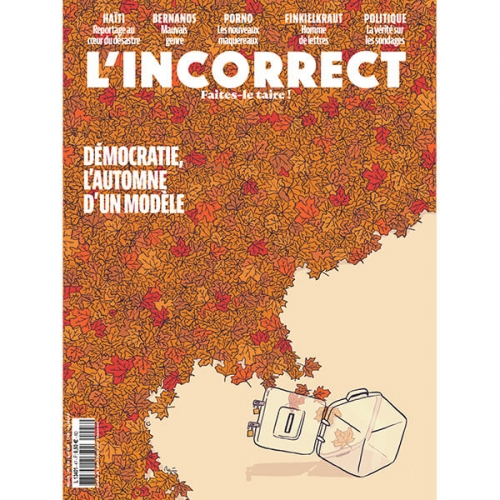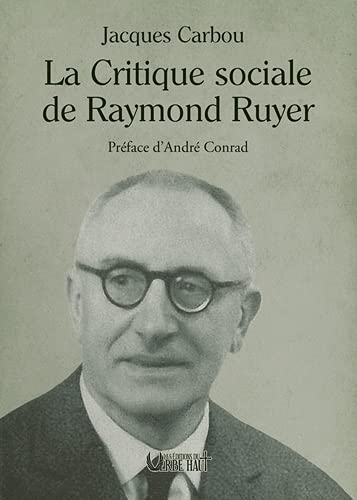La Chine a pris plusieurs décisions surprenantes au cours des derniers mois. Les jeunes de 18 ans ne peuvent désormais plus jouer plus de trois heures par semaine aux jeux vidéo en ligne (seulement de 20h à 21h, du vendredi au dimanche). Les moins de 16 ans ont l'interdiction de diffuser leurs parties vidéos en ligne. Les montants dépensés chaque mois dans ces jeux sont également plafonnés. Cette réglementation vient considérablement durcir des limitations mises en place en 2019. Autre annonce récente : le temps de présence sur l'appli TikTok, très populaire auprès des jeunes, est désormais limité à 40 minutes par jour.
On peut bien sûr s'indigner de ces mesures et les interpréter comme des exemples supplémentaires de l'autoritarisme du régime chinois. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Ces interdictions ne sont pas des mesures de contrôle politique, mais de santé publique et d'efficacité économique. Les motifs de ces interdictions sont clairement explicités : il s'agit de lutter contre «l'opium mental» que constituent les écrans pour les jeunes.
Les comportements addictifs liés aux écrans ne sont pas sans conséquence : baisse de la vision, de la mémoire et de la capacité d'attention, vie trop sédentaire, dépression et anxiété. Des inquiétudes corroborées par d'innombrables études, comme le rappelle Michel Desmurget, auteur du livre à succès La fabrique du crétin digital : «sur un cerveau en construction, on observe un impact majeur des écrans récréatifs sur le langage, la concentration, la mémoire, l'attention et la réussite scolaire. L'intelligence humaine étant intimement liée à nos capacités langagières, de mémoire et de concentration, il y a vraiment de quoi s'inquiéter».
Chacun sait que deux grands modèles politiques se livrent plus que jamais une lutte sourde : les démocraties libérales et les régimes autoritaires. Les premières refusent d'utiliser les mêmes outils que les seconds. Mais elles sont pourtant confrontées aux mêmes défis. Au XXIe siècle, le capitalisme industriel est devenu capitalisme cognitif ; le succès des pays dépend de l'abondance et la performance et cerveaux affûtés.
Un système scolaire d'excellence ne suffit pas : encore faut-il que les cerveaux ne soient pas abîmés par les écrans. Les dirigeants chinois ont jugé nécessaire de limiter le temps d'écran car ils estimaient qu'ils constituaient une menace, au fond, non seulement pour la santé des jeunes, mais à plus long terme pour la performance de leurs cerveaux. Or il n'y a aucune raison de penser que les écrans affectent moins la cognition des petits Français que celle des petits Chinois. Selon l'ANSES, les 11-24 ans passent plus de 26 heures par semaine devant les écrans en moyenne. Ce temps est pris aux dépens d'une activité physique qui se réduit à moins de 30 minutes par jour pour 45% des 11-14 ans.
La guerre des cerveaux fait rage, et elle détermine la puissance future des nations, mais nous regardons ailleurs. En Corée du Sud, c'est pour empêcher les enfants de travailler qu'il a fallu légiférer ! Le gouvernement a dû interdire les cours après 22 heures. Mais cette interdiction est contournée grâce aux vidéos en ligne dont le pic de connexions a lieu entre 23h et 1h du matin ! Un risque qui ne menace pas la France ...
Si nous devons nous inquiéter de l'usage qui est fait du «temps de cerveau disponible» (pour reprendre l'expression célèbre de Patrick Le Lay), ce n'est pas seulement parce qu'il porte en germe un affaiblissement face à des pays concentrés sur le développement de leurs performances cognitives ; le risque est aussi celui d'une aggravation des déterminismes sociaux. Les études ont montré depuis longtemps que les comportements dangereux pour la santé sont très significativement plus répandus dans les populations plus modestes. La pauvreté, autrement dit, est corrélée à la consommation de cigarette, d'alcool et à l'obésité. Les conséquences sur leur vie sont hélas mesurables : ils vivent moins longtemps et en moins bonne santé. L'écran fait partie de ces nouveaux comportements à risque. Le temps d'écran est supérieur de 40% chez les enfants de foyers modestes par rapport aux foyers aisés.
Les milieux aisés développent des stratégies élaborées de contrôle de ce temps pour leurs enfants. Elles permettent de tirer le meilleur de ces ressources nouvelles d'apprentissage et de formation au monde. Il faut prendre conscience que les milieux modestes n'ont pas ce savoir-faire. Tous les efforts de rattrapage des inégalités sociales faits durant le temps scolaire risquent fort d'être anéantis s'ils ne se doublent pas d'une action sur le temps d'écran. Il ne s'agit sans doute pas d'utiliser en France les méthodes chinoises ; mais il importe de réfléchir collectivement à la façon dont nous pouvons mieux protéger les enfants, en particulier ceux issus des milieux les plus modestes, du risque avéré lié à une fréquentation incontrôlée des écrans.
Olivier Babeau (Figaro Vox, 5 octobre 2021)