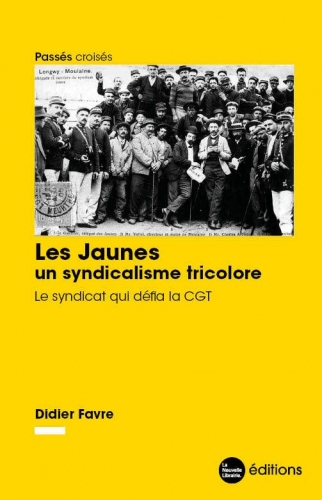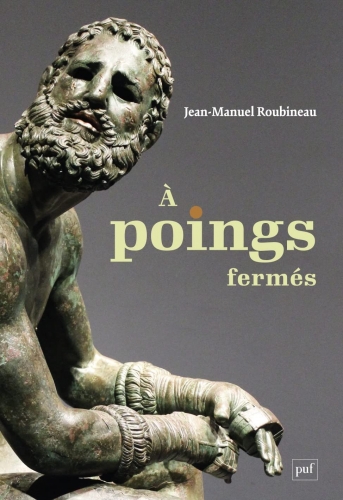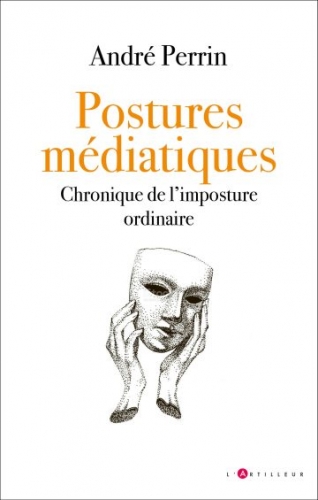« Déterritorialisation des terres » : l’expression est paradoxale. Et pourtant, c’est bien de cela dont il s’agit : des terres transformées en purs actifs financiers, échangées dans le monde entier par des sociétés anonymes dont les gérants ne les habiteront jamais ; des terres qui ne vaudront que comme placements ou sources de dividendes. Le phénomène est difficile à mesurer, car les statistiques disponibles ne le saisissent pas, mais il s’accélère massivement. Tentons un état des lieux.
Un état des lieux
En France, l’un des premiers signaux d’alerte s’est allumé en 2015, lorsque deux entreprises chinoises ont racheté 1 700 hectares de terres agricoles dans l’Indre. Le phénomène n’était pas complétement nouveau : on savait ces achats de terres massifs sur d’autres continents, et l’on avait déjà vu des vignobles passer dans des mains étrangères. Mais l’annonce a néanmoins fait l’effet d’une petite bombe – c’était là des champs de blé et d’orge. Un livre récemment paru, Hold-up sur la terre, montre que les acheteurs ne sont pas qu’étrangers : nombre de petites exploitations et de parcelles sont rachetées par des groupes industriels et des entreprises de la grande distribution, Fleury Michon ou Chanel. Les prix payés pour ces achats dépassent tout ce que les jeunes agriculteurs peuvent raisonnablement débourser pour s’installer. À petit feu, l’agriculture cesse d’être familiale, pour être confiée à des multinationales gestionnaires embauchant des travailleurs agricoles non propriétaires. Il est à craindre que la tendance s’accentue soudainement, car la moyenne d’âge chez les agriculteurs est élevée, et plus de 160 000 exploitations devront trouver un successeur dans les trois ans à venir. Enfin, dernière révélation récente : la terre intéresse aussi les très grandes fortunes. Aux États-Unis, le plus grand propriétaire de terres arables n’est autre que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui détient 97 000 hectares de champs répartis sur 18 États – et qui a bien du mal à expliquer publiquement les raisons de ces achats.
Le même mouvement touche aussi les forêts. Le bois bénéficie de la mode des énergies « vertes », mais ce n’est guère une bonne nouvelle pour la gestion des forêts, qui se voit industrialisée : des parcelles entières rasées et replantées avec une seule espèce – celle qui convient le mieux à la demande du marché. Là encore, un livre récent, Main basse sur nos forêts, tente d’alerter l’opinion. Et là aussi, la question des achats par l’étranger devient saillante. Plus de 30% du bois français partirait vers l’étranger avant d’être transformé, et notamment vers la Chine, dont les importations de chêne ont bondi de 42% sur un an (et de 66% pour les résineux).
Notons, pour clore brièvement le constat, que des tendances comparables touchent aussi le foncier urbain. Au Canada, dans des villes comme Toronto ou Vancouver, plus du tiers de l’immobilier serait possédé par des acteurs chinois. À New York, des débats intenses ont récemment eu lieu s’agissant de certains gratte-ciel autour de Central Park, qui passent de sociétés financières en sociétés financières, sans même être habités. De purs placements.
La rupture du lien à la terre
Le fait de pouvoir acheter des terres n’importe où dans le monde paraît normal à la plupart de nos contemporains. Cela ne choque la majorité, au mieux, que dans quelques cas extrêmes. Si l’on considère la longue durée historique, c’est pourtant quelque chose de tout à fait neuf.
Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire des institutions européennes, une distinction très nette est toujours établie entre les biens immobiliers et les biens mobiliers. Ces derniers, que l’on parle de troupeaux ou de monnaie, ont très tôt été l’objet d’échanges, y compris avec des étrangers. À l’inverse, c’est un pléonasme d’affirmer que le propre de l’immobilier, c’est d’être immobile. Contrairement aux biens meubles, les Européens se sont toujours représentés la terre comme quelque chose qui ne peut pas être liquide, échangeable avec n’importe qui. La terre n’est pas un simple bien matériel, c’est le lieu sur lequel se déploie l’existence d’une lignée ou d’une communauté. Ce fait se laisse voir par de multiples exemples. Ainsi, dans le monde antique, là où les biens mobiliers sont échangés sans formalisme abondant (selon un modèle propre aux transactions commerciales), l’échange de la terre était beaucoup plus rare et formalisé par des cérémonies de nature religieuse : en faisant passer la terre de mains en mains, on délogeait les divinités familiales qui y habitaient, et cela ne pouvait être un acte anodin. Depuis l’Antiquité et jusqu’à la Révolution de 1789, une pratique comme celle du retrait lignager évitait la dispersion du patrimoine des lignées, en permettant précisément de ramener un bien dans le lignage quand celui-ci devait être vendu. Quant à la qualité d’une terre, elle n’a longtemps pas été pensée comme quelque chose de purement objectif ou matériel. On pensait au contraire qu’une terre était meilleure si des lignées illustres y avaient résidé : toujours, la valeur de la terre était représentée comme intrinsèquement liée à l’identité de ceux qui y avaient vécu ou y vivaient toujours. Sous des formes diverses, ces grands traits se retrouvent, pour autant qu’on puisse les reconstituer, depuis les civilisations indo-européennes jusqu’à la fin du Moyen Âge, en passant évidemment par l’Antiquité grecque et latine et par le monde germanique.
La distinction très forte longtemps établie entre mobilier et immobilier avait un grand nombre de conséquences pour la structure de l’ordre social. Tout d’abord, la terre avait toujours une dimension politique. Elle était le bien des citoyens ou des membres de la communauté et n’était jamais cédée, ou presque, à des étrangers hors de la cité ou de la communauté. Pour cette raison, l’attachement à la terre était aussi le fondement du pouvoir – aussi bien à Rome que dans le monde féodal. Mais, et c’est ce qui est ici le plus important pour nous, le traitement spécial accordé à la propriété de la terre fut associé à tout un univers mental. La terre n’était pas un bien coupé des hommes, mais une chose à laquelle ils étaient intimement reliés. Elle était considérée comme ce qu’il y a de plus sûr (une perception qui demeure encore aujourd’hui en Europe, ce qui n’est pas le cas dans toutes les aires culturelles, où les biens considérés comme les plus sûr son parfois des meubles, comme les bijoux). Enfin, là où les biens mobiliers sont liquides, homogènes (rien n’est plus similaire à une pièce de monnaie qu’une autre pièce de monnaie), et peuvent être accumulés en théorie sans fin, l’immobilier est associé à l’image d’un monde profondément divers et borné. L’idée que l’on puisse accumuler sans fin des terres, considérées seulement pour leur superficie ou leurs qualités abstraites, est un non-sens dans le monde européen prémoderne.
On mesure donc la révolution que constituent les dynamiques actuelles d’accaparement, où les terres ne valent plus, aux yeux de ceux qui les achètent, comme lieux différenciés et habités d’une âme, mais comme source de profits, ou comme simples « actifs sûrs » pour l’investissement. Historiquement, ce bouleversement est le fruit de la Révolution française et du Code civil, qui ont fait triompher une conception purement individualiste et absolue de la propriété. L’accélération très récente de la concentration de la terre dans les mains de groupes internationaux est un fruit direct de l’amplification de la mondialisation – mais qui ne doit pas faire oublier ces causes plus anciennes. Dans le cas des terres agricoles, la rupture se manifeste nettement dans le fait que les parcelles ainsi achetées ne sont plus travaillées par des paysans attachés à un champ particulier, mais par des simples travailleurs agricoles, possiblement tout aussi mobiles que les capitaux qui les emploient.
Les périls de l’industrialisation
Si la « déterritorialisation de la terre » heurte notre sensibilité, elle est aussi porteuse de périls graves. Elle témoigne d’un rapport pathologique, purement utilitariste et court-termiste, à notre environnement. Car l’autre face de la marchandisation de la terre, c’est son industrialisation, sa gestion technique, comme une ressource distante, afin de maximiser la profitabilité immédiate du sol.
Les dangers sont particulièrement nets dans le cas des parcelles forestières, dont l’intérêt stratégique est depuis longtemps connu. Au XVIIe siècle, alors que la construction d’un navire peut nécessiter l’abattage de 4000 chênes centenaires, Colbert pense la politique forestière de la France à l’horizon d’un siècle au moins. Récemment, la Chine a fait de même, interdisant l’abattage de tout chêne dans le pays pour une durée de 99 ans. La Russie a suivi, en interdisant les exportations de bois. Alors qu’elle a longtemps été un modèle de gestion forestière, la France subit aujourd’hui de plein fouet les ravages de la marchandisation. La pression commerciale pousse à couper des arbres très anciens, à une vitesse qui ne permet plus leur renouvellement. L’absence de régulation stricte, qui se fonde sur l’illusion libérale selon laquelle rien n’est stratégique localement, car tout pourra toujours être acheté ailleurs, menace tôt ou tard certains de nos approvisionnements. Une part croissante de ces ressources stratégiques part à l’étranger alors que, dans un mouvement inverse, nombre de pays réduisent leurs exportations. À la faveur de discours industriels vantant la « biomasse » et l’« économie verte », les parcelles déboisées sont souvent replantées avec une espèce unique, poussant vite et qui permettent d’optimiser l’utilisation de l’espace. Les conséquences écologiques sont parfois désastreuses : gérée par des coupes franches de parcelles entières, la forêt perd en diversité, et cesse d’être un écosystème vivant pour devenir une plantation industrielle d’arbres. De tels maux sont particulièrement nets sur les terres achetées par des multinationales afin de « compenser » leurs émissions de carbone par des plantations d’arbres. Certaines de ces parcelles n’ont parfois plus rien de naturel, et deviennent paradoxalement des déserts biologiques.
Les périls d’une gestion trop distante planent aussi sur les terres agricoles. Gérées de manière industrielle, elles sont converties afin de produire les marchandises les plus échangeables internationalement. Dans le contexte actuel, les cultures destinées à la production de bio-carburants tiennent le haut du pavé, et raison notamment des subventions et du regard public favorable dont elles jouissent. Sur le temps long, le développement à grande échelle des bio-carburants est cependant un leurre. Tout d’abord, les terres étant limitées, leur exploitation à des fins énergétiques se fait au détriment de la production alimentaire – humaine ou animale – , de sorte que l’indépendance en ce domaine est remise en cause. Ensuite, ces activités, qui valent avant tout par la quantité de biomasse produite, sont particulièrement épuisantes pour les sols (il s’agit de planter de priorité ce qui pousse « beaucoup » et « vite ») et sont souvent très gourmandes en intrants. On voit poindre là un danger majeur : le jour où les biocarburants cesseront de bénéficier de subventions directes ou indirectes, l’intérêt des industriels s’en détournera, et l’on réalisera que des millions d’hectares de terres ont été appauvris par des politiques à trop court terme. Le sol est, lui aussi, une ressource épuisable et stratégique qu’il convient de gérer sur le temps long. La marchandisation des terres n’y participe guère.
Conclusion
Un pays dont le peuple n’est plus maître de ses terres est en danger : parce qu’il s’expose à des crises majeures mais aussi parce qu’il cesse d’habiter son environnement et de nouer avec lui des liens intimes. Des garde-fous ont longtemps existé, même à l’époque moderne, pourtant dominée par l’absolutisation du droit de propriété : les Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) pour réguler la vente des terres agricoles, et l’ONF (office national des forêts) pour gérer les forêts. Malheureusement, par manque de volonté politique, ces deux structures ont été laissées à l’abandon. Dans les deux cas, le tarissement des fonds publics a été compensé par un financement privé, qui a pour partie modifié la nature de ces organismes : financés par des prélèvements sur les ventes de terres agricoles, ou par les ventes de bois, ces institutions ont désormais, davantage que par le passé, intérêt à maximiser les transactions et l’exploitation industrielle des ressources… donc à accompagner le pillage des terres et le démantèlement du patrimoine commun. En miroir, de plus en plus de pays dans le monde nous montrent une autre voie : celle qui conduit à voir la terre comme une ressource d’intérêt national, qui ne peut pas être abandonnée au seul jeu de l’offre et de la demande mondiales.
Champs communs (Champs communs, septembre 2022)