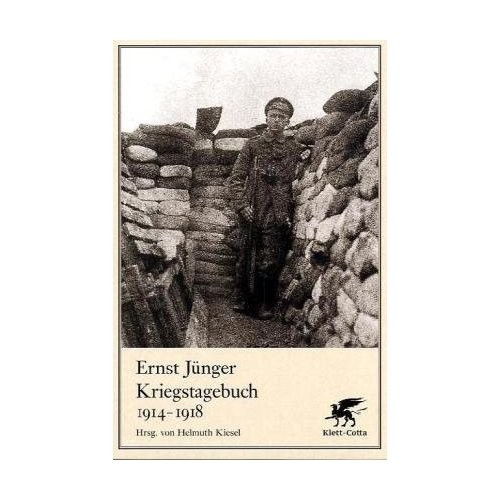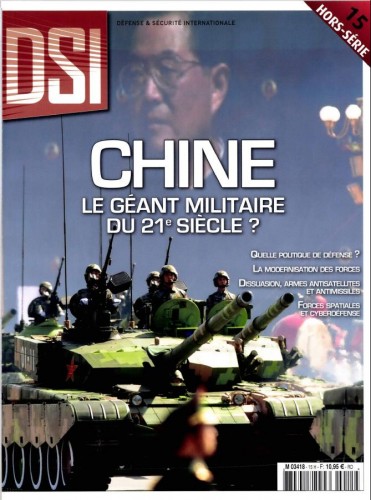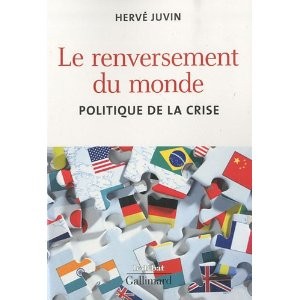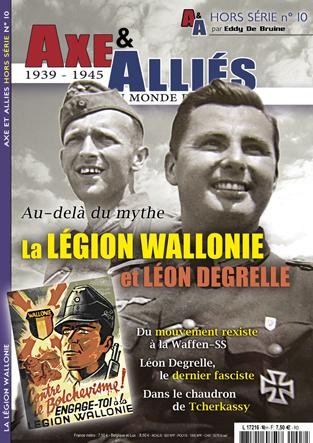Pour bien commencer l'année, nous ne pouvons que vous conseiller à nouveau la lecture du remarquable essai d'Hervé Juvin, Le renversement du monde (Gallimard, 2010), qui, selon Alain de Benoist, "n'est pas seulement une analyse perspicace de la crise financière actuelle, mais aussi une des analyses de la mondialisation les plus pénétrantes parues à ce jour".
Hervé Juvin, s'il dresse un tableau terrible de l'Europe d'aujourd'hui, n'en est pas pour autant un décliniste chagrin, tourné vers le bon vieux temps. C'est, au contraire un formidable professeur d'énergie. On rêve qu'un candidat (ou une candidate !...) à l'élection présidentielle de 2012 s'inspire de son livre et propose enfin aux Français un projet politique ambitieux...
Bref, il faut lire Juvin, et le faire lire !
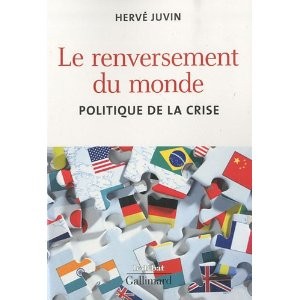
Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de son livre :
"L'exercice qui nous interroge depuis le monde qui vient nous appelle surtout à confesser notre identité, nous, Français, Européens, d'ici, de cette terre et des nôtres, moins comme origine que comme projet. Savons-nous ce que nous voulons être, représenter, incarner comme Français, comme Européens, et savons-nous comment et avec qui nous voulons le faire? L'idéologie individualiste ne nous apporte aucune réponse, pis, elle nous interdit de répondre. Le drame est que son aboutissement, la production du monde, la production des corps et de la vie, et la fin de l'histoire dans 1e triomphe de la volonté humaine, fait disparaître toutes les réponses possibles, les escamote plus encore qu'il ne les interdit en les reconduisant à des problèmes individuels: si vous vous sentez seuls, allez voir un psy! Le drame est que l'effort immense de dispense du réel et de sortie de l'histoire et de la géographie des Européens, engagé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, appelle un effort symétrique: aussi intense et aussi puissant, pour renouer les fils de l'honneur et de la fidélité des nations d'Europe à elles-mêmes. Vivre avec la crise appelle un immense travail de recontextualisation, c'est-à-dire un travail exactement inverse de celui auquel a procédé l'idéologie du marché, de la concurrence pure et parfaite, de la vérité des comptes, de la mise en conformité des décisions, de la contractualisation des relations. Réaliser la décolonisation de l'Union européenne contre l'entreprise mondialiste est le premier et l'immense travail politique qui vient. Travail de retour à l'histoire et à la géographie. Travail de situation de tout ce qui parle, affiche, publie, témoigne, influe: d'où vient-il, et de qui? Travail de survie., qui appelle le tour de garde de sentinelles éveillées : que chacun donne son mot de passe, que chacun dise quel est son nom, d'où il vient et de qui, qui le paie et pourquoi, nous n'avons plus le luxe de croire que les idées viennent de nulle part et que ceux qui parlent entendent seulement nous divertir. Travail de repérage, de mesure, de détection des cristaux que charrie la boue quotidienne de l'événement et de l'information. Travail de détection, de sélection et de discrimination, pour reconnaître les amis des ennemis et veiller aux portes. Travail d'arpenteur ou de géomètre, sans doute, travail de portraitiste, d'entomologiste ou d'herboriste surtout, travail de reconnaissance des écarts, de révélation du divers, d'invention du séparé, de découverte du particulier, là où la loi des comptes, des nombres, des modèles et des normes travaillait à réduire au même, à conformer au modèle, là où le droit, le marché et le contrat travaillaient à dispenser l'action et la relation humaines de tout contexte et de toute singularité, là où le nouveau conformisme autorise des entreprises à évaluer et noter leurs collaborateurs en fonction de leur appétit pour la diversité, c'est-à-dire de leur capacité à oublier les leurs, leur sang et leurs liens. Faudra-t-il parler d'art et de la capacité à enchanter ce qu'une étonnante conjuration de forces s'est employée à banaliser? Pour comprendre la crise, pour dépasser la crise, nous avons moins besoin de politiques que de photographes et de conteurs d'histoires, moins d'économistes que d'ethnologues et de philosophes, moins d'experts et de spécialistes que de passeurs et de curieux. Où sont les arpenteurs des champs du savoir et de la conscience qui se riaient des disciplines, des catégories et des appellations? Où sont ces trafiquants du savoir, journalistes un jour, ethnologues le lendemain, et romanciers de leur vie toujours, qui ont fait mieux que nous dire le monde, qui nous l'ont fait rêver ?"
"Affirmer ses fondamentaux est l'un des moyens de traverser la crise. L'épée des convictions seule peut trancher les contradictions du système. Au sortir espéré de la crise, les citoyens, les fidèles ou les croyants n'attendent qu'un seul discours: l'affirmation de ce qui ne changera pas; de ce qu'est la nation ou l'empire, sa mission, son projet, indépendamment des marchés, des changes, de la Chine et des subprimes. Parler de durée, de long terme, c'est commencer par énoncer clairement ce qui ne changera pas. C'est définir son identité et aller jusqu'au bout; définir ce que l'on est, c'est définir ce que l'on n'est pas, c'est exclure ce et ceux qui n'en seront pas, c'est circonscrire son action, son ambition, se reconnaître des limites, et c'est discriminer ce qui et ceux qui peuvent en être, qui en seront, par rapport à ceux qui n'en sont et n'en seront pas."
"L'ordre ancien a vu l'opposition des religions les unes contre les autres, des nations les unes contre les autres, des peuples les uns contre les autres. Le système nouveau est celui de l'opposition des peuples, des nations et des religions contre le mondialisme qui prétend les abolir, les réduire, les soumettre, et contre ceux qui prétendent diriger le monde vers son unité, au nom de leur élection prétendue ou de leur supériorité autoproc1amée. Et le système nouveau est celui qui organisera la coopération de peuples souverains, distincts, unis et divers. Ceux qui organisent dans l'ombre la conspiration des sachants, des experts et des banquiers, ceux qui exposent en plein jour leur projet de directoire mondial, planifient le chemin de la démocratie planétaire et se préparent au gouvernement universel, ceux-là sont les pires ennemis de tous les peuples, de tous les hommes de leur terre, de leur sang et de leur foi, de tous les rebelles, résistants et insurgés contre le bien unique, la conformité imposée et le métissage de rigueur. Ils savent que la frontière est la limite de l'autorité légitime et de l'action utile. Ils savent que la discrimination est la condition de tout projet de société consistant. Ils savent que la préférence des siens par rapport aux autres est le fondement de la liberté des uns et des autres à suivre leur voie et à approfondir leur unité interne. Ils savent par-dessus tout que la diversité des collectivités humaines est le seul véritable garant de la survie de l'humanité, et qu'elle résume à elle seule la condition politique. Ils connaissent leurs ennemis, et ils sauront sans trembler, sans frémir et sans remords le moment venu d'en finir."
Hervé Juvin, Le renversement du monde, Paris, Gallimard, 2010, 264p