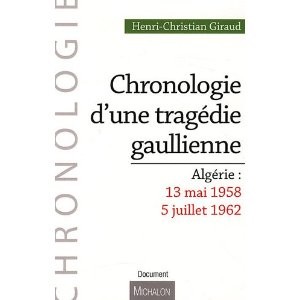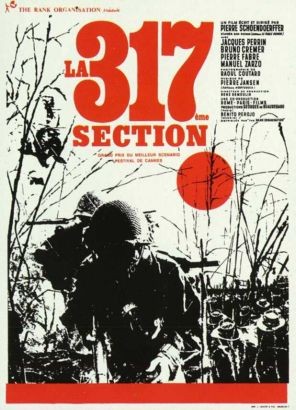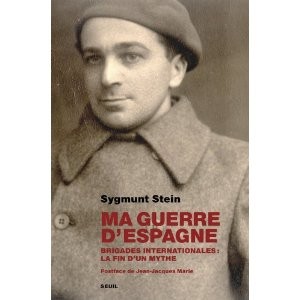Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Jean-Dominique Merchet, cueilli sur Ria Novosti et consacré à la capacité de notre pays à supporter la mort de ses soldats au combat. Directeur-adjoint de la rédaction de Marianne, responsable du blog Secret Défense, Jean-Dominique Merchet est l'auteur de nombreux ouvrages sur les questions militaires et collabore à la revue Guerres & Histoire.

Les grandes funérailles d'une poignée de morts
Samedi 9 juin 2012: quatre militaires français sont tués en Afghanistan. A peine la nouvelle connue, la Présidence de la République prend les choses en main et François Hollande annonce lui-même qu’un « hommage national » aura lieu cinq jours plus tard aux Invalides (Paris). N’est-ce pas un peu exagéré?
Certes, il s’agissait des « premiers morts » d’un chef de l’Etat tout récemment élu, qui ne fait que suivre l’exemple de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, d’ailleurs présent à la cérémonie religieuse, militaire et politique – qui s’est tenue avec toute la pompe dont un vieux pays comme la France est capable. Mais au-delà de l’émotion et des considérations politiques (la France était à la veille du second tour des élections législatives…), cette cérémonie pose des questions essentielles : quatre morts à la guerre sont-ils devenus à ce point hors du commun qu’il faille aussitôt déployer ce que le poète Charles Péguy nommait « l’appareil des grandes funérailles » ? Les démocraties modernes ne peuvent-elles plus supporter l’idée que leurs soldats meurent à la guerre ? Est-ce là le signe d’un affaiblissement politique qui minerait, à terme, la capacité de nos pays à peser sur les affaires du monde ?
Pour tenter d’y répondre, quelques chiffres et un peu d’histoire. En moins de onze ans de présence militaire en Afghanistan, l’armée française a perdu 87 hommes, dont certains par accident. Elle compte environ 700 blessés, dont plusieurs dizaines très grièvement, sans compter les blessures psychologiques, impossibles, pour l’heure, à estimer sérieusement. Sur la durée de la guerre, cela fait moins d’un mort toutes les six semaines… Certes, les opérations ne se sont vraiment durcies qu’à partir de 2008 et plus de la moitié des pertes ont eu lieu au cours des deux dernières années (45 sur 87). Sur cette seule période, on en reste quand même à un mort tous les seize jours.
La France est un pays qui a perdu 1,3 millions de ses soldats au cours de la Première guerre mondiale (1914-18), comme en témoignent les Monuments aux morts dans toutes les villes et villages du pays. C’est 900 hommes tués tous les jours pendant quatre ans ! Et que dire des pertes immenses de l’Armée soviétique durant la Grande Guerre Patriotique (1941-45) ? Si l’on estime les pertes démographiques totales de l’URSS à près de 27 millions, le général Alexandre Kiriline, qui s’en tient aux seuls militaires, avance le chiffre d’«environ 8,8 à 8,9 millions de personnes tués, dont 2,5 millions de prisonniers de guerre et 6,4 millions de tués sur le champ de bataille ». Soit 4500 tués chaque jour au Front pendant quatre ans ! Ces chiffres donnent littéralement le vertige.
Toutes les guerres ne donnent pas lieu à de tels massacres : au Vietnam, les Américains ont perdu 58.000 hommes et les Français en Algérie (1954-1962) environ 25.000, dont 15.000 au combat. Soit, quand même, douze quotidiennement. Un jour de la guerre d’Algérie équivaut donc à un semestre en Afghanistan : où étaient alors les hommages nationaux et les interventions solennelles du président de la République ?
Nos sociétés ont-elles si radicalement changées en un demi-siècle ? Le colonel Michel Goya, chercheur à l’Ecole militaire, considère que « la résilience politique aux pertes est de plus en plus faible », mais il la distingue de « celle de l’ensemble de la nation, en général plus forte ». La classe dirigeante, politique et médiatique, encaisse donc plus mal les morts à la guerre que le pays dans ses profondeurs, qui sait bien, notamment pour en avoir payé de longue date le prix fort, qu’il n’y a pas de guerre sans mort ! L’on voit, certes, quelques familles de soldats tués s’en prendre à l’armée devant la justice, mais ce n’est là qu’une façon moderne, pour elles, de tenter de faire leur deuil avec l’aide intéressée de quelques avocats médiatiques.
Deux choses essentielles ont pourtant changé la donne. Depuis 50 ans, c’est-à-dire la fin de la guerre d’Algérie, aucun jeune Français n’a été obligé de partir à la guerre. Depuis cette date, seuls les volontaires et les professionnels se battent et risquent leur vie. Autre nouveauté, tout aussi radicale au regard de l’histoire française : depuis 20 ans, plus aucune armée étrangère ne menace le territoire national, alors que depuis la Révolution française (Valmy, 1792), la Nation vivait dans l’idée d’une invasion possible en provenance de l’Est. Et l’on pourrait remonter jusqu’à Attila, battu en 451, aux Champs catalauniques, là où l’on se battait encore en 1918…
Depuis 20 ans, donc, les militaires français sont envoyés combattre loin des frontières du pays (Guerre du Golfe, Balkans, Afrique, Afghanistan, Libye). D’où la gêne des politiques : ces guerres sont-elles suffisamment légitimes, même si elles sont légales au regard du droit international, pour que de jeunes Français y perdent la vie ? Dans le cas de l’Afghanistan, l’opinion publique en doute fortement. Tous les sondages traduisent le fait que les Français ne souhaitent pas la poursuite de cette guerre. Nicolas Sarkozy puis François Hollande l’avaient d’ailleurs parfaitement compris en accélérant le calendrier de retrait des troupes, l’un d’un an, l’autre de deux.
« Pour qui meurt-on ? » se demandait en 1999, le général français Emmanuel de Richoufftz dans un livre de réflexion sur le sens de la guerre. En effet ! C’est la question que se posent les citoyens – dont les militaires - et c’est aux dirigeants politiques, visiblement embarrassés, de leur fournir une réponse. Pourquoi nos soldats tombent-ils en Afghanistan ? Les réponses fournies ne sont guère plus convaincantes que celles qui l’étaient, aux Soviétiques, au temps de leur intervention en Afghanistan. Certes, la guerre d’alors fut beaucoup plus meurtrière et les Afghantsy n’étaient pas tous volontaires ! En dix ans, l’armée soviétique a perdu (au moins) 15 400 hommes sur le terrain. En une décennie également, la coalition occidentale en aura perdu, elle, 3050, soit cinq fois moins.
Pour quel résultat ? C’est parce que les dirigeants d’aujourd’hui, et notamment les Français, gauche et droite confondues, peinent à répondre sur le fond qu’ils en font sans doute un peu trop sur la forme. D’où « l’appareil des grandes funérailles » déployé dans la cour, grandiose et austère, des Invalides.
Jean-Dominique Merchet (Ria Novosti, 19 juin 2012)