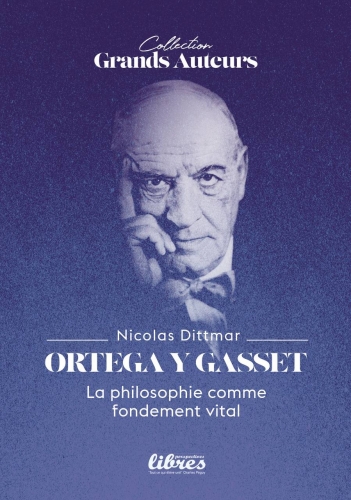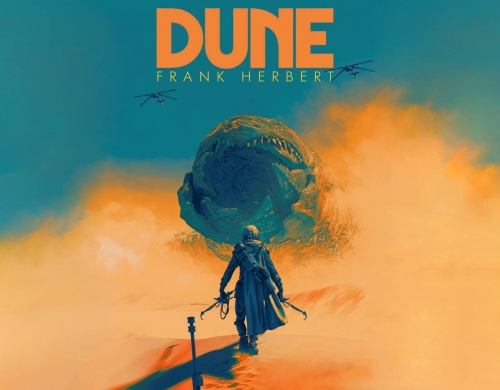Quentin : un meurtre politique qui fera tomber Mélenchon ?
Trois jours après le sauvage assassinat de Quentin Deranque, mort sous les coups des descendants de ceux qui, de 1789 à 1944 (1) en passant par 1917, ont toujours fait payer le prix du sang à leurs adversaires, on a comme un goût amer dans la bouche. Les nervis trotsko-antiracistes entraînés au combat depuis des lustres afin de permettre à Mélenchon de prendre le pouvoir doivent être fiers d’eux, mais ils ont longtemps couru avant que des arrestations tardives n’aient lieu alors même que le procureur de Lyon a conclu à un « meurtre par préméditation ». Les meurtriers auteurs de la mort du jeune catholique identitaire ont ainsi eu le temps d’effacer les traces de leur crime. Souvenons-nous du terroriste italien Cesare Battisti protégé pendant plus de quatorze ans par François Mitterrand et porté au pinacle par toute notre Intelligentsia bien que condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et complicité d’assassinat de quatre personnes.
Paroles, Paroles…
La belle cérémonie d’hommage organisée par ses camarades devant la Sorbonne a permis à la famille nationale — on notait cependant l’absence de Jordan Bardella, même si de nombreux élus de RN avaient répondu présents comme Philippe Olivier ou Marie-Caroline Le Pen — de se retrouver et même, rêvons un peu, d’arrêter peut-être de se chamailler alors que le pays menace ruine.
Mais quel gâchis pour une maudite banderole brandie par six jeunes femmes qui protestaient contre la prise de parole de Rima Hassan, élue député européen, comme le fiché S Raphael Arnault est élu député national. Certes, une grande partie de la classe politique – LFI comprise — a condamné les faits survenus le jeudi 12 février au soir. Les socialistes ont cependant attendu le lundi matin pour réagir et manifester leur émotion et la plupart ont versé les larmes de crocodile – Emmanuel Macron le premier qui dénonçait un « déferlement de violence inouïe et rajoutait un grain de sel républicain en précisant « qu’en République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue ». Visiblement, il ne connaît pas son histoire de France et, en particulier, Robespierre, Marat et autres grands démocrates devant l’Eternel qui ont fait régner la Terreur en 1793.
On a entendu pour la première fois le ministre de l’Intérieur affirmer que « manifestement, c’est l’ultragauche qui était à la manœuvre » pendant que Gérald Darmanin élu en 2024 grâce aux voix de cette ultra-gauche, accusait la même « ultra-gauche d’avoir tué ». Pour sa part, Raphaël Gluksmann, petit-fils d’un stalinien agent du Komintern, jure ses grands dieux qu’il est « impensable que la Gauche cultive le moindre doute sur une possible alliance avec la France insoumise ».
Gabriel Attal, qui avait appelé à voter LFI aux dernières Législatives pour faire barrage au Rassemblement national, s’est même engagé à ne plus recommencer…. Mais on sait depuis longtemps que les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. Et ne parlons pas de la porte-parole du gouvernement Maud Brégeon qui, d’ordinaire plus accommodante avec LFI, dénonce sa « responsabilité morale » en l’accusant d’encourager « un climat de violence ». Autant de responsables politiques qui avaient composé avec le Nouveau Front Populaire en 2024, mais semblent l’avoir oublié. A moins que le conflit israélo-palestinien et les attaques régulières de Tsahal dans la Bande de Gaza n’aient modifié la donne politique.
Mélenchon nouvel ennemi public ?
Depuis quelques temps, Mélenchon a visiblement cessé de plaire et un certain cordon sanitaire semble se mettre en place à deux ans de la Présidentielle. Comme un remake de l’opération Chirac qui avant l’élection de 35 députés à l’Assemblée nationale, avait pris l’engagement avec le B’nai B’rith, de ne jamais faire alliance avec le diable de Montretout. On connaît la suite. S’agissant de Mélenchon l’affaire est plus subtile et le président de la République ne sait comment jeter l’anathème sur un responsable politique qui a misé sur ses masses électorales musulmanes afin d’avoir un électorat à sa botte et de promouvoir son amour pour une France métissée et créolisée. Mais le pouvoir macroniste a enfourché le cheval de l’antisémitisme comme le prouve le récent discours de Macron lors de l’hommage rendu à la mémoire d’Ilan Halimi, torturé et mis à mort par le « gang des barbares » dirigé par Fofana Fofana. Confondant allégrement antisémitisme, antijudaïsme et antisionisme, Macron a dénoncé « l’antisémitisme d’extrême-gauche qui veut substituer à la lutte des classes une supposée lutte des races, et qui le dispute à l’antisémitisme d’extrême-droite, avec ses clichés sur la puissance et les richesses ».
Toujours dans le même ordre d’idées, Macron a succombé au charme de la députée des Français de l’étranger Caroline Yadan qui fustige LFI, dénonce sa complaisance avec l’islamisme et son antisémitisme et son ancrage avec la gauche radicale. Et c’est le même député qui s’apprête à faire fait voter une loi complémentaire à la loi Pleven/Gayssot que les députés du Rassemblement national se sont empressés d’adopter en commission alors qu’elle constitue un frein à la liberté d’expression et que Macron souhaite rendre inéligible tout élu ou même candidat tenant des propos racistes, antisémites ou prétendus tels. (2) On pourrait également croire que Macron fait tout pour ne pas permettre à Mélenchon d’être qualifié pour le second tour de la Présidentielle face au Rassemblement national. Le candidat du centre mou serait alors élu face à Bardella ou Le Pen.
L’inversion accusatoire
Face aux attaques venues de toutes parts après la mort de Quentin, Jean-Luc Mélenchon et ses comparses ne manquent pas de culot en déplorant de ne bénéficier ni de la « protection de la police » ni de la « justice » en se plaçant dans une posture victimaire sous prétexte que plusieurs permanences parlementaires LFI ont été dégradées depuis le lynchage de Quentin, allant jusqu’à oser dire qu’ils « sont attaqués réunion après réunion » et que LFI est « opposée à la violence ». « LFI n’a rien à voir avec cette histoire et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs » a-t-il prétendu.
Rompu depuis des décennies à la dialectique marxiste, le patron de la France insoumise a, comme le dit son ex-camarade Thomas Guénolé, « depuis longtemps théorisé la méthode du « moteur à explosion » : « pour attirer l’attention, il attaque frontalement un groupe d’intérêt, un adversaire politique, vise le journaliste qui l’interviewe et, une fois l’attention obtenue, il dévoile son message politique ». Et ses affidés font de même avec moins de brio comme, par exemple, Mathilde Panot ou Manuel Bompard qui, feignant de pleurer sur Quentin, imputait sa mort aux… « fascistes » !
La Jeune Garde ne se rend pas, elle se métamorphose
Depuis 2018, cette milice créée par Raphael Archenault — vrai nom de Raphael Arnault — tient d’abord le pavé lyonnais avant de poser ses valises à Paris, Nantes, Lille ou Strasbourg. Calquée sur le fonctionnement des Blacks Blocs ou des Soulèvements de la Terre, l’organisation terrorise tout ce qui ne lui convient pas et en particulier les militants identitaires. Chasses à l’homme, descentes dans des appartements privés, intimidation verbale et physique, tout est bon pour Raf-Raf qui a retenu l’attention de Mélenchon au point que ce dernier lui a proposé une place éligible aux dernières Législatives faisant ainsi élire le premier Fiché S siégeant au Palais-Bourbon bien qu’il se conduise comme un véritable tyran avec ses camarades et ait été condamné notamment en 2022 pour violences en réunion.
Au fil des années, La Jeune Garde est devenue une sorte de service d’ordre de LFI au point que Mélenchon lui-même n’a cessé de vanter « cette organisation liée au mouvement insoumis », portant aux nues « ses jeunes camarades » qui « protègent nos cortèges quand on vient nous taper dessus ».
Ils ont d’ailleurs tellement tapé que Bruno Retailleau décidait en 2025 de dissoudre l’association, qui déposait aussitôt un recours devant le Conseil d’Etat et recevait l’appui de La Ligue des Droits de L’Homme et du GISTI, défenseur acharné des immigrés passé maître dans l’art de récupérer des subventions (3). Mais il ne sert à rien de réclamer sa dissolution. En 1973, par exemple, Raymond Marcellin, alors ministre de l’Intérieur sous Pompidou avait dissout d’un seul coup d’un seul Ordre Nouveau et la LCR de Krivine (4). La même symétrie étant toujours respectée sous les présidences suivantes, il n’est jamais bon d’aller hurler avec les loups et de jouer les supplétifs de la Place Beauvau.
Les responsables de La Jeune Garde affirment avoir cessé toute activité, ce qui est malheureusement démenti par la mort atroce de Quentin. On attend avec impatience la décision du Conseil d’Etat. Mais Raphael Arnault et ses camarades ont déjà déposé de nouveaux statuts afin de donner naissance à un nouveau truc destinés à faire la chasse aux vilains identitaires et assimilés. Son nom ? Eteignons la Flamme. Dans l’esprit de Ras le Front qui menait la chasse à tout ce qui, de près ou de loin, s’apparentait à Jean-Marie Le Pen et au Front National, cette nouvelle association montre la détermination des antifas. Et ce n’est pas en changeant de nom comme l’a fait Marine Le Pen en transformant le Front national en Rassemblement, que Mélenchon cessera ses combats et ses anathèmes. Comme le disait Jean-Yves Camus, dans un entretien accordé au site Atlantico en juin 2025 : « Pour les antifas, l’extrême-droite est une maladie qu’il faut extirper de la société pour pouvoir s’en débarrasser. Ils veulent l’écraser. Ils peuvent passer par des actions physiques qu’ils justifient moralement et politiquement, l’extrême droite étant selon eux un affront à la morale et au droit en soi ».
À méditer après le drame que nous venons de vivre.
Françoise Monestier (Polémia, 18 février 2026)
Notes :
(1) En 1944 les communistes exploitèrent l’épuration sauvage (au moins 25 000 morts) non seulement contre des collaborateurs mais aussi contre de simples adversaires politiques susceptibles de s’opposer à leurs visées.
(2) Depuis 1972 près de 200 dispositifs liberticides ont été adoptés faisant de la France le pays du goulag mental. Peut-on sérieusement penser que cela a améliorer la situation et faciliter l’assimilation. Polémia va prochainement faire l’inventaire de ces dispositions
(3) C’est Nicolas qui paie les recours du GISTI et de la LDH en faveur de la Jeune GARDE :
-plus de 700000 € de subventions publiques pour la LDH en 2024 –
-plus de 70000 € pour le GISTI et plus de 200000 € provenant d’associations privées elles même subventionnées.
On trouve la ville de Paris, Matignon, l’agence nationale de cohésion des territoires (sic), le CNL, le FONJEP sans oublier la MACIF (source GROK à partir des rapports d’activités)
(4) Ordre Nouveau avait organisé au Palais des sports un meeting « contre l’immigration sauvage ». Il avait été attaqué, avec la complaisance de la police, par les nervis de la LCR (ligue communiste révolutionnaire). Les deux organisations avaient ensuite été dissoutes.