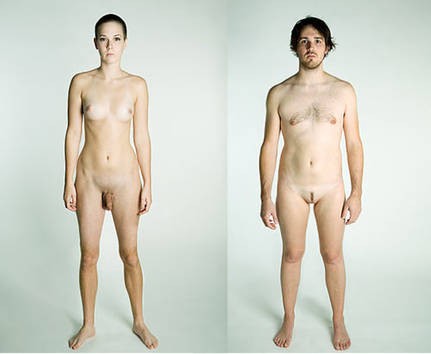Vous pouvez lire ci-dessous un texte stimulant cueilli sur le blog A moy que chault ! et consacré à la décroissance...

Aujourd'hui, la décroissance
La croissance et son culte constituent désormais la seule religion occidentale quasi-unanimement partagée. A l'inverse du catholicisme, jamais elle ne s'est si bien portée ni n'a compté autant d'adeptes. De l'extrême-droite à l'extrême-gauche, personne ne remet en cause le dogme sacré sous peine d'être exclu du cercle des « gens sérieux ». Le débat se borne donc aux choix des méthodes pour atteindre ce graal productif puis aux modalités de redistribution et de partage de ses mirifiques bienfaits. Toute pensée véritablement révolutionnaire est donc exclue de facto puisque les oppositions et confrontations se font exclusivement dans le cadre d'une même pensée et d'un même horizon indépassable. Hors la croissance, point de salut !
Sans celle-ci, il n'y aurait pas de bonheur possible pour les nations. C'est l'accroissement productiviste et l'accumulation des biens qui mèneraient à la grandeur des Etats et à la prospérité des populations. Il n'y a pourtant qu'à voir dans quel état de décrépitude physique et morale se trouvent les européens après à peine trois siècles de ce régime de « croissance » pour s'interroger sur l'infaillibilité de ce présupposé qu'on nous rabâche comme s'il s'agissait d'une vérité révélée. Ou encore de regarder du côté de la Chine qui fait fantasmer et saliver d'envie les économistes de tous poils avec sa croissance à deux chiffres mais qui est en train d'empoisonner son sol et ses eaux, de détruire ses structures ancestrales, de perdre son identité et de vendre son âme au profit d'une pâle imitation occidentaliste !
Mais le dogme se défend bien, toute personne osant le remettre en cause – ou même simplement l'interroger- étant immédiatement mis au ban de la communauté, interdit de médias et fermement ghettoïsé.
La décroissance. Aucune pensée politique – à l'exception du fascisme – suscite des réactions aussi virulentes, aussi violentes, des dénonciations et des condamnations aussi radicales, simplistes et définitives, venants de tous les horizons du système... Peu de personnalités sont autant moquées, calomniées, caricaturées et hystériquement dénoncées que celles qui tentent de défendre et de promouvoir cette idée de « décroissance », c'est à dire de changement radical de paradigme sociétal. « Hippies, rétrogrades, obscurantistes, allumés, khmers verts, écolo-fascistes, utopistes, beatniks, doux dingues, réacs... » tous les anathèmes sont bons pour discréditer sans débat cette pensée véritablement iconoclaste qui sape le fondement même du règne de la quantité et du pognon.
On voudrait faire passer la décroissance pour une volonté de « retour à la bougie et à la traction animale », bref pour un passéisme. C'est au contraire une pensée innovante refusant le formatage du monde par le seul imaginaire capitaliste. La décroissance ce n'est pas refuser la technologie, c'est combattre le primat de la Technique, ce n'est pas refuser les innovations, c'est faire le tri entre elles, ne pas considérer qu'une nouveauté est bonne « par nature » et écarter celles dont les conséquences sont néfastes, ce n'est pas déifier ni sacraliser la nature, c'est avoir conscience de notre interdépendance avec l'environnement et défendre le patrimoine biologico-écologique des générations futures, ce n'est pas refuser le confort, c'est rejeter le superflu, ce n'est pas souhaiter la pauvreté mais la sobriété, ce n'est pas idéaliser « antan », c'est se nourrir de notre plus longue mémoire pour privilégier le temps long et la stabilité sur le zapping et le bougisme...
A titre d'exemple, l'agriculture biologique est une démarche de type décroissante, puisqu'elle réduit les rendements et la productivité. Il n'en reste pas moins qu'en permettant d'obtenir des fruits et légumes plus sains et goûteux et en assurant la prolongation de la fertilité des sols, elle représente un « progrès ». Pas pour l'industrie agro-alimentaire certes, mais pour l'homme oui. Dans un autre domaine, se passer de télévision – c'est à dire d'une lobotomie quotidienne – est-il un recul ou un progrès ? Poser la question, c'est y répondre.
On nous rétorquera que la « décroissance » est antinomique de la « puissance » d'un Etat ou d'un peuple. Pour cela il faut déjà raisonner en termes géopolitiques alors que l'on peut penser qu'on est aujourd'hui plutôt au stade de la simple survie. Mais même en admettant cette dialectique, encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'est la puissance. La santé, mentale et physique, d'un peuple, sa démographie, ses arts et lettres, sa conscience nationale, son aptitude à produire du sens ne sont-ils pas des éléments fondamentaux de la puissance ? Or ces domaines ont été totalement sacrifiés, saccagés, par la société de la croissance, du primat de la pensée matérialiste et productiviste.
Par ailleurs, que nous importent que la France, l'Italie ou l'Europe soient « puissantes », s'il n'y a plus de français, d'italiens et d'européens ? Si ces « entités administratives » ne sont plus peuplées que de zombies consuméristes, des clones hyperconnectés et réduits à leurs seules fonctions de production et de consommation, accrocs aux shopping, bourrés de médicaments, des non-êtres interchangeables ne levant la tête de leur Iphone que pour se traîner devant un quelconque écran de télé ou d'ordinateur pour y ingurgiter du porno et des séries américaines ? Nous y sommes déjà presque...
Alors répétons-le, aucun changement économico-politique majeur ne pourra avoir lieu tant que l'on ne sera pas sorti de cette vénération de la croissance qui représente une aliénation totale du monde à l'imaginaire de la technique et de l'avoir.
(A moy que chault ! , 15 août 2013)