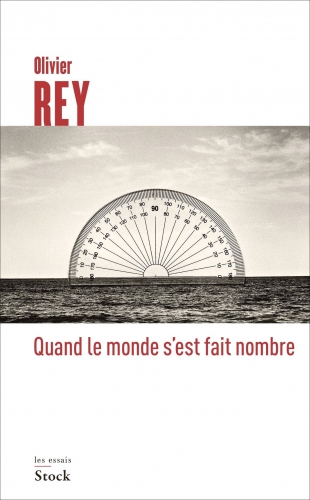Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michel Lhomme, cueilli sur Metamag et consacré au travail de sape des progressistes pour imposer la PMA et la GPA en France, et en Europe...
Pma, Gpa : des “droits de”… à des “droits a”… ou la logique des progressistes
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné cinq fois la France pour « violation du droit au respect de la vie privée et familiale résultant du refus de reconnaissance des actes de naissance » c’est-à-dire en clair pour des enfants nés à l’étranger de mères porteuses (GPA – Gestion pour Autrui) suite à l’interdiction de la gestation pour autrui dans notre pays.
La transcription des actes de naissance d’enfants français nés à l’étranger étant de la compétence du service central d’état civil, installé à Nantes, le parquet de Nantes est chargé du contrôle de ces demandes de transcription. L’autorisation de la GPA n’est en réalité qu’une question de mois ,d’ailleurs les jeunes dans leur ensemble y sont aussi largement favorables. Il faut d’ailleurs une PMA ( Procréation Médicalement Assistée ) pour aboutir à une GPA. Sous l’angle de la filiation, on ne peut séparer PMA et GPA, car c’est un ensemble.
Après le mariage pour tous, PMA et GPA sont d’ailleurs les dernières grandes revendications des militants gays et à base de surenchère, ils cherchent à mobiliser le gouvernement sur un calendrier législatif précis. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a déjà rendu son avis positif sur la PMA (procréation médicalement assistée) concernant notamment les couples de femmes.
La PMA, qui désigne l’ensemble des techniques médicales destinées à aider les couples infertiles à avoir un enfant, telles que la fécondation in vitro ou le don de sperme, était jusqu’alors interdite en France aux mères célibataires et aux couples lesbiens. Un groupe de travail du Comité d’éthique avait planché sur cette question pendant deux ans pour rendre en juin son avis favorable. Emmanuel Macron s’était prononcé, durant la campagne électorale, pour l’ouverture de cette pratique à « toutes les femmes ». Cette ouverture est une revendication de longue date du milieu associatif et militant homosexuel. La PMA est un engagement que le Président de la République a rappelé dans une lettre ouverte adressée aux LGBTI le 16 avril 2017, dans laquelle il affirmait être « favorable à une loi qui ouvre la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, alors que seuls les couples hétérosexuels y ont accès aujourd’hui. ».
L’Église catholique, par la voix de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, chargé des questions d’éthique au sein de l’épiscopat avait appelé au lendemain de l’avis favorable du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) le nouveau Président à ne pas « réveiller les passions ». « Donnons-nous le temps de la réflexion et du débat », s’écriait Mgr d’Ornellas avec toujours ce même ton conciliateur et larmoyant qui caractérise les catholiques malades depuis des siècles du jésuitisme moral. Rouvrir le dossier de la procréation médicalement assistée serait pour Emmanuel Macron une « erreur majeure », avait averti aussi la “Manif pour tous” oubliant que ce genre de débat peut aussi être intéressant stratégiquement pour le pouvoir qui, en faisant diversion sur le sociétal refoule et censure ainsi la vraie question, la question sociale. Mais “La Manif pour tous” a-t-elle encore les moyens de mobiliser et de captiver quand on voit comment ont fini ses anciens supporters, la plupart récupérés politiquement ?
Lors de la traditionnelle “Marche des Fiertés” de juin, la Gay Pride de Paris, les manifestants réclamaient la PMA et la GPA pour tous. Juste après, le Mardi 27 juin, le Comité consultatif national d’éthique rendait son avis favorable à l’ouverture de la PMA sans père. Les revendications de la Gay Pride 2017 portaient aussi sur le droit des trans, la réassignation automatique de leur nouvelle identité sexuelle dans l’identité civile. Fin 2016, par la loi française de réorganisation de la justice, avait en effet été introduit la possibilité d’effectuer un changement de sexe sur l’état civil sur simple attestation. Dans les trois cas, qu’il s’agisse de la PMA, de la GPA ou du droit des trans, on est dans la confusion la plus complète en ce qui concerne la perception homme-femme sur le genre, ou l’appréhension de la paternité et de la maternité. On retrouve à l’œuvre cette volonté d’artificialiser l’homme, de le transformer, la marche en somme vers un trans-humanisme technique, médical et juridique.
La loi Taubira menait logiquement à la légalisation d’une PMA sans père et par la suite à la GPA. Le mariage homosexuel entérinait de facto une redéfinition de la filiation, quel que soit le genre, le mode de conception. Peut-on alors considérer la PMA pour les femmes, la maternité sans père comme n’étant pas autre chose qu’un détournement politique de la médecine pour des revendications sociétales ? On notera au passage qu’aucune de nos féministes ne s’émeut de l’aliénation de la femme (louer son corps) et de la marchandisation d’enfants qu’implique la GPA. Pour les LGBT, l’ouverture de la PMA est une question d’autonomie des femmes et de choix personnels, au même titre que la contraception, la stérilisation ou l’avortement, « une question d’égalité et de santé publique », rappelle même l’Inter-LGBT afin d’obtenir le remboursement par la sécurité sociale.
Le Comité nationale d’éthique reste pour l’instant opposé à la Gestation pour autrui et à l’autoconservation des ovocytes. A la demande de la Mission de recherche « Droit et Justice » du Ministère de la justice, une équipe de juristes de l’université de Reims avait remis un rapport sur « Le droit à l’enfant et la filiation en France et dans le monde ». Ce document de 500 pages mettait en garde contre une destruction progressive des règles de la filiation.
Mais quelle est donc la logique juridique alors des nouveaux progressistes ?
Il s’agit tout bonnement de passer des droits classiques de l’Homme, qui étaient « les droits de » (se réunir, de penser) à « des droits à… », y compris désormais, à un droit de la filiation. Le droit est devenu un droit militant, non plus le garant du commun mais le droit de minorités qui s’exercent au nom de l’égalitarisme abstrait sur de simples rapports de force d’opinion. Ainsi petit à petit, nous jugeons comme naturel la prétendue existence d’un « droit à l’enfant » alors que l’idée de l’existence d’un tel droit ne peut être invoqué en tant que tel puisque toutes les juridictions, y compris la Cour européenne des Droits de l’Homme, le précisent expressément : il n’y a pas et ne peut pas y avoir juridiquement de « droit à l’enfant ». Reste alors à se demander quel intérêt la société aurait à modifier complètement, à l’échelle mondiale, anthropologiquement les liens qui unissent père, mère et enfant ?
La question du transsexualisme peut nous fournir une ébauche de réponse car dans le transsexualisme, ce qui est remis en cause, au bout du compte, c’est la définition même de l’homme et de la femme. Pour arriver à détacher la filiation de l’acte d’engendrement, il faut en effet en venir à dire qu’un homme et une femme, c’est pareil ou interchangeable. Cette conception des choses qualifiée dans le numéro 41 de Krisis, d’androgynique remet en cause tous les concepts du droit classique et en douceur fait basculer notre système juridique vers une réification complète de l’homme, en supprimant le principe d’indisponibilité de l’état des personnes (Anne-Marie Leroyer prétend même que c’est un mythe et une fiction juridique !) Je ne déciderai d’être mère, d’être père, d’être homme, d’être femme qu’en fonction de ma seule volonté, la volonté de puissance du Surhomme nihiliste ? Le principe d’autodétermination devient donc ici absolu, et avec lui est posé contre l’enfant la toute-puissance des adultes. L’enfant, lui, n’est plus réduit qu’à une chose puisqu’il n’existe plus comme tel dans le raisonnement juridique. Nos humanistes progressistes nous avaient promis la mort de l’homme, ils ont en fait réalisé la mort de l’enfant.
De fait, la GPA est une technique, elle ne peut être éthique ou alors ce n’est qu’une éthique utilitariste, une éthique anglo-saxonne d’intérêts (la mère porteuse est toujours dans une situation financière inférieure aux commanditaires). La GPA n’est en réalité qu’un contrat d’entreprise, qu’une uberisation assistée des utérus, un contrat de louage de fœtus. On ne travaille pas mais on produit un ouvrage (on économise ici une poiesis et non une praxis au sens d’Aristote). On demande à la mère porteuse de tout simplement fabriquer un enfant pour un autre, définition de l’esclavage ou de la traite de personnes.
La secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, ardente militante gay (c’est elle-même qui, lors de son investiture a réclamé de rajouter à son ministère les attributions « gays » à son ministère) promet pour 2018 la PMA, préalable pour elle bien sûr à la légalisation de la gestation pour autrui qui demeure l’objectif premier du lobby qu’elle représente. Interrogé sur France-info, Jean François Copé a déclaré avoir « évolué » sur le sujet et il ne s’opposera plus au projet du gouvernement de PMA pour les couples lesbiens quoiqu’il continue d’être néanmoins opposé par pure forme à la gestation pour autrui. Tous ces gens n’ont en réalité aucune conviction ou plutôt, ils ne sauraient s’opposer à ce qu’ils ont toujours défendu par ailleurs, à savoir : la marchandisation du monde et des hommes. En 2012, Jean-François Copé voyait dans la PMA pour les couples de femmes un glissement inexorable vers la légalisation de la GPA. Il n’avait pas tort même s’il se contredit aujourd’hui par pur intérêt partisan.
Issu de la droite, Edouard Philippe s’était abstenu comme quatre autres députés de son camp, le 23 avril 2013, lors du vote à l’Assemblée nationale de la loi Taubira. S’exprimant dans une tribune du Huffpost en date du 10 février 2013, signée avec Nathalie Kosciusko-Morizet, le nouveau Premier ministre expliquait alors : « Nous ne sommes pas opposés à une loi qui permettrait le mariage et l’adoption simple pour les couples de même sexe, mais nous n’accepterons pas ce qui viendra après cette loi. Nous nous opposerons résolument à la PMA pour les couples homosexuels féminins, et à la GPA qui, au nom de l’égalité, ne manquera pas d’être réclamée par la suite ». Il se dit aujourd’hui favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes se repliant sur l’avis du Comité consultatif national d’éthique de fin juin.
Dans un entretien qu’il avait accordé au JDD le dimanche 22 janvier, Jean-Luc Mélenchon, avait rejoint les positions d’autres candidats de gauche sur des sujets sensibles de société. « Il ne faudrait pas que les questions de la présidentielle se résument à combien ça coûte? Je veux introduire dans le débat le droit à être maître de soi-même », expliquait le candidat de la France insoumise. Il expliquait ses positions favorables en faveur du suicide assisté et de la PMA étendue aux couples de femmes. Curieusement, le « bolivarien » manifestait son hostilité à la GPA parce que le corps n’est pas une marchandise et qu’en vieux marxiste, il voyait le GPA « faire de la femme un outil de production ». Il s’est dit prêt à changer d’avis « le jour où l’on me présentera une milliardaire qui par amour d’une femme pauvre d’un bidonville acceptera de porter son enfant ». Les gauchistes de palais ont toujours le bon mot pour rire !
Pourquoi une telle mise au point ? Si des mobilisations sociétales contre la PMA ou la GPA pour tous devaient reprendre, elles ne pourraient cette fois-ci faire l’impasse sur la marchandisation du monde et donc l’enjeu social de la revendication à moins d’en rester à ce qu’elle fut en grande partie une réaction épidermique et petite-bourgeoise d’une religiosité factice déjà asservie au pire évangéliquement.
On s’orientera tôt ou tard vers une GPA universelle mais sans doute, on le fera encore à la Française avec un grand “machin” du style « Agence gouvernementale pour la procréation assistée » où auront même le droit de participer quelques prêtres défroqués dans l’âme. Nonobstant, on n’y rencontrera sans doute pas d’imam.
Psychologiquement le grand risque de la GPA est le trouble identitaire, le morcellement affectif. Or, s’il y a morcellement à l’origine de la vie, on peut craindre aussi que la personnalité soit morcelée et qu’il y ait donc demain des modèles familiaux à très grand risque et donc une accélération de la décomposition sociale psychotique du pays déjà en cours pour plein d’autres raisons (divorces, drogues, homophilies).
Or, de tous temps n’avons-nous pas besoin d’hommes forts ? Comment constituer l’ordre chevaleresque des futures élites que la situation d’exception exige à base de filiations traumatisées ou d’abandons maternels programmés et monétisés sur fond de droits narcissiques « à… » et de commerce médical ?
Michel Lhomme (Metamag, 2 novembre 2017)