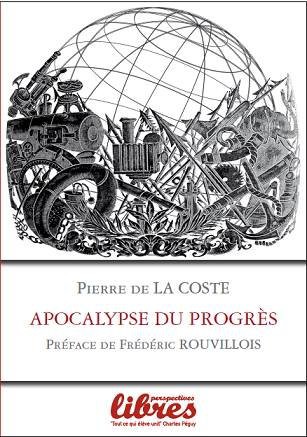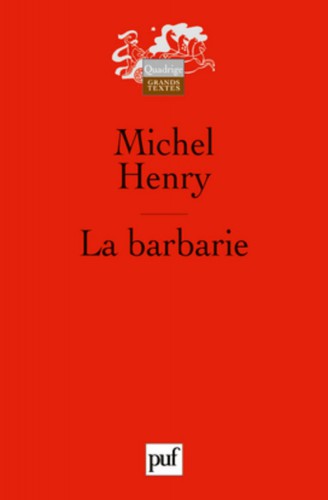Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à l'écologie, une pensée de la nature qui n'a rien à voir avec l'idéologie libérale-libertaire des bobos verts...

En attendant que les Verts deviennent écologistes...
À l’origine, l’écologie était plutôt de droite. Elle campe aujourd’hui à gauche, voire à la gauche de la gauche. Comment expliquer ce glissement de terrain ?
Avant d’être une idéologie, l’écologie est d’abord une science, fondée en 1859 par le naturaliste allemand Ernst Haeckel pour étudier les relations entre les êtres vivants et leur milieu naturel. La notion d’« écosystème » a été créée en 1935 par l’Anglais Arthur Tansley. En tant que préoccupation politique, l’apparition de l’écologisme est beaucoup plus tardive. Il a d’abord fleuri à droite, car la droite n’a jamais été fâchée avec la notion de « nature ». Laquelle ne s’est développée à gauche qu’à partir d’une mise en cause de l’idéal productiviste héritée de la pensée des Lumières. Aujourd’hui, on peut dire que l’écologie est à la fois conservatrice et révolutionnaire : conservatrice parce qu’elle vise à préserver des équilibres naturels menacés, révolutionnaire parce que cette préservation implique une rupture radicale avec le modèle de « développement » dominant.
L’ampleur du problème peut être difficilement contestée. Au-delà des polémiques stériles sur les causes, anthropiques ou non, du réchauffement climatique, la réalité est là : pollutions systématiques des paysages et des nappes phréatiques, fonte des banquises, déforestation de l’Amazonie, continents de déchets dérivant sur des océans de plus en plus acides, poissons nourris aux œstrogènes et aux matières plastiques, extinction des espèces, destruction de la chaîne alimentaire, etc. Il faut être d’une extraordinaire inconscience pour ne pas voir que la Terre devient une immense poubelle, et que c’est là une menace gravissime pour l’avenir.
On a longtemps cru que les réserves naturelles étaient inépuisables et gratuites. Elles n’étaient ni l’un ni l’autre. Les combustibles fossiles représentent plus de 80 % de l’approvisionnement énergétique de l’humanité. Or, le pétrole est en passe d’atteindre le « pic » au-delà duquel il ne pourra plus être extrait qu’à rendement décroissant, tandis que la demande ne cesse d’augmenter (elle sera, en 2035, de cinq milliards de tonnes par jour). Autrement dit, il en faudra toujours plus et il y en aura toujours moins, ce qui se traduira par une explosion des prix. La moitié seulement du pétrole étant disponible à l’achat par les pays qui n’en ont pas, une baisse de 20 % de la production dans vingt ans, conjuguée avec l’augmentation de la consommation intérieure des pays producteurs, se traduira mécaniquement par une diminution de 50 % de la part disponible pour les pays non producteurs, à commencer par la France, dont la facture énergétique est déjà de l’ordre de grandeur du déficit de sa balance commerciale. Compte tenu de la relation étroite existant entre la consommation d’énergie fossile et l’activité économique, c’est là un redoutable défi. D’autant que le « développement durable » ne fait que reculer les échéances et que les énergies dites renouvelables (éolienne, photovoltaïque, etc.) sont absolument incapables de prendre le relais.
La vérité est que, la Terre étant un espace fini, elle ne peut être le théâtre d’une croissance matérielle infinie : les arbres ne montent pas jusqu’au ciel ! Et, n’en déplaise aux défenseurs de la « vie », il en va de même de la population, qui a déjà quadruplé au XXe siècle et augmente aujourd’hui d’un million d’habitants tous les quatre jours et demi, ce qui devrait nous faire passer de 7,2 milliards de bipèdes à plus de 11 milliards en 2100. Si l’on raisonne en termes d’« empreinte écologique », laquelle est égale au nombre d’habitants multiplié par la demande en ressources et en énergie, les États-Unis sont d’ailleurs actuellement le pays le plus peuplé de la planète…
Vous avez consacré un livre à la décroissance. Pourquoi ce sujet fondamental n’est-il jamais évoqué par les Verts ? La politique d’immigration massive relève aussi de l’écologie humaine, mais là, encore, les Verts n’abordent jamais la question…
Parce que les Verts, contrairement à ce qu’ils prétendent, n’ont que des préoccupations écologiques tout à fait cosmétiques. Ce sont plutôt des libéraux-libertaires, souvent de simples gauchistes ayant viré bobos. Il ne vous aura pas échappé que leurs prises de position en faveur du mariage homosexuel, de la légalisation des drogues douces, de la suppression des « stéréotypes de genre » et de toute barrière à l’immigration n’ont qu’un rapport pour le moins lointain avec l’écologie. Leur opportunisme contredit en outre leurs convictions affichées, puisqu’ils ont depuis longtemps choisi de devenir la roue de secours du Parti socialiste, qui est traditionnellement un parti productiviste. Ils apparaissent par là incapables de prendre leurs distances vis-à-vis de l’idéologie du progrès, qui est à l’origine même du saccage de l’environnement. Yves Cochet a toutefois eu le mérite de s’intéresser sérieusement à la décroissance. Et, tout récemment, José Bové a fait scandale chez ses amis en déclarant, à propos de la PMA, qu’il ne voyait pas de raison d’admettre en matière de procréation humaine des manipulations qu’il refuse pour le maïs transgénique. Soit on respecte la nature, soit on ne la respecte pas. Bové, il est vrai, est un disciple de ces deux grands précurseurs de l’écologisme que furent Jacques Ellul et Bernard Charbonneau. La plupart de ses amis, au contraire, n’ont aucune culture en matière de philosophie de l’écologie (qui s’est surtout développée en Allemagne et aux États-Unis). Mais il ne faut pas oublier non plus que les Verts sont loin de représenter la totalité de la scène écologiste française. Il y a aussi le Mouvement écologiste indépendant d’Antoine Waechter et les membres des associations de protection de la nature fidèles à l’esprit de ce grand naturaliste que fut Robert Hainard.
À en croire toutes les traditions, la nature est un legs divin dont l’homme est le jardinier. Mais pour certains écologistes, il y a parfois divinisation de la nature et diabolisation de l’homme. Cette proposition manichéenne peut également s’inverser. Qui dit vrai, qui dit faux ?
Ce qu’il s’agit surtout de comprendre, c’est que la nature n’est pas le simple décor de notre existence, mais la condition systémique du maintien même de la vie. Elle a donc une valeur intrinsèque, indépendante de l’intérêt qu’elle peut présenter pour nous. Il est dit dans la Bible que l’homme doit « soumettre » la nature (Gen. 1, 26). Un pas supplémentaire est franchi avec Descartes, selon qui nous devons nous rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature » : la nature, rendue muette, devient une chose à exploiter, un objet à arraisonner. Chez les anciens Grecs, au contraire, le respect du cosmos allait de pair avec le refus de la démesure (hybris) ; le rapport de l’homme à la nature était un rapport de partenariat, ou plutôt de co-appartenance. C’est ce rapport qu’il faut retrouver.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 1er juin 2014)