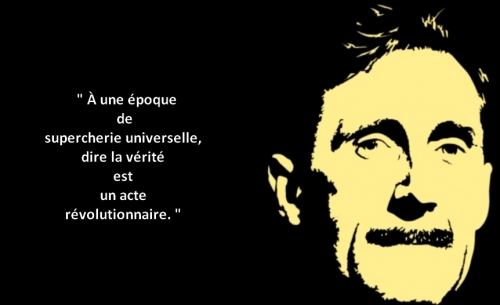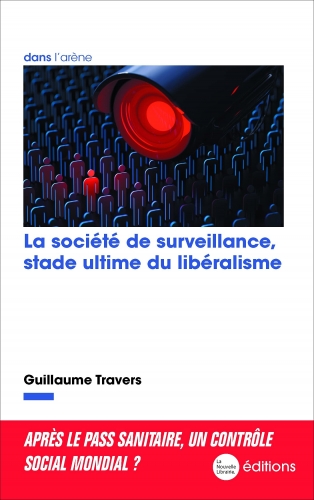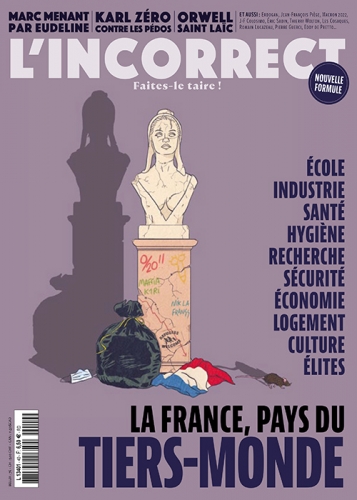Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue de François Valentin cueilli sur Figaro Vox et consacré à l'étroite relation entre le numérique et le wokisme. Pierre Valentin est l'auteur d'une note intitulée «L'idéologie woke» pour la Fondapol.

«La fluidité du numérique est la porte ouverte à l'idéologie "woke"»
Le Daily Telegraph nous apprenait le 17 février dernier que des centaines de changements ont été apportées aux textes originaux de Roald Dahl par l'éditeur anglais Puffin, afin de les rendre plus «inclusifs». Les Oompa Loompas, ouvriers dans l'usine de chocolat de Charlie et la chocolaterie, ne sont plus des «petites personnes» mais bien des «petits hommes». Dans le même ouvrage, la phrase «comme toutes les personnes âgées, elle est faible» a été troquée pour «comme la plupart des personnes âgées, elle est faible». Les références aux couleurs de peau ont été supprimées. Certains mots censurés (comme «gros» ou «laid») sont d'une banalité confondante, et leur censure signale une aseptisation profonde de la littérature à venir.
Face aux critiques, Gallimard a annoncé que les versions françaises ne seraient pas modifiées, tandis que Puffin et sa société mère Penguin Random House U.K. ont annoncé qu'ils publieraient, en même temps que les versions modifiées, «The Roald Dahl Classic Collection», qui comportera 17 histoires avec le texte original de Dahl. Cependant, outre le fond idéologique des modifications, c'est la discrète modification numérique des textes qui pose question. Il est fort probable que nombre d'utilisateurs de Kindle, ou autre liseuses électroniques, n'aient même pas remarqué les évolutions. Une simple «mise à jour», bien souvent automatique sur nos appareils, aura permis de mutiler l'œuvre de l'écrivain. La numérisation du monde ouvre la possibilité de modifier les ouvrages sans que l'on s'en aperçoive.
De la même façon, la domination du «streaming» retire les droits de propriété d'une œuvre au client pour les transférer à la plateforme. Contrairement à l'achat par DVD, vous ne possédez plus l'histoire de Bambi ou Dumbo, c'est Disney+, et ils ne manquent désormais pas l'occasion d'ajouter numériquement la mention suivante en amont de leurs propres classiques : «Ce programme comprend des représentations négatives et/ou des mauvais traitements de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient condamnables à l'époque et le sont encore aujourd'hui». Demain, les plateformes pourraient peut-être altérer le contenu idéologique de leurs œuvres, sans nécessairement l'admettre publiquement.
En août 2019, le New York Times lançait le «1619 Project», une initiative qui visait explicitement à instaurer l'idée selon laquelle la véritable date de naissance des États-Unis remonterait en réalité à 1619, date de la première arrivée d'esclaves sur le continent. Dans leur désir de marquer leur nation du sceau du péché originel, les journalistes à l'origine du projet avaient manifestement sous-estimé l'ampleur que prendraient les critiques. Plutôt que d'assumer leur prise de position face à leurs détracteurs, ils ont procédé à une nouvelle réécriture de l'histoire, mais cette fois-ci celle du déroulement de la polémique elle-même. Ainsi, comme le souligne le journaliste britannique Douglas Murray dans son ouvrage The War on the West, les hérauts du 1619 Project ont modifié en catimini leurs anciens articles afin de retirer les passages où ils avaient explicitement écrit que l'histoire des Etats-Unis commençait en 1619, ce qui leur a permis par la suite d'expliquer qu'ils n'avaient jamais tenu cette position. Le numérique permet de maquiller les revirements les plus lâches ; de donner au reniement un air de cohérence.
Si George Orwell est mort près de quatre décennies avant l'invention d'internet, son œuvre n'est que plus actuelle depuis que nous basculons vers le tout numérique. On a tendance à se tourner pour analyser ce type de situation, non sans raison, vers le roman dystopique 1984. À chaque permutation des alliances géopolitiques, le Parti proclame qu'il a toujours été en guerre contre tel continent et allié avec tel autre, et ce malgré les changements. Là aussi, la contradiction peut se déguiser en cohérence avec l'aide, déjà, de la radio et de la télévision qui diffusent la nouvelle ligne à suivre tout en faisant disparaître à jamais l'ancienne. Cependant, il se pourrait que son roman La Ferme de Animaux soit à sa façon un guide encore plus éclairant pour notre époque. Dans cet ouvrage, des animaux, guidés par une avant-garde composée de plusieurs cochons, renversent un ordre tyrannique incarné par le vieux fermier Jones. Cette révolution se fait au nom de l'abolition de l'Homme. De fil en aiguille, la nouvelle élite éclairée finit pourtant par reproduire les comportements humains qu'elle dénonçait, sans pour autant que les autres animaux, manipulés, parviennent à percevoir ce renversement spectaculaire.
Quel type de peuple faut-il pour qu'une telle «révolution» au sens propre du terme – un tour complet sur soi-même, un retour au point de départ – puisse avoir lieu ? Quels critères sont requis afin que le changement puisse se faire au nom de la continuité, que la contradiction se mette en place au nom de la cohérence ? Pour formuler la question autrement : à quel point ressemblons-nous aux animaux de cette ferme ? Un critère central qui se dégage de l'ouvrage semble être la malléabilité du peuple. Sept commandements sont inscrits sur une planche en bois au centre de leur lieu de vie. Ces commandements ne sont pas (dans tous les sens du terme), gravés dans le marbre. Au fur et à mesure du roman, ils vont discrètement évoluer. Comment est-ce que les animaux réagissent à ces modifications, qui sont toutes des trahisons des commandements initiaux ? En un mot : peu. Leurs réactions sont timorées et confuses, malgré la répétition de ce sentiment de doute. Face à un énième changement, Orwell nous dit qu'«une fois encore les animaux éprouvèrent une vague inquiétude». Du fait de l'absence de preuves, leur doute face à un revirement apparent du pouvoir en place se mue progressivement en doute vis-à-vis d'eux-mêmes. Auraient-ils tout imaginé ? Brille-Babil, jeune cochon et excellent orateur, se charge parfois de faire le service après-vente des discours du chef Napoléon : « "Êtes-vous tout à fait sûrs, camarades, que vous n'avez pas rêvé ? Pouvez-vous faire état d'un document, d'un texte consigné sur un registre ou l'autre ?" Et comme assurément n'existait aucun écrit consigné, les animaux furent convaincus de leur erreur.»
C'est justement parce qu'il n'y a plus de traces du passé que le présent peut être à ce point malléable (thème également exploré dans 1984), et que le doute peut être retourné contre ceux qui l'exprimaient. Le scepticisme, initialement dirigé vers la falsification et la trahison opérée par les cochons, se reporte sur le reste des animaux. Concernant les premiers commandements, Orwell rappelle que «tous les animaux se rappelaient les avoir adoptées – ou du moins ils croyaient en avoir gardé le souvenir» ; la deuxième moitié de cette phrase symbolisant ce retournement du doute sur soi-même.
Ces troubles de la mémoire sont largement exacerbés dans le roman par le fait que les commandements ne sont jamais inscrits dans la pierre. C'est d'ailleurs parfois ce qu'une lecture d'Orwell chez certains à gauche est susceptible de rater : certes, les commandements sont absolus et le pouvoir autoritaire, mais les injonctions changent en permanence et impliquent un peuple élastique, flexible. La perception contemporaine des mouvements totalitaires obscurcit d'ailleurs cette réalité indiscutable, les réduisant souvent au culte d'un monde «fermé», «rigide». En réalité, comme le rappelle Victor Klemperer dans ses analyses du langage du nazisme, «le mouvement est à ce point l'essence du nazisme que celui-ci se désigne lui-même comme «le Mouvement» et sa ville natale, Munich, comme «la capitale du Mouvement», et, alors qu'il cherche toujours pour ce qui lui semble important des mots ronflants et excessifs, il conserve le mot «mouvement» dans toute sa simplicité». L'idéal de la «fluidité» et du flux sert de fait les intérêts les plus totalitaires.
De ce point de vue, comment ne pas voir dans la numérisation du monde un potentiel totalitaire proprement terrifiant, où tout ce qui apparaît sur un écran est par définition éphémère ? C'est précisément parce que les commandements de la ferme sont peints sur une planche en bois qu'ils peuvent changer insidieusement en permanence. La numérisation du monde porte un coup fatal à plusieurs idées : la fiabilité de ses cinq sens, la permanence et la réalité intrinsèque du monde, et le fait qu'on ne saura jamais totalement maîtriser ce dernier. Un monde numérique, fait de réalité «augmentée», c'est un monde où chacun peut se prendre pour le personnage maléfique de Thanos dans les derniers films «Avengers» qui proclame que «la réalité peut-être tout ce que je veux». L'omniprésence d'internet dans la vie sociale sape les anticorps au totalitarisme, car il affaiblit l'empirisme tout en renforçant d'un même geste la tentation constructiviste.
Ce n'est pas un hasard si la première génération intégralement numérique est aussi celle qui souhaite en masse se «customiser», comme un vulgaire personnage de jeu vidéo, en changeant de «genre» comme on change de couleur de cheveux. Ils veulent être une âme libérée d'un corps qui aurait l'inconvénient de s'imposer à nous, une idée délivrée des pesanteurs de la matière. Cette même génération qui se veut auto-engendrée appelle par ailleurs régulièrement à la censure et à la rééducation des éléments «problématiques» de la société. Désirs de remodelage intégral de soi et de la société vont de pair.
Néanmoins, cette volonté de toute-puissance de l'individu créateur se couple avec une impuissance et un certain fatalisme technologique. On accepte que la numérisation soit un processus inéluctable (ce qui risque de la rendre inéluctable) et que les algorithmes domineront toujours plus nos vies. Les notions de «sens de l'histoire» et de «progrès» tournent à plein régime pour naturaliser l'avènement à la fois du wokisme et des nouvelles technologies. Beaucoup de nos logiciels ne nous demandent même plus la permission pour se mettre à jour eux-mêmes, pour muter, et nous acceptons passivement de les suivre là où ils voudront nous emmener, aussi bien technologiquement qu'idéologiquement. Quand l'absence d'un sentiment de discontinuité historique rencontre la puissance constructiviste sans précédent qu'est le numérique, les possibilités de contrôle et de manipulation ouvrent un champ des possibles particulièrement inquiétant. Une chose paraît certaine ; si cette dystopie devait un jour advenir, son premier message commencerait de la façon suivante : «Mise à jour 8. 4. 6…»
Pierre Valentin (Figaro Vox, 7 mars 2023)